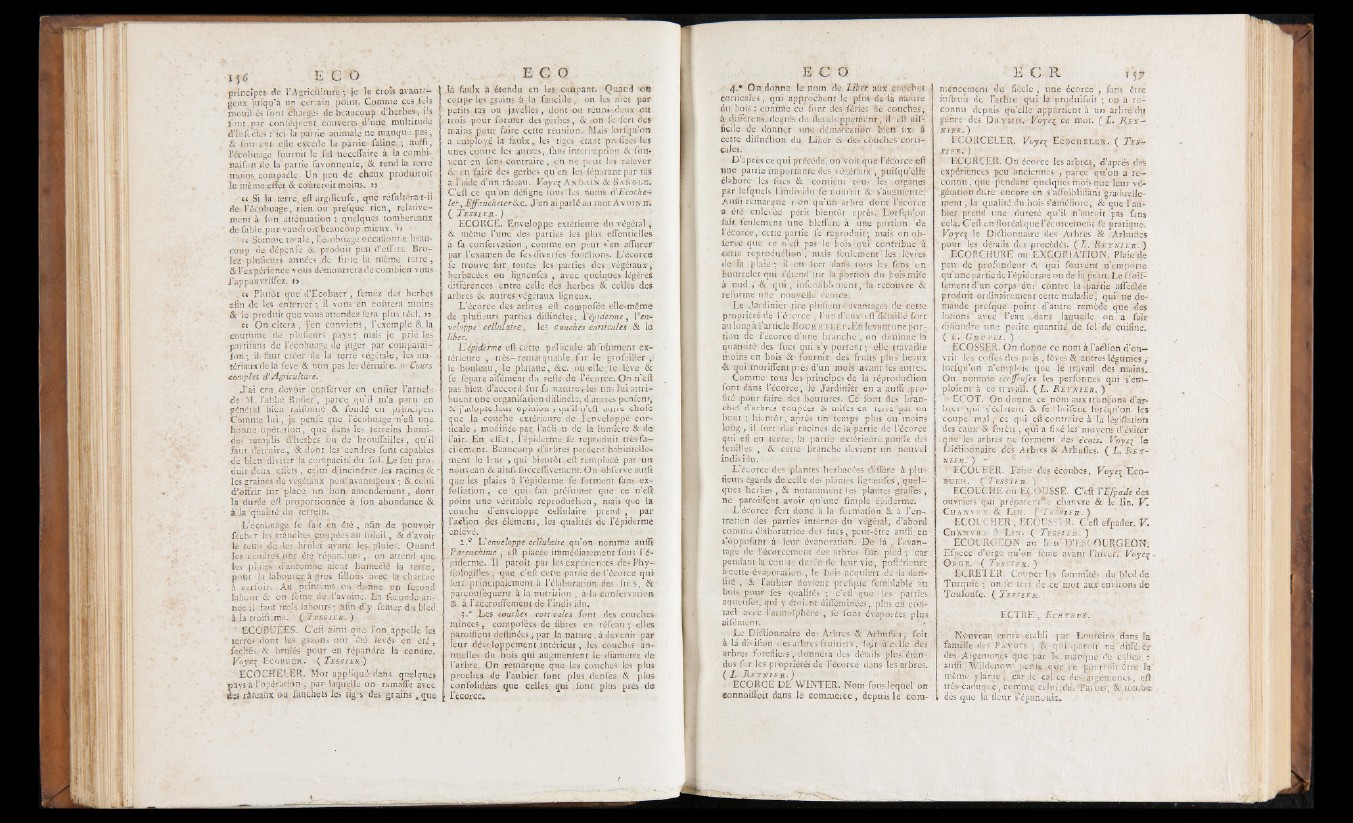
ï 5 «S E G O
principes de l’Agriculture -, je le crois avantageux
jufqo'à ïm certain point. Cpmme ces fels
mouillés l'ont chargés de beaucoup d'herbes, ils
font.par conféquent couverts d’utie multitude
d’înfeétes : ici la partie animale ne manque pas,
& fou'.ent elle excède la partie faline * auffi,
l’écobuage fournit le ,fel méceffaire à la combinai
fon .de. la partie favonneufe, & rend la terre
moins compaébe. Un peu de chaux produiroit
le même effet & coûteroit moins. >?
u Si la terre, eft argilleufe, que réfultera-t-il
de l’écobuage, rien, ou prefque rien, relativement
à fon atténuation : quelques tombereaux
de fable.pur vaudroitbeaucoup.mieux.
a Somme t or aie, l’écobuage occafionr.e beaucoup
de dépenfé &. produit peu d’effets. Brûlez
p Infieu rs années de fuite la même terre,
& l’expérience vous démontrera de combien vous
l’appauvrifTez. »
ci Plutôt que d’Ecobuer , femëz des herbes
afin de les enterrer ; il vous en coûtera moins
& le produit que vous'attendez fera plus réel, »
ci On citera , yen conviens, l ’exemple" &. la
coutume de plulieurs pays; mais je prié les
partifans de l’écobuage de juger, par comparai-
fon ; il faut créer de la terre végétale , les matériaux
de la feve & non pas les détruire. ,n Cours
compta d* Agriculture.
J ’ai cru devoir conferver en entier l’article
de M. l’abbé Rofier, parce qioLjm’a paru en
général bien raifonné & fondé en principes.
Comme lu i, je penfe que l’écobuage/'n’eft une.
bonne opération, que dans les terreins humides
remplis d’herbes bu de brouffaiiles, qu’il
faut..d étruire& dont les' cendres font capables
de bien diviier la compacité du fol. Le feu produit
deux effets, celui d’incinérer des racines &*
les graines de végétaux peu avantageux ; & celui
d’offrir fur placé, un bon amendement, dont
la' durêe èft proportionnée à fon abondance &
à, la qualité du ferrein.
L ’éçobuage. fe fait en é té , afin de pouvoir
féeh< r les.tranches coupées: au foieil, & d’avoir
le teins dedes bridér avant les,;pluies. Quand
lès. cendres ont ëré répandues,... on attend' que
les pluies d’automne, aient humeélê la terre,
pour la labourqr à gros filions .avec la charrue
à vcrfoir. ,Au prihtems ...on. donne un fécond
labour & on feme de .l’avoine. La féconde année
il faut trois labours ; afin d’y femer du bled,
à la troifiime. .( Tes s ier . )•
1 ECOBUÉES. C’efl ainfi que l’on appelle les
terres dont les gazons onr été levés- en été,
fech'és & brûlés pour en répandre la cendre.
Voyez Ecobuèr. { T e s s ier )
' ECOCHELER. Mot appliqué dans quelques pays à l’opération j par-laquelle on ramaffe avec
fies râteaux ou, fauche ts les tigés des grains , que
E C O
la fauîx a étendu en Us coupant. Quand ois
coupe lqs grains à la faucille ,’ on les met par
petits tas ou javelles , dont on réuni deux ou
trois pour former des-gerbes, & ;on fe fert des
mains pour faire cette réunion. Mais lorfqu’on
a employé la faùlx,. les tiges étant prefiées les
unes contre les autres, lans interruption & four
vent en fens contraire, en ne peut les relever
& en faire des gerbes qu’en les déparant par tas
à l’aide d’un râteau. Voyez A nd.ain & S angle.
C'eft ce qu’on défigne fous ' les noms d'Ecoche-
1er, Effimcheter Sic. J ’en aiparlé au mot A vo in e ;
( Te s s ie r . ) .
ECORCE. Enveloppe extérieure du végétal,
& même l’une des parties les plus eftentielles
à fa confervation , comme on peut s’en affurer
par l’examen de fesdiverfes fanélions. L ’écorce
fe trouve fur toutes les parties des • végétaux,
herbacées ou ligneufes , avec quelques- légères
différences entre celle des herbes & celles des
arbres & autres végétaux ligneux.
L ’écorce des arbres eft conapofée elle-même
de plufieurs parties diftinéles; Ÿ épiderme, l ’enveloppe
cellulaire, les couches corticales & le
liber.
L’épiderme eft cette pellicule abfolument extérieure
-très-remarquable, fur fe ■- grofeiller ,
le bouleau, le platane, &c. où elleyle lève &
fe fépare aifément du refté de l’écorce. On n’efl
pas bien d’accord fur fa naturelles uns lûi;attri-
huent une organifationdiftincle; d’autres penfenr,
de j’adoptè.leur opinion , qu’il n’eft autre chofe:
que la couche extérieure de l’enveloppe-corticale
> modifiée par, l’aélian de' la lumière & de
l’air. En effet, l’épiderme .fe reproduit très-facilement.
Beaucoup d’arbres perdewhabiruelle--
ment le leur , qui bientôt eft remplacé par un
nouveau & ainfi fuccefïivemcnt. On ôbferve au lit
que les plaies à l’épiderme fe forment fans exfoliation,
ce qui;fait préfnmer-que ce n’efl
point une véritable reproduélion, mais que la
couche d’enveloppe cellulaire prend , par
l’action des élémens, les qualités de l’épiderme
enlevé.
2.° U enveloppe cellulaire qu’on nomme aufii
Parenckimé, eft placée immédiatement fous l’épiderme.
Il paroît par les expériences des Phy-
Îiologiftes , que c’eft cette partie de l’écorce qui
fert principalement à l'élaboration des Tues, &
parconféquenî à la nutrition , à la confervation-
& à i’accroiflemënr de l’individu.
3.0 ;Les couches , corticales .font des couches
minces, compofées de fibres en réfeau ; elles
paroifient deftinées., par la nature , à devenir par
leur développement intérieur, les couchas annuelles
du bois qui augmentent le diamètre de
l’arbre. On remarque que les couches les plus
proches de l’aubier font plus denfes & plus
confolidées que celles qui font plus près de
l’écorce*
E C O
4.* On donne le nom de Libér aux couches ■
corticales, qui approchent,1e plus d elà nature
du. bois.: comme ce font dés fériés 8e couches,
à difFérens degrés de développement, # èft difficile
(Je donner une démarcatibn bien fixe à
cette diflnélion du Liber & ’de$ Vè-ueheS corti-?
cales.'
D’après ce qui précédé, on voit que l’écorce eft
line partie importante des,-végétaux , puifqu’elle
élabore les fîtes & contient tous les organes
par lefquels l'individu fe ndürrit & s’augmenté:
Audi remarque t-on qu’un arbre' dont l ’écorce
a été enlevée' périt bientôt après. Lorfquun
fait feulement une bleffiite à une portion de
l ’écorce, cette partie, fe reproduit; mais on ob-
ferve que ce n’eft pas le bois1 qui contribue “à
cette reproduélion , mais feulement’ les .lèvres
de la plgie ; il en - fort dans tous les. fèns un
bourrelet qui s’étend fur la portion du bois mife
à nud , & qui , infenfibkmenr, la recouvre &
reforme une nouvelle- écorce.
Le Jardinier tire plufieurs’ avantages, de-cette
propriété: de i’écorce , l’un d’eux' eft détaillé fort
an longà’l’article -Bou r r e le t; Eh levant une por -
lion de. l ’écorce d’une branche , on diminue la
quantité des Lues qui.s’y portent ; elle travaille
moins en bois ‘80 fournit defe fruits piuS; beaux
& qui muriflent près d’un moi? avant les antres.
Comme tous les principes de la réproduélion
font dans l’écorce, lé Jardinier en a àufti .profité
pour faire viles boutures; Ce font dés branche^
d’arbres coupées & mifes en terre’par un
bout : bientôt , après un tehfps plus ou moins
long , il fort des' racines de la parrie de l’écorce
qui eft en terre, la partie exrérieùre .poûfte des
feuilles , & cette branche devient un nouvel
individu.
L ’.écorce des’-plames herbacées diffère à plufieurs
égards de celle des plantes ligneufes, quelques
herbes, & notamment les plantes grades,
ne pafoillent avoir qu’une fimple ëpidérme.
L ’écorce fert donc à la formation à J’en--
trerien des parties internes du végétal, d’abord,
comme élaboratrice- des; fucs, peut-être aufii. en
suppofant à leur évaporation. De là , l’avantage
de l’écorcement dès arbres fur piëd ; car
pendant la courte durée de leur vie, poftéricure
à cette ëvaporatioïE, !e bois acquierr. de la den-
fité , & l’aubier devient prefque femblable au
bois, pour fes qualités ; : c ’eft que • fés parties-
aqueufes,' qui y étoi^nt difTéminées, plus eh con-
taél avec ratmofphère , fe font évaporées plus
aifément. '• • m •
Le Diélionnaire des Arbres & Arbu fies, foi t
à lâdiviiion (ies arbres fruitiers, fojt'à ctUe dès'
arbres foreftiers ,'i’donnërà des détails pihs'ctèn-
dus fur les propriétés de l’écorce dans les arbres*
( L. R e y n ie r . ) ■
ECORCE DE WINTER. Nom fous lequel on
connoiffoit dans lé commerce, depuis le com-
E C R 1 5 7
m ê n e em e n t d u f t è c le , u n e é c o r c e , fa n s ê t r e
in f t r u i t d e l ’a r b r e q u i la p r o d u i f o i t ; o n à r e c
o n n u d e p u i s q u e l l e 'a p p a r t i e n t à u n a r b r é d u
g e n r e d e s Dr ym is .- Voye% c e m o t . ( L. R e y ~
NIER. ' )
E C O R C E L E R . Voyei Eçoche ler. ( J!es-
s ie r : ) ^
E C O R C E R . O n é c o r c e le s a r b r e s , d ’a p r è s d é s
e x p é r i e n c e s p e u an cienn es* ; , p a r c e ' q u ’o n a r e c
o n n u , q u e p e n d a n t q u e lq u e s m o i s q u e l e u r v é g
é t a t io n d u r e e n c o r e e n s’ a tF o ib li f ta n t g r a d u e l l e m
e n t , l a q u a l i t é du b o i s s’ a m é l i o r e , & q u e l ’ a u b
i e r p r e n d u n e d u r e t é q u ’ i l n ’ a .u rô it p a s fa n s
c e l a . C ’ e f l e n f l o r é a l q u e l ’ é c o r c e m e n t f e p r a t iq u e .
Voye[ l e D i é l i o n n a i r e d e s A r b r e s & .A r b u f t e s
p o u r le s d é t a i l s d e s p r o c é d é s . ( Z . R e y n ie r . )
E C O R C H U R E o u E X C O R I A T I O N . P l a i e d e
p e u d e p r o f o n d e u r & q u i f o u v e n t n ’e m p o r t e
q u ’ u n e p a r t ie d e l ’é p id e rm e o u d e l à p e a u . L e f r o i f -
( em e n t d ’u n c o r p s d u r c o n t r e l a « p a r t ie a f f e é l é e
p r o d u i t o r d in a i r e m e n t c e t t e m a la d ie ') q u i n e d e m
a n d e p r e f q u e p o in t d ’ a u t r e r em è d e q u e d e s
l o t i o n s a v e c l ’ e a u d a n s l a q u e l l e , o n . a f a i t
d if t 'o u d r e u n e p e t i t e q u a n t i t é .d e f e i d e c u i f in e .
( C . G r u y EL. )
E C O S S E R . O n d o n n e c e n o m à l ’a é t io n d ’ o u v
r i r les- c o d e s d e s p o i s , f è v e s & a n t r e s lé g u m e s ,
l o r f q ü ’ o n n ’ e m p l o i e q u e l e t r a v a i l d e s m a in s .
O n n o m m e éccjfiufes l e s p e r f o n n e s q u i s’ é m -
p l o i e n t à c e t r a v a i l . ( Z . Re y n ie r . )
• E C O T . O n d o n n e c e ^ n o m a u x t r o n ç o n s d ’ a r b
r e s ; q u i ‘ s 'é c la t e n t & f e b r i f e n t l o r f q ü ’ o n le s
c o u p e m f i ,* c e q u i e ft c o n t r a i r e à l a lé g i f ia t io n
d e s e a u x & f o r ê t s . , q u i a f i x é le s m o y e n s d ’é v i t e r
q u e le s a r b r e s n e ' f o r m e n t des ’écots. Voyez l e
D i é l io n h a i r e d é s A r b r e s & A r b u f t e s . ( L. Rs y ~
n i e r .'’ ) '
E C O U B E R . F a i r e d e s é c o u b e s , Voyez E c o -
ruer. (' T e s s i e r . ) '
E Ç O U C H E o u E f O U S S E . C tû YEfpade d e s
o u v r ie r s ‘ q u i p r é p a r e n t T e c h a n v r e & l e l in . V.
C hanvr e & L in . ( Te s s ie r . )
E C O E C H E R , E C O U S S F R . C ’e f t e fp a d e r . V.
Ch'an vr e & L in . { T e s s ie r . )
E C O U R G E O N a u l i a i D ’ E S C O U R G E O N .
E f p é e e d’ o r g e q u ’ o n f ém é a v a n t T h fv ë rV Voyez >
Or g e.-', ( T e s s i e r . )
E C R E T E R . C o u p e r le s f o m n i i t é s d u b l e d d e
T u r q u i e ; o n f e f e r t d e c e m o t a u x e n v i r o n s d e
T o u l o u f e . { T e s s iè r .
E C T R E , E ch t r ve.
N o u v e a u g e r i f e - é t a b l i p a r L o u r e i r o - d a n s î a
f a m i l l e d e s P a v o t s ‘ & q u i ' - p a r o î t ne. d i f f é r e r
d e s A r g ém o n e s - q u e p a r k m a n q u é d e c a l i c e :
p p u r f d i t ê t r e l a
. m êm e p l a n t e , c a r l e c a l : c e d e s a r g é m o n e s , e f t
t r è s - c a d u q u e , c o m m e . é e ln i .d e s P a \ o t s , . & . t o m b e
• d è s q u e l a f l e u r s é p a n .o