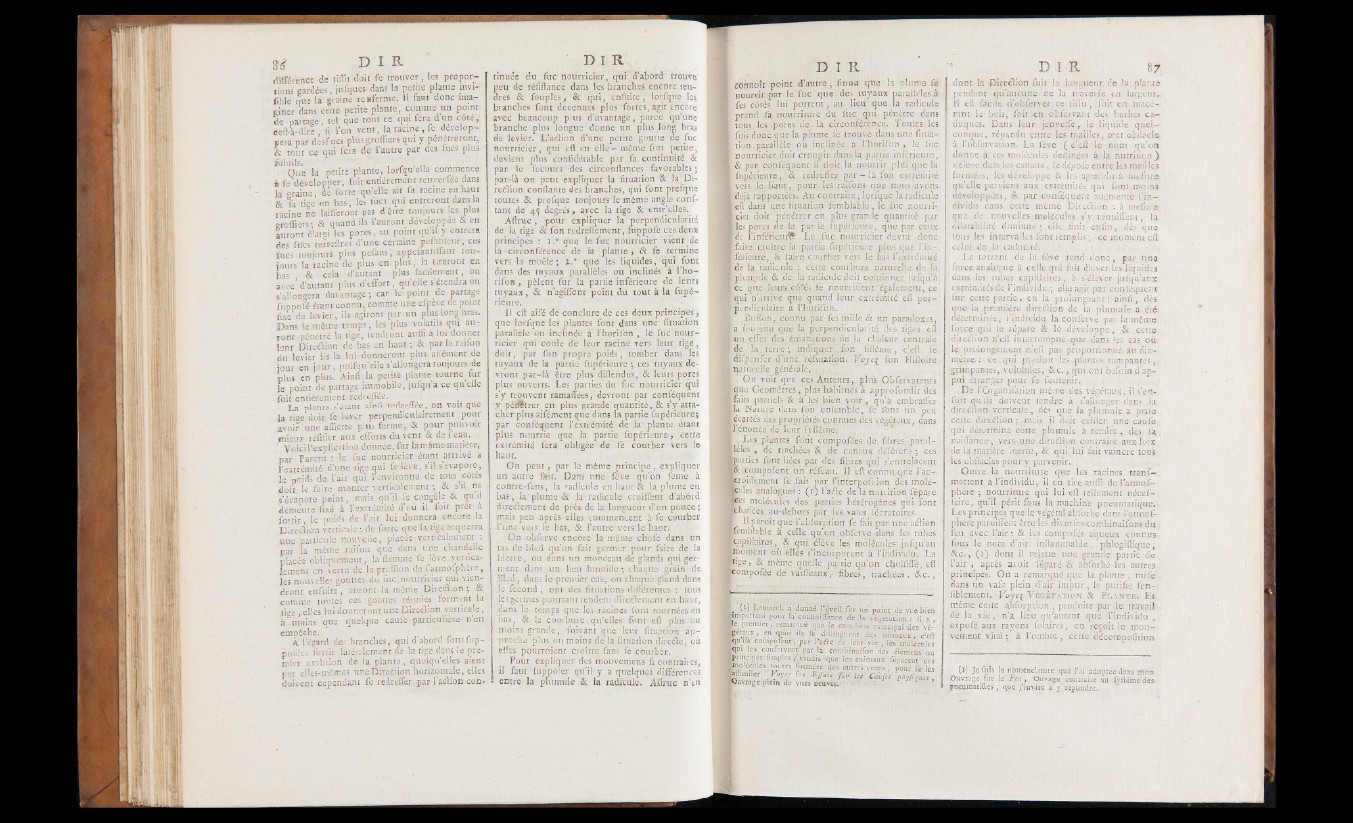
8 5 D I R
différence de tiffu doit fe trouver, les proportions
»ardées, jufques- dans la petite plante mvi-
lible que la graine renferme. Il faut donc imaginer
dans cette petite plante, comme un point
de partage , tel que tout ce qui ferai d’un côté,
ceM-dire fi l’on veut, la racine, fe développera
par dès f lies plus greffiers qui y pénétreront,
& tout ce qui fera de l'autre par des lues plus
faibiils. - ” : -
Que la petite plante, lorfqu elle commence
à fe développer, fait entièrement renverfée dans
la graine de forte qu'elle ait fa racine en haut
& la tige en bas, les fucs qui entreront dans la
racine ne laifferont pas d’être toujours les plus
greffiers- & quand ils l’auront développée & en
auront élargi les pores, au point quM y entrera
des fucs terrefires d’une certaine pefantettr, ces
lues toujours plus pelans, appefanttllant toujours
la racine dé plus en plus - la tireront en
bas & cela d’autant plus facilement, ou
avec’ d’autant plus d’effort, quelle s'étendra ou
s’allongera davantage; car le point de partage
fuppol'é étant connu, comme une efpèce de point
fixe de levier, ils-agiront par un plus long bras.
Dans le même temps, les plus volatils qui au-
î-ont pénétré la tige", tendront aufli à lui donner
leur Direction de bas en haut • & par la raifon
du levier ils la lui donneront plus ailément de
jour en jour, puifqu’elle s'allongera toujours de
plus en plus. Ainfi la petite plante tourne lur
le point de partage immobile, jufqu’à ce quelle
Toit entièrement redreffée. . . •
La plante s’étant ainli redreffée, on voit que
la tige doit, fe leyer perpendiculairement pour
avoir une afliette piiii ferme;, & pour pouvoir
mieux réiifter aux efforts du vent & de 1 eau.
Voici l'explication dounéeyfur Iarinême matière,
par Parent : le fuc nourricier étant arrrivé à
l’extrémité d’une tige qui fe lève, s’il s’évapore-,
le poids de l’air qui .l’environne de tous côtés
doit le faire monter verticalement -, & s’il ne
s’évapore peint, mais quil fe congèle & qu’il
demeure fixé à l’extrémité cl’ou il foit prêt à
for tir, le poids de l’air lui donnera encore la
Direction verticale ; de forte que la;tige acquerra
jme particule nouvelle, placée verticalement :
par la même raifon que dans une chandelle
placée obliquement, la flamme fe lève verticalement
en vertu de la preffion de l’atmofphère,
les nouvelle* * gouttes,du lue.nourricier qui viendront
enfuite, auront-la même Direébon -, &
comme toutes ces gouttes réunies forment la
m e , elles lui donneront une Direction verticale,
à^moins que quelque caufe particulière n’en
empêche.
A l’égard des branches, qui d’abord fontfup-
pofées fortir làrérslemeot de la tige dans le premier
embrion de la plante, quoiqu’elles aient
par elles-mêmes une Direction horizontale, elles
doivent cependant fe redreffer ...par Faélion con-
D I R
tinuée du fuc nourricier, qui d’abord' trouva
peu de réfiftance dans les branches encore tendres
& fouples> &. qui, enfuite, lorfque les
branches font devenues plus fortes, agit encore
avec beaucoup plus d’avantage, parce qu’une
branche plus longue donne un plus long bras
de levier. L ’aéHon d’une petite goutte de fuc
nourricier, qui eft en elle-même fort petite,
devient plus confidérable par fa continuité St
par le fecours des circonftances favorables ;
par-là on peut expliquer la fituation & la Direction
confiante des branches, qui font prefque
toutes & prefque toujours le même angle confiant
de 45 degrés, avec la tige & -en tr’elles..
Aflruc , pour expliquer la perpendicularité
de la tige & ion redreffement, fuppofe ces deux
principes : i.° que le fuc nourricier vient de
la circonférence de la plante, & fe termine
vers la moële ; i . e que les liquides, qui font
dans des tuyaux parallèles ou inclinés à l’ho-
rifon, pèfent fur la partie inférieure de leurs
tuyaux, & n’agïffent point du tout à la fupérieure.
Il eft aifé de conclure de ces deux principes,
que lorfque les plantes font dans une fituation
parallèle ou inclinée à l’horifôn , le fuc nourricier
qui coule de leur racine vers leur tige,
doit, par fon propre poids, tomber dans les
tuyaux de la partie fupérieure ; ces tuyaux devront
par-là être plus diftendus, & leurs pores
plus ouverts. Les parties du fuc nourricier qui
s’y trouvent ramaffées, devront par conféquent
y péfUtrer. en plus grande quantité, & s’y attacher
plus aifément que dans la partie fupérieure;
par conféquent l’extrémité de la plante étant
plus nourrie que la partie fupérieure, cette
extrémité fera obligée de fe courber vers le
haut.
On peut, par le même principe, expliquer
un autre fait. Dans une Têve qu’on feme à
contre-fens, la radicule en haut & la plumé en
bas * la'plume & la-radicule croiffent d’abord
directement de près de la longueur d’un pouce ;
mais peu après elles commencent à Te, courber
l’une vers le bas, & l’autre vers le haut.
On obferve encore la même chofe dans ; un
tas de bled qu’on fait germer pour faire de la
bierre, ou dans un monceau de glands qui germent
dansjun lieu humide; chaque-,grain de
bled, dans le premier cas, ou chaque gland dans
le fécond , ont des fi mations différentes : tous
les germes pourtant tendent directement én haut,
dans le temps que les racines font tournées en
bas, & la cour bure, qu’elles font eft pins ou
moins grande, fuivant que leur fituàtiôn ap-
• proche plus ou moins de la fituation directe, où
elles pourroient croître fans fe courber.
Pour expliquer des mouvemens fî contraires,
il faut fuppoier qu’il y a quelques différences
entre la pliimute & la radicule. Aflruc n’en
D I R
eonnoît point d’autre , fin on que la 'pl ume fe
nourrit par le fuc que des tuyaux parallèles à
I fes côtés lui portent, au lieu"que la radicule
[ prend fa nourriture du fuc qui pénètre dans
tous les pores de - la circonférence. Toutes les
I fois donc que la plume fe trouve dans une fituâ-
I tion parallèle ou inclinée à l’horifon , le fuc I nourricier doit croupir, dans la partie inférieure,,
| & par conféquent il doit la nourrir plus que la
I fupérieure, & rèdreffer, par - là fon extrémité
I yers le, haut, pour les;raifons que nous avons
K déjà rapportées. Au contraire, lorfquela radicule
B eft dans une fituation femblable , le fuc nourri-
■ çier doit pénétrer en plus grande quantité par
1 les pores de la panie l’upèrieyre, que par ceux
■ de l’inférieur?* Le. fuc.nourricier devra, donc
| faire. croître la partie fupérieqre plus que l’in -
■ fédeure, & faire, courber vers .fe bas l’extrémité
■ de la radicule cette courbure naturelle, de.la
I plumùie & .de Ta radicule doit e.on tin lier jufqu’à
I ce que leurs'côtés, fe nourrificnr également, ce
■ ara n’arrive que quand leur extrémité eft périt
penrîiculaire à fhorifoh.
| Buffon,. connu par-fes mille & un paradoxes,
l a foùtenu: que la perpendicularité des tiges eft
I un effet des. émanations,de la chaleur centrale
I de- la . terre ; indiquer fon fiftême , c’eft fe ’
I difpenfçr d’une., réfutation. Voyei fon Hiftoire
I naturelle générale. '■< '.
I On voit que ces Auteurs, plus Q b fer valeurs
| que Géomètres, plus habitués a approfondir «les
■ faits partiels & à les bien v o ir , qu’à embraffer
lia Nature dans fon enfemble, fe font un'peu
|écartés des propriétés cpnnues-des végétaux, dans
, rënonçé'dé leur fyfiêmei
K .. Les plantes font c'omp.ofées de fibres parai-
ilçles , de trachées & d ë canaux déférens ; ces
■ parties font liéjes par des fibres qui' s’entrelacent
■ & compofent un iréfeau. 11 eft connu qne ra c -
■ eroiftement fé fait par l’interpofidon des molé-
■ cules analogues : (r) laCle de la nutrition, fépare
^ces molécules des parties hétérogènes qui font
ÿêhafî.éès au-defaors par les vafes lécretoires.
■ | ^ paroît que i’ablorprion fe fait par une a&ion
Kemblable à celle qu’on obferve dans les tubes
■ capillaires , & qui élève les molécules' jufqu’au
inidmènt ou ëîtés s’incorporent à l’individu. La
p ig e , & même quelle partie qu’on choififfé, eft
tcompofée de vaifîeaüx, fibres , trachées . & c . ,
• . - ' , : . . i. ■ ---;--[. . ---»■ ï » . u n MU1UI UC vue UJ.C1]
em p o r ta n t pour la cônhôilTancc de la v ég é ta tio n : il a .
•Mie p rem ie r , remarqué que le ca ra& èie principal des v é -
‘îg e ta u x , en quoi ils fe diftinguent dés an im a u x , c !efl
* q u i l s ‘ eomp o fent; par l^ f t e de leu r' vie , Tes mo lécules
« q u i les coufervent. par la côm b ina ifon des élémens ou
■ principes 'fimplçs tandis Jqüe les animaux lëparent ces
e.c,u!?s fT° l,tes- formées des autres • c o r p s , pour fe les
îgOE in ilci I fom f e s . Effats fùr Us Cautis vhvjiauu ,
O u vrag e p:lem ds vues néùvés.- ' J
D I R 8 7
dont la Direélion fuit la longueur de la plante
• pendant qu’aucune ne la traverfe en largeur.
Il- eft facile d’obferyer ce tiffu, foit en macérant
le b o is fo it en obfervant des herbes caduques.
Dans leur j cuti elfe, le liquide quelconque,
répandu entre les mailles, met obi ta cîe
ii l’obfervation. La fève ( c’eft le nom qu’on
donne à ces molécules deftinées à la nutrition ),
s’élève dans.les canaux, fe dépqfe entre les mailles
formées, les développe & les agrandit à mefhre
qu’elle parvient aux extrémités qui font moins
développées, ■ & par conféquent augmenté l’in-,
dividu dans cette même Direclien : à mefure:
que de nouvelles molécules s’y réuniffent, la
dilatabilité diminue ; elle finit enfin, dès que
tous les intervalles font remplis ; ce moment efl
celui de la caducité-..
Le torrent de la fève tend donc, par uns
force, analogue à celle qui fait éiever les liquides
dans les tubes capillaires, à s’élever jufqu’aux
, extrémités,de l’individu ; elle agit par conféquent
fur cette partie, en la prolongeant: ainfi, dès
que la première direélipn de la plumule a été
déterminée, l’individu la conferve par la même
force qui le répare & le développe-, & cette
• direélion n’eft interrompue .que dans 'es cas où
le prolongement n’eft pas proportionné au diamètre,
: ce qui produit les plantes rampantes,,
grimpantes, vojubiles, & c ., qui.ont befoin d’appui
étranger pour fe foutenir.
De i’Organifation même des végétaux, il s’enfuit
qu’ils doivent tendre à s’allonger dans la
dire chou verticale-, dès que la plumule a prife
cette direélion ; mais il doit ex i lier, une caufe .
qui détermine cette plumule à tendre , dès là.
naiflance, vers une direélion contraire aux loix
de la matière inerte, & qui lui fait vaincre tous
les obftacles pour y parvenir.
Outre la nourriture que les racines transmettent
à l ’individu,- il en tire aufli de l ’atmosphère
; nourriture qui lui eft tellement nécef-
faire, qu’il; périt fous la machine pneumatique.
Les principes que le végétal abforbe dans i’atmof-
phère paroiffent être (es diverfes combinaifôns du ..
feu avec l’air: & les compofés aqueux connus-
fous le nom d’air imlammable , phlogiftique,
& c ., ( i ) dont il rejette une grande partie de...
l’air > après avoir féparé & abforbé les autres-.
principes. On a remarqué^que la plante , mife
dans un vafe plein d’air impur, le purifie fenT•
fiblemcnt. Voye^ V é g é ta t io n & P l a n t e .. Et
même cette abforption , produite par le travail
de la v ie , n’a lieu qu'autant que l’individu
expofé aux rayons Salaires, en reçoit le mouvement
vital; à l’ombre 3. cette décompolitiora
( i) Je fais la nomenclature- que j’ai' adoptée-dans m o »
O u vra g é fur le Feu, O u v a g e contraire au fyftêraedes>
p n e um a t i f te s q u e j’ in v i te à y répondre.-