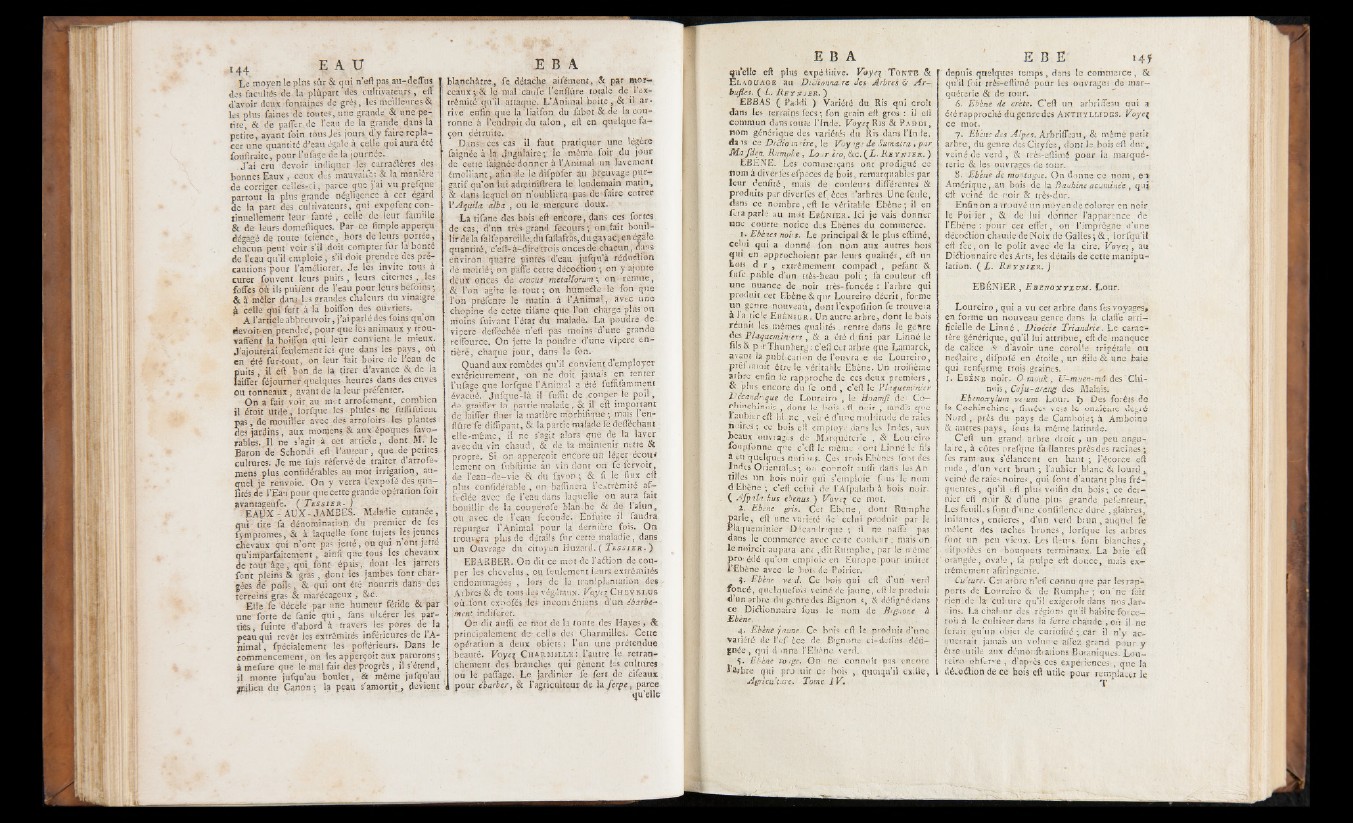
Le moyen le pins sûr & qui n’efipas au-defftrt
des facultés de la plupart dés c u ltiy a të u js e fl
d’avoir deux fontaines de grès, les meilleures &
les plus faines de toutes, une grande. & une petite,
& de pafler.de l’eau de la grande dans la
petite, ayant foin tousjes jours d’y faire replacer
une quantité d’eau égale a celle qui aura été
fouflraite, pour l’ufage de la journée.
J ’ai cru devoir indiquer lès carraélères des
bonnes Eaux , ceux des mauvanes & la manière
de corriger celles-ci, parce que j ai vu prefque
partout la plus grande négligence à cet égard
de la part des cultivateurs, qui expofent continuellement
leur fanté , celle de leur famille .
& de leurs domefliques. Par ce (impie apperçu
dégagé de toute Ici en c e , hors de leurs portée,
chacun peut voir s’il doit compter fur la bonté
de l’eau qu’il emploie*, s’il doit prendre des précautions
pour l’améliorer. Je les invite tous à
curer fouvent leurs puits, leurs citernes les
foffes où ils puifent de l’eau pour leurs befoins-,
& à mêler dans les grandes chaleurs du vinaigre
£ celle qui fert à là boiffon des ouvriers.
A l’article abbreuyoir, j’ai parlé des foins qn on
devoir en prendre , pour que ibs animaux y trou-
gaffent la boiflqn qui leur convient, le mieux.
J ’ajouterai.feulement ici que dans les pays, où
en été fu r -to u ton leur fait boire-de l’eau de
puits, il efl bçn de la tirer d’avance &; de la
laiffer féjoumer quelques heures dans des cuves
pu tonneaux, avant de la leur préfenter.
On a fait voir, au met arroiement, combien
il étoit utile,'lorfque les pluies ne fuffifoient
pas, de mouiller avec des arrpfoirs les plantes
des jardins , aux momens. & aux:époques favorables.
Il ne s’agit à cet articule, dont M.^ le
Baron de Schondi efl l’auteur, que de petites
cultures. Je me fuis réfervé de traiter d’arrofe^
mens plus confidérables au mot irrigation, au-
quel je renvoie. On y verra l’expofé des qualités
de l’Eau-pour que cette grande opération foit
avantageufe. ( T e s s i e r • )
EAUX - AUX - JAMBES, Maladie cutanée,
qui tire fa dénomination du premier de fes
fymptomes, & à laquelle font lu jets les jeunes
chevaux qui n’ont pas jetté, ou qui n ont jetté
qu’imparfaitement, ainfi que tous les chevaux
de tout âge, qui font épais*,, dont -les jarrets
font pleins & gras ,-dont. les jambes font chargées
de poils ^ & qui ont été nourris dans; des
tefreins gras & marécageux , &c.
Elle fe décele par une humeur fétide & par
une forte de fanie q u i , fans ulcérer les parties,
fiiinte d’abord à travers les pores de^ la
peau qui revêt les extrémités inférieures de 1A-
nimal, fpécialement les poflérieurs. Dans le
commencement, on les apperçoit aux paturons;
àmefure que lé mal fait desprogrès, il s’étend.
Il monte jufqu’au boulet, & même jufqu’aii
Milieu du Canon; la peau s'amortit, devient
blanchâtre., fe détache ail'ément, & par morceaux
; & le mal caufe l’enflûre totale de l’extrémité
qu’il attaqup. L’Animal boite & .il arrive
enfin que la liàifon du fabot & de la couronne
à j’endrpit du talon , efl en quelque façon
détruite,
Dansi- ces cas il faut pratiquer une légère
faîgnëe à la. Jugulaire; le mênle foir du jour
de cotte l'aignéd'donner à l’Animal un lavement
émolliant, afin de le difpofer au breuvage purgatif
qu’on luiaduùniftrera le lendemain matin,
& dans lequel on n’oubliera pas. de'faire entrer
VAquila alba , ou le mer.cure doux.
La tifane des bois efl encore, dans ces fortes
! de cas, d’un très-grand fecours; on fait bouillir
delà falfeparéille,du faflafràs,du gayac;en égale
quantité, c’efl-à-dire trois onces de chacun, dans
environ quatre pintes d’eau jufqu’à réduction
; de moitié; on pafl’e Cette décoélion ; on y ajoute
deux onces dé crocus mctalCorum y on remue,
& l’on agite le tout ; on humeéle le fon que
'Ton préfente lé matin à l’Animât, avec une
chopine de cette tifane que l’on chargeplns on
moins fuivant l’état du malade. La poudre de
I vipere deflechée n’efl pas moins d’une grande
reflource. On jette la poudre d’une vipere" entière,
chaque jour, dans le fon.
Quand aux remèdes qu’il convient d’employer
extérieurement, on ne doit jamais en tenter
l’ufàge que lorfque l’Animal a été fuffifamment
1 évacué. Jufque-Ià il fufnt de .couper- le poil ,
de grailler la partie malade & il* efl important
; dé laitier fl:ter la matière morbifique ; mais l’en-
flûre fe diflipant, & la partie malade fedefléchant
elle-même, il ne s’agit alors que de la laver
avec du vin chaud, & de la maintenir nette &
propre. Si .on apperçoit encore un lé|er écoii^
lement on fubftirue au vin dont on fé fer voit,
de l’eau-de-vie & du favor» ; & fi le flux efl
plus confidérable , on baffinera l'extrémité affrétée
avec de l’eau dans laquelle on aura fait
bouillir dé la coupërofe blan .he & de- l’alun,
ou avec de l’eau fécondé. En fu i te il faudra
repurger l’Animal pour la dernière fois. On
trouvera plus de détails fur cétre maladie, dans
un Ouvrage du citoyen Huzard. ( T e s s i e r . )
EBARBER. On dit ce mot de l’aélion de couper
les chevelus i, ou feulement leurs.extrémités
endommagées , lors de la transplantation des
Arbres & de tous des végétaux. EqyrqChevelus
où.font exnôfés les inconvéniens d’un ébarbe-
ment, indiferet.
On dit aulfi ce mot de la tonte des Hayes, 8c
principalement de- celle des. Charmilles. Cette
opération a deux objets : l’un une prétendue
beauté. Voye\ C h a rm il l e : loutre le retranchement
des branches qui gênent les cultures
ou le pa{Tage. Le jardinier fe fert de çifeaux
pour cbarber} & l’agriculteur dç la/ç/pç, parce
qu’elle
qu'elle efl plus expéditive. Voye\ T onte &
Ela-OUAGE au Diclionna rc des Àrbrei & A r -
bufies. ( L. R e y n ie r . )
EBBAS ( Pacldi ) Variété du Ris qui croît
dans les terrains fecs; fon grain efl gros : il efl
Commun dans route l'Inde. Eoy^Ris & Pad d i,
nom générique des variétés du Ris dans l’Inde,
da is ce DrSioin 'ire le Voyrg: de Sumatra, par
Mafden, Rumphe, Lo -r iro} &c. (X. R e y n ie r . )
EBENE. Les commerçans ont prodigué ce
pom à di ver les efpèces de bois, remarquables par
leur denlrté, mais de couleurs différentes &
produits par diverfes efpèces :*’arbres Une feule,
dans ce nombre, efl le véritable Ebène ; il en
fera parlé au mot EbénIe r . Ici je vais donner
une courte notice des Ebènes du commerce.
1. Ebetes noirs. Le principal & le plus eftimé,
celui qui a donné Ion nom aux autres bois
qui. en approchoient par leurs qualités, efl un
lois d r , extrêmement compaél , pelant &
fufe. prible d’un ttès-beau poli ; fa couleur efl
une nuance de noir très-foncée : l’arbre qui
produit cet Ebène & que Loureiro décrit, forme
un genre nouveau, dont l’expofirion fe trouve-a
à 1 a ride Ebénier. Un autre.arbre, dont le bois
réunit les mêmes quaiirés, rentre dans le genre
des Plaquemiwers, & a été d fini par Linné le
fils & p -.r Thnnberg : c’efl cet arbre que Lamarck,
avant la publication de l’ouvra e de Loureiro,
prôl imoit être le véritable Ebène. Un rroifième
arbre enfin fe rapproche de ces deux premiers ,
& plus encore du fe ond , c’efl le Pliquemirùcr
L-ecandnque de Loureiro , le Hoamfi de- C6—
.ch in chinai s , dont le bois ffl noir , tandis que
iaiibit-T efl bl ne , veit é d’une muhitudé de raies
noires; ce bois èfl employé dans les Indes, aux
beaux 'ouviagès de Marqueterie , & Loureiro
foupfonne que c’tfl le même '"ont Linné le fils
a eu quelques non >rs. Ces trois Ebènes (o u des
Indes Orientales ; on connoîr :;ulli dans les An
tilles un bois noir qui s’emploie fous lé nom
d Ebène ; c’efl celui de lAfpaiarh à bois noir,
( Àfpala hus chenus ) Voyc^ ce mot.
1. Ebene gris. Cet Ebène, dont Rutnphe
parle, efl une variété de' celui produit par le
Plaquennnier Décan lrique ; il ne pafle pas
dans le commerce avec cette couleur ; mais on
le noircit aupara art , dit Ruraphe, par !é irême"
pro-édé qu’on emploie en Europe pour imiter
l ’Ebène avec le hoL de Poirier.
3. Ebène ve-d. Ce bois qui efl d’un vend
foncé, quelquefois veiné de jaune, efl le produit
d’un arbre dugenredes Bignon s, & dëfigné dans
ce Diélionnaire fous le nom de Brgnor.e h
Ebène.
4. Ebène jaune. Ce bois efl le produit d’une
variété de l’c f èce de Bignone ci-deflus défi-
gnée , qui d vnné l’Ebène verd.
5- Ebène roigc. On ne connoît pas encore
l ’arbre qui p f j :uit ce bois , quoiqu’il exifle,
' Agricu'ture. Tome 1 V»
depuis quelques temps, dans le commerce, &
qu’il fl fit très-eftimé pour les ouvrages de mar-
quéterie & de tour.
6. Ebène de crête. C’efl un a rb ri fléau qui a
étérapproché dugenredes A nti-iyl lides. Voye\
ce mot.
7. Ebène des Alpes. Arbrifleau, & même petit
arbre, du genre des City fes,- dont le bois efl dur,
veiné de verd , & très-efiimé pour la marqué-
terie & les ouvrages de tour.
8. Ebène de montagne. On donne ce nom , e t
Amérique,.au bois de la Banhine acuminée , qui
efl veiné de -noir & rrès-dur.
Enfin on a trouvé un moyen de colorer en noir
le Poi ier , & de lui donner l’apparence de
l’Ebène : pour cet effet, on l’imprègne Tune
décoélion chaude de Noix de Galles ; & , lorfqü’il
efl feç, on le polit avec de la cire. Voye; , au
Dictionnaire des Arts, les détails de cette manipulation.
( L. R e y n ie r . )
EBÉNIER, E b en o x y l vm . Lour.
Loureiro, qui a vu cet arbre dans fes voyages*
en forme un nouveau genre dans la clafle artificielle
de Linné , Dioécie Triandrie. Le caractère
générique, qu’il lui attribue, efl de manquer
de calice & d'avoir une corolle tripérale ou
neÇïaire , difpofé en -étoile , un Aile & une baie
qui renferme trois graines.
1. Ebène noir. O mouk , U-muen-mâ des Chin
o is , Caju-arang d e s M a la is .
Ebenoxylum veum. Lour. Ï} Des forêts de
la Cochinchine , fiatées vers le onzième degré
Nord , près du pays de Carabe je ; à Àmboine
& autres pays, fous la même latitude.
C’efl un grand arbre droit , un peu angulaire,
à côtes nrefque fai liantes près des racines;
fes ram aux s’élancent en haut ; l’éçorce efl
rude, d’un vert brun ; l’aubier blanc & lourd ,
veiné de raies noires, qui font d’autant plus fréquentes
, qu’il efl plus voifin du bois; ce dernier
efl noir & d’une plus grande pefctueur
Les feuilles font d’une confidence dure , glabres,
lui f an tes, entières, d’un verd brun , anqnel fe
mêlent des taches brunes., lorfque les arbres
font un peu vieux. Les fieirs, font blanches,
cifpofées en bouquets terminaux. La baie efl
orangée ,• ovale , fa pulpe efl douce, mais extrêmement
afiringéme.
Cuhure. Cer arbre n’efl connu que par les rapports
de Loureiro & de Rumphc? ; on'ne fait
rien de la cuhure qu’il exigeroit dans nos Jar-
ins. Là chaleur des. régions qu’il habite force—
roii à le cultiver dans la ferre chaude ,o ù il ne
ferait qu’un objet de curiofifé ;,càr il n’y acquerrait
jamais un volume allez grand pour y
être > utile aux déinor.fli arions Botaniques. Loureiro
obfer« e , d’après, ces expériences , que la
déwoélion de ce bois efl utile pour rempiaeer le
T