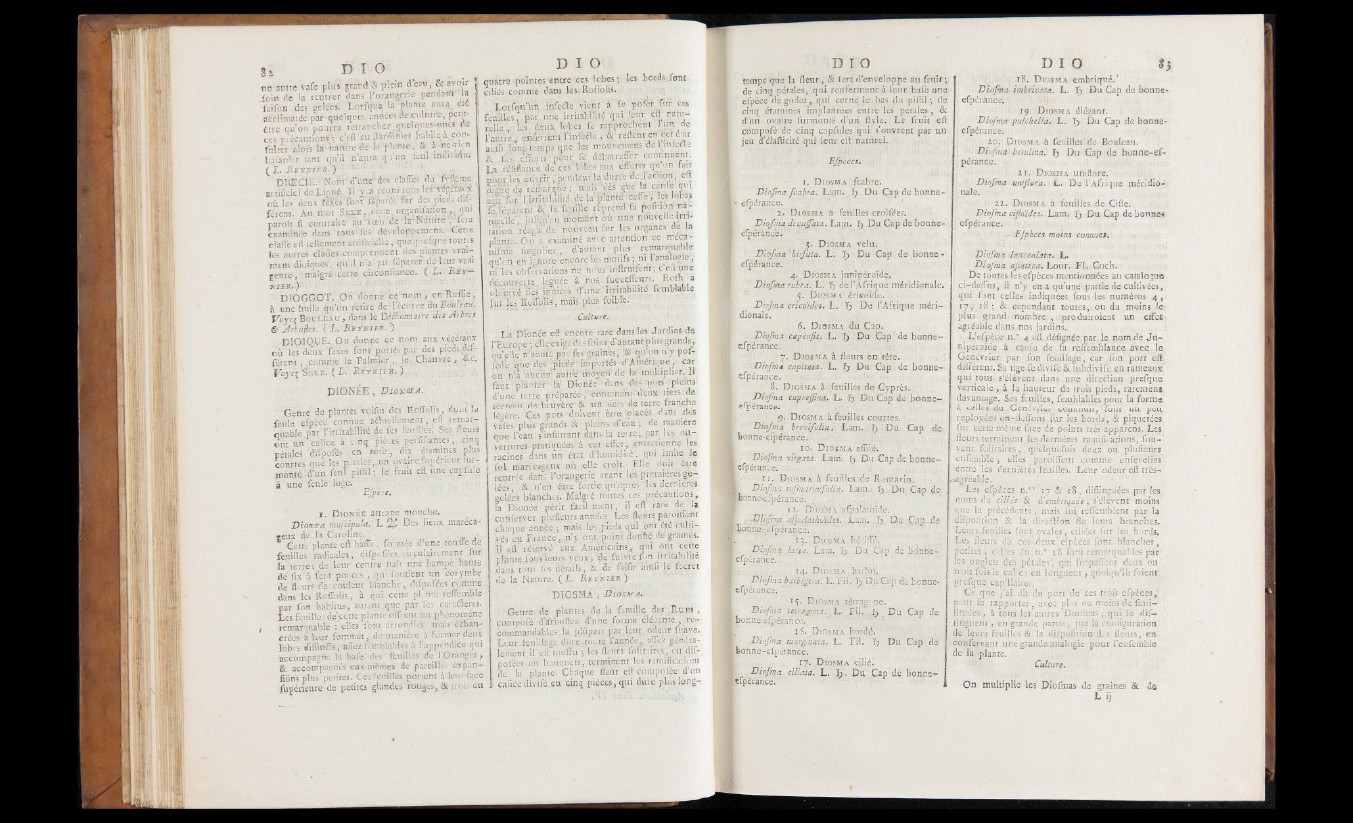
t i D I O
no autre rafc plus grand & plein c ir e r a ,& « o ir J
foin de la rentrer dans l’orangerie pendant la
■ faifon des gelées” Lorfque la plante aura été
acclimatée par quelques anRéés-déeCtilture, peut-
être qu’on pourra retrancher ^uelmessines' de
ces précautions’ -, c’éftau Jarchnier habile a con-
ftlte r alors la-nartïre dé 4a $te*W,-8t 4»ne%içn
liafarder tant qu’il n’aura cju’unUeul- individu;
(X . R e y x i ê é . ) ' : 1 1
DKEC1E:- NomJ d'unif dés clafles du ' fyftéme
artificiel de Linné. 11 v.a.réiinj tons lerVégétà’^
où les deux féxës fonf léparés- for des pieds dit-
férens. Au mot Sexe cette,qrgam&tion. ^ qui
paroît 11 contraire'' au -voeu' .de“là Nature , lera
examinée dans toùs 'fes dévelop’pemensf Cette
1 clalTe eil tellement artificielle, quelpoelqne routés
les autres clàfl'es comprennent des plantes vrai .
ment diolqnes, qu'il n’a pu féparer de leur vrai
genre1, malgré cette ciicomiance. ( -m* R y ÿ -
jiiER.y ' ■ ' ' : - ‘ '' ; ; V’
DIOGGOT. On donne ce nom, en Faifie,
à une huile- qu’on retire de’’l’écorce du Bouleau,
V o y e i Bo u l e a u , dans le V i s io n n a i r e d e s A i b r e s
e- A r b u f t e s . [ L . RÉriviEit. i) ‘ 1
DIOJQUE. On donne ce nom aux végétaux
où les‘deux 'fixes font portés par“ des pieds dif-
férens, comme le Palmier, _î.e, Chanvre ,.
Voyei 'SeîvE. ( Xi Re rWi i s , ). U
DIONÉE , ViodrOEA.
Genre de plantés voifin des Roffo'lit, dont la
feule efp.ècé connue actuellement, eil remar-
ouable par l’irritabilité de lés .feuilles. Ses fleurs
ont un calice à cinq pièces gelfifiantes, .cinq
pétales difpofés en r«fe, dix étamines plus
iourtes que tes pétales1, un ovaire fupéneur fur-
monté': d'un feul piflii ; le fruit eft une capfule
à une feulé‘ loge. ;
I . Dionée attrape mouche.
V i o n æ a m u fc ip u la . L 2p Des lieux marécageux
de la Caroline. . rr i
Cette plante eft baffe, formée d’une touffe de
feuilles, radicales, difpofées. çirculairement fur.
Ta têrre; de leur centre naît une hampe haute
de fix à fept ponces ., .qui foutiest un cqrymbe
dé fleurs-de couleur blanche, difpofées comme
dans les Roffolis, à qui cette pl me reffemble
par fort habitus, autant que par fes.,caractères.
Les feuilles de'cette plan te offrent un. phénomène
, remarmable : elles font arrondies, mais échàn-
crées à leur Commet, de'manière ï former deux
lobes diftinéls , affez fètnblables i l’appendice qui
accompagne la bafe des feuilles de 1 Oranger,
& accompagnés eux-mêmes de pareil lès expansions
plus petites. Ces feuilles portent à leur face
fugérieure de petites glandes rouges-, & trois ou
D I O
quatre pointes entre ces lobes; les bords,font
ciliés comme dans les. Roflolis.
Lorfqu’ùn .infeéle vient ù fe pofér fur cos
feuilles par ‘une irritabilité qui iptrr çfl nàçu-
nèile les, deux lobés fe rapprochent. 1 un de
r a p l i enferrent l’infèae , Sirefteht en cet.état
aufli long-temps que les moüyemens de I mleéte
&.fcs, efforts.pour fe débarraffer commirent.
La .rèuftance, (Je ç t ç m t e aux efforts qu’on fait
potir les ouvrir . pendant la dnrte de 1 aélttin, e.l
digne de'rçpwrque ; mais dès que h came qm
aî’U fur' l'irritabilité-dé la épiante celle, les lobes
C T S l f f g » réprend fa pofi'iop na-
tuidle’, jufôù’.-ü niom'ént où une nouvellei ïrri-
tàiion réagit'de nouveau fur lés‘organes de la
plante. Oh à examiné avec attention ce méca-
nifme fingulier, d’autant plus remarquable
qu’en en ignore-encore tés motifs ; ni 1 analogie,
ni les obfërvàtions ne nous inftruifent, c eft une
découverte.. léguée à. nos : fucceffeurs. Roth a
ôferÿ.é des1.indices d’une * irritabilité femblable
fur les RiofloliS, mais plus foible.
La Dionée eft - encore rare1 dans les Jardins de
l'Europe ; elle exigédesfoins-d’autant plus grands,
qu’elle" n’abutè pas fes-grainés,qu'on n’ypof-:
fëde que des pieds-împVtés ■ d’Amérique , car
on ;h*a: aiiciin' aiùfé iiiôÿen dé là*;multiplier. Il
fsut planter là' Dionée daiis^des "pots pleins
d’une terre préparée’^édiîtèriant -deitx1 tiers, de
tërrèatt de bruyère- & un tiers de terre frat\che
légère. Ces- pots doivent.être, .placés dans des
vafes plus grands &• pleins d’eau -, „"de manière
que l’eau s’infiltrant dans'là terre-, par les ouvertures
pratiquées :à :cet effet , entretienne les
racines dans un état d’humidiîé', qui imite le
| fol marécageux ou elle croît. Ehe doit être
rentrée-dans d'orangerie, avant les premières gelées
v &- n’en être (ortie qu’après ;les dernières
gelées blanches. Malgré toutes ces précautions,
la Dionée périt facilement, il eft rare de la
conferver plufienrs années^ Les fie tirs paroiffent
chaque année ) mais les-pi^ds qui ont été cultivés
en France, n’y ont point donfié. dé grainës.
Il eft réfervé aux Américains^; qui ôni cette
. plante fous leurs yeux, de fu;vre,,fm irritabilité
• dans tous' fes clétaiïs, & dé fàifir'airifi lè CeCÎét
I de la Nature. ( F . R e y n i e r )
DI O SMA , D io sm j .
Genre de plantes dç la'famille des,..Rues ,
çoiîipofé "darbuftes; d une forme élqgaqfe., ^recommandables';
la plupart parieur odejir fuàve.
Leur feuillàg.é diure^-toi. te l’aonèe^ affez généra-
. ' lement il eft touffu *, les fteürs folitaire^ ou dif-
- pofées en bouquets, terminent lès rariiificatiohs
de la plante. Chaque fleùr eft compo.fée d’un i calice divifé pn cinq pièces, qui dure plus long-.
D I O
temps que la fleur, & (ert d’enveloppe au fruit*,
de cinq pétales, qui renferment à leur bafe une
efpèce de godet, qui cerne le. bas du piftil ■ de
cinq étamines implantées entre lés pétales, &
d’un ovaire furmonté d’un ftyle. Le fruit eft
compofé de cinq capfules qui s’ouvrent par. un
jeu d’élafticité qui leur eft naturel.
E J p è c e s .
i. Diosma feabre.
D io fm a f ca b ra < Lam. ï> Du Cap de bonne-
■- efpérance:
i. Diosma à fetiillés croifées.
D i o fm a d e q u jfa ta . Lapi. ï> Du Cap de bonne-
I efpérànce. ’
Diosma velu.
D io fm à \ h ir fu ta . L. ï) Du Cap de bonne -
efpérance.
4. Diosma junipéroïdé.
D io fm a ru b ra . L. de l’Afrique méridionale.
5. Diosma érieoïde. -
D io fm a e r i c o id e s . L. ï> De l’Afrique méridionale.
6. D iosma du Cap.
D io fm a c e p e n fîs . L. ï) Du Cap dé bonne-
efpérance.
7. Diosma à fleurs en tête.
D io fm a c a p ita ta , h . î ) Du Gap de bonne-
efpérance.
■ 8. Diosma à feuilles dé Cyprès.
D io fm a cu p r e jjîn a . L. ï> Du Cap de bonne-
cfpérançe.
9. Diosma à feuilles courtes. :
D io Jm a b r e v i f o l ia . Lam ..il) Du Cap de,
bo n ne-efp érà nee.
ïo. Diosma effilé; • .
D io fm a v irg a ta . Lam. Du Cap de b.onne-
1 efpérance. ...
11. Diosma à Feuilles.de Rornarin.;
K D io fm a r o fm a r in ifo lia . Lam. fj Du Cap.de
|bonne-efpérance.s , r . '
ï 2. Diosma àfpalatoîde.
-D io fm a a fp a la th ù ïd t s . Lam. F>. Du Cap.,de
fbonnerrelpérance. '
L _ 13. Diosma'hëçiffé.'’
I D io fm a lù n a . Lam. T) Du Cap de bonne-
lefpérance.'-
14. Diosma barbu,
; D io fm a barbige ra . L.Fil. Ç'DuCap de bonne-
; efpérance.
15. Diosma tétragone.
L D io fm a te tra g o p a . L. Fil. Du Cap de
Ibor.neefpéiance^ ‘ ■ - ‘ !
16. Diosma bordé.
D io fm a m a rg ln ata . L. Fil. ï) Du Cap de
. bonne-efpérance.
17. Diosma cilié.
D i o fm a c i lia ta . L. Ij. Du Cap de bonne-
fefpérancèi (
d 1 O
18. Diosma embriqué.1
Diofma imbricata. L. Ï7 Du Cap de bonner
efpérance,
; 19. DrosMA élégant.
Diofmfl. pulckella. l-i. F> Du Cap de bonnei
efpérance.
20. Diosma à feuilles de Bouleau.
Diofma betulina. Du Cap de boune-ef-
■ p.érance. ;
2i. Diosma uniflore.
Diofma unifiera. L. De l’Afrique méridionale.
! 22. Diosma à feuilles, de Cifte,
Diofma cifioides. Lam. f> Du Cap de bonnet
. efpérance;
- EJphces moins connues.
Diofma lanceolata. L.
Diofma -afiàticfl: Lour. FL. Coch. ■
De toutes les efpèces mentionnées au catalogué
: ci-deffus,. il n’y en a qu’une partie de cultivées,
qui font celles indiquées fous les numéros 4 „
17,' 18 ; & cependant toutes, ou du moins le
plus- grand nombre , r produlrpient un effets.
agréable dans nos jardins.
L ’elpèce n.° 4 eft..désignée par le nom de Ju -
! nipéroïde à caufe, de fa reffemblance avec le
Genévrier par fon feuillage, car ion port eft
différent. Sa tige fedivife oc (ubdivife en rameaux
qui tous s'élèvent -dans une direction prefque
verticale, à la hauteur de trois pieds, rarement
: davantage. S,es feuilles, femblables pour la forme
\ à celles du. Genévrier--commun, font un pe^u
; reployèes en-deftbus fur les b or d ï, & piquetées
j fur cette même face de points très apparens. Les
| fleurs terminent les dernières ramifications, fou-
1 vent, folitaires, . quelquefois deux ou ptufieurs
enfemble -, elles' paroiffent comme enfevelies
entré les dernièrés feuilles. Leur odeur eft très-
«sCgréable.
Les -efpëeës n.os "17 & 18, diftinguées parles
noms de ciliée & à'embriquée , ; s’élèvent moins
que la précédente, .mais lui. reffemblent par la
difpodtion & la'direflion de leurs branches.
Leurs,feuilles fort ovales, ciliées fur les bords.
Les fleurs dé. ces deux , efpèces font, blanches,
petites ; celles du n.° 18 font remarquables par
les onglets des pétales , qui furpaffent deux ou
rrois fois le calice en longueur, quoiqu’ils foient
prefquè capillaires. " '
Cè que* j’ai dit du port de ces trois efpèces|
peut fe rapporter, avec plus ou moins de fimi—
iitiidëÿi, à tous les autres Diofmas, -qui fe dif-
tihguént, en grande partie, par là configuration
de leurs feuilles & la difpofition des fleurs, en
cônfervant une grande analogie pour l’enfemble
de la plante.
Culture.
On multiplie les Diofmas de graines & dé
L ij