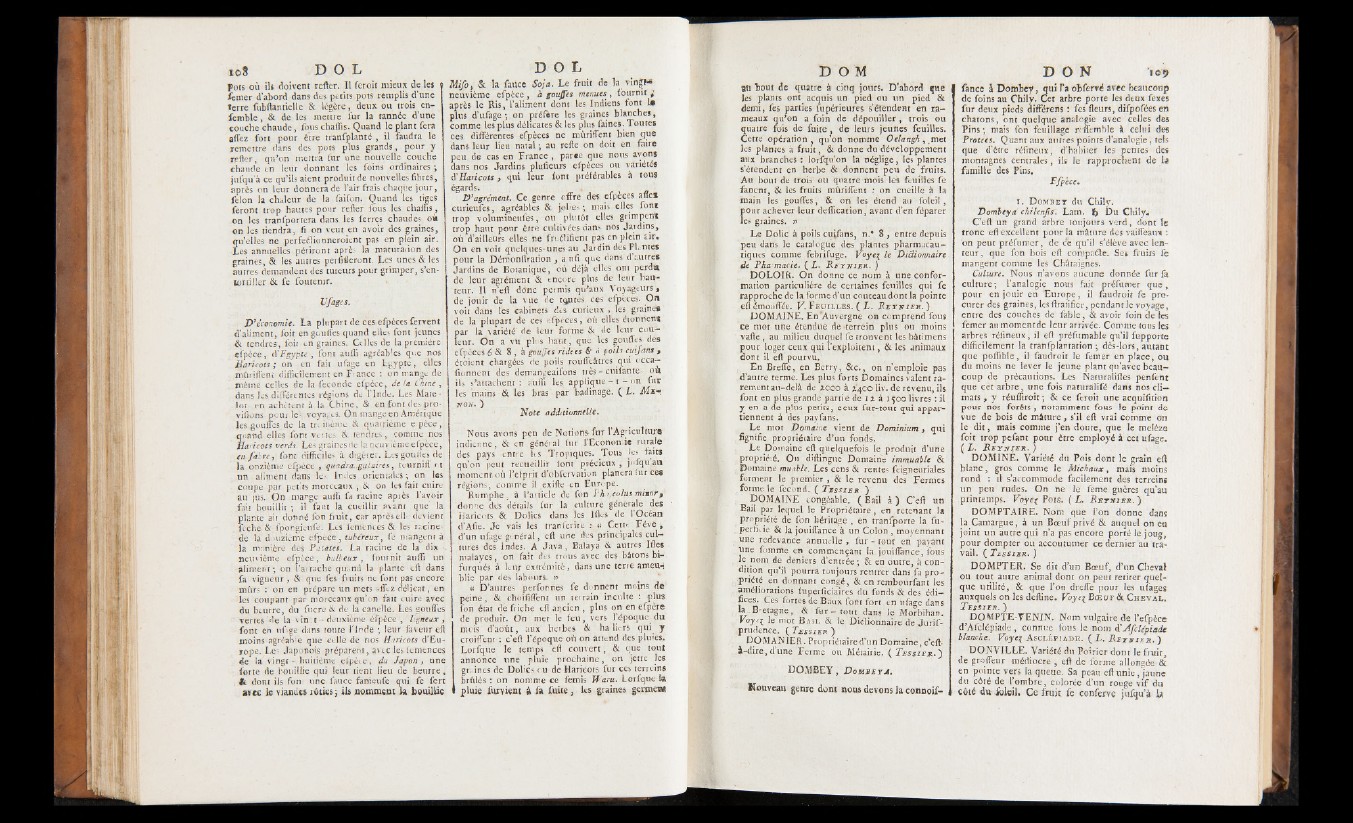
io8 D O L
pots où ils doivent refter. Il feroît mieux de les
femer d’abord dans des petits pots remplis d’une
terre fubftantielle & légère, deux ou trois tn-
femble, & de les mettre fur la tannée d’une
couche chaude, fous chalfis. Quand le plant fera
affez fort pour être tranfplanté , il faudra le
remettre dans des pots plus grands, pour y
relier, qu’on mettra fur une nouvelle couche
chaude en leur donnant les foins ordinaires ;
jufqu'à ce qu’ils aient produit de nouvelles fibres,
après on leur donnera de l’air frais chaque jour,
félon la chaleur de la faifon. Quand les tiges
feront trop hautes pour refier fous les chaflïs,
on les tranfportera dans les ferres chaudes où
on les tiendra, fi on veut en avoir des graines,
qu’elles ne perfeélionneroient pas en plein air.
Les annuelles périront après la maturation des
graines, & les autres perfifleront. Les unes & les
autres demandent des tuieurs pour grimper, s'entortiller
& fe foutenir.
V f âge s.
D ’ économie. La plupart de ces efpèces fervent
d’aliment, foit en gonfles quand elles font jeunes
& tendres, foit engraines. Celles de la première
efpèce, d'Egypte , font aulli agréah’es que nos
Haricots ,* on en fait ufage en Egypte, elles
mûriffent difficilement en Fiance : on mange de
même celles de la fécondé efpèce, delà Chine, >
dans les différentes régions de l’Inde. Les Matelot
en achètent à la Chine, & en font des prov
ie n s pour le'- voyages. On mange en Amérique
les gouffes de la tri même & quatrième ep è ce ,
quand elles font vertes &. tendres, comme nos
Haricots verds. Les graines de la neuvième efpèce,
en faire y font difficiles à digérer. Les goulies de
la onzième efpèce , quadra..guiaires, rournifl r t
un aliment dans le.*- Indes orientales*, on les
coupe par petits morceaux , & on les fait cuire
au iùs. On mange aufli fa racine après l’avoir
fait bouillir ; il faut la cueillir avant que la
plante ait donné fon fruit, car après elle devient
fèche-& fpongieufe. Les femences & les racine-
de la douzième efpèce , tubéreux, fe nlangent à
la manière dés Patates. La racine de la dix ■.
neuvième efpèce, bulbeux, fournit aufli un
aliment; on l’airache quand la plante eft dans
fa vigueur , & que fes fruits ne font pas encore
mûrs : on en prépare un mets affez délicat, en
les coupant par morceaux qu’on fait cuire avec
du beurre, du fucre & de la canelle. Les gouffes
vertes de la vin t - deuxième éîpèce , ligneux ,
font en uftge dans route l'Inde y leur faveur eft
moins agréable que celle de nos Haricots d’Europe.
Les Japonois préparent, avec les femences
de la vingr - huitième efpèvè, du Japon, une
forte de bouillie qui leur tient lieu de beurre,
& dont ils fon' une fauce fameufe qui fe fert
avec k viandes rôties ; ils nomment k bouillie
D O L
Mifo, & la fauce Soja. Le fruit de la vingf*
neuvième efpèce , h gouffes menues , fournit *
après le Ris, l’aliment dont les Indiens font k
plus d’ufage ; on préfère les graines blanches,
comme les plus délicates & les plus faines. Toutes
ces différentes efpèces ne mûriffent bien que
dans leur lieu natal ; au relie on doit en faire
peu de cas en France, parte que nous ayons
dans nos Jardins plufieurs efpèces ou variétés
d'Haricots > qui leur font préférables à tous
égards* .
D ’ agrément. Ce genre offre des efpèces aflei
curieufes, agréables & jolie*; mais elles font
trop volumineufes, ou plutôt elles grimpent
trop haut pour être cultivées dans nos Jardins,
où d’ailleurs elles ne fruélifient pas en plein sir*
On en voit quelques-unes au Jardin des PLntes
pour la Démonflration , a nfi que dans d’autres
Jardins de Botanique, où déjà elles ont perdta
de leur agrément & encore plus de leur hauteur.
Il n’eft dône permis qu’aux Voyageurs ,
de jouir de la vue de tqjnes ces efpèces. On
voit dans lès cabinets des curieux , les graines
de la plupart de ces efpèces, où elles étonnent
par la variété de leur formé & de leur couleur.
On a vu plus liant, que Tes gonfles des
efpèces 6 & 8 , à gou'fes ridees & à poils eu i f a n s >
étoient chargées de poils roufleâtres qui occa—
fionnent des demangeaifons très - ciblante- où
ils s’ attachent : aufli les. applique - t - on fur
les mains & les bras par badinage. ( L . M s~
NON, )
Note additionnelle.
Nous avons peu de Notions-fur 1 Agriculture
indienne, & en général lur [’Economie rurale
des pays entre fis Tropiques. Tons les faits
qu’on peut recueillir lont précieux, jufquati
moment, où l’efprit d’oblervation planera fur ces
régions; comme il exifte en Europe.
Rttmphe, à l’article de fon Fh i,eolus minor,
donne des détails fur la culture générale des
Haricots & Dolics dans les lflcs de l’Océan
d’Afie. Je vais les tranfcriie : u Cette Févè -9
d’un ufage général, eft une des principales cultures
des Indes. A Java, Balaya & autres Ifles
malayes, on fait des trous avec des bâtons bi-
furqués à leur extrémité , dans une terre ameuH
blie par des labours, n
« D’autres perfonnès fe donnent moins de
peine, & choififfent un terrain inculte : plus
fon état de friche cfi ancien , plus on en efpère
de produit. On' met le feu, vers l’époque^du
mois d’août, aux herbes & ha liers qui y
croiffem : c’eft l’époque où on attend des pluies.
Lorfque le temps eft couvert, & que tout
annonce une pluie prochaine, on jette les
graines de Dolics ou de Haricots fur ces terreins
brûlés : on nomme ce femis W'aru. Lorfque la
pluie furviem à fa fu ite , les graines germenâ
D O M
au bout de quatre à cinq jours. D’abord que
les plants ont acquis un pied ou un pied &
demi, fes parties Supérieures s’étendent en rameaux
qu’on a foin de dépouiller, trois ou
quatre fois de fuite , de leurs jeunes feuilles.
Cette opération , qu’on nomme Oelangh, mot
les plantes à fruit, & donne du développement
aux branches : lorfqu’on la néglige, les plantes
s’étendent en herbe & donnent peu de fruits.
Au bout de trois ou quatre mois \ei feuilles fe
fanent, & les fruits mûriffent : on cueille à la
main les gouffes, & on les étend au foleil,
pour achever leur déification, avant d’en féparer
les graines. »
Le Dolic à poils cuifans, n.* 8 , entre depuis
peu dans le catalogue des plantes pharmacau-
tiques comme fébrifuge. Voye[ le Diâionnaire
de Pharmacie. (X . Re ynie r . )
DOLOIR. On donne ce nom à une conformation
particulière de certaines feuilles qui fe
rapproche de la forme d’un couteau dont la pointe
eft ëmooffée. V. F euilles. ( X. Re y n ie r . )
DOMAINE. En'Auvergne ou comprend fous
ce mot une étendue de ‘terrein plus ou moins
vafte , au milieu duquel fe trouvent les bâtimens
pour loger ceux qui l’exploitent, & les animaux
dont il eft pourvu.
En Breffe, en Berry, & c ., on n’emploie pas
d’autre terme. Les plus forts Domaines valent rarement
au-delà de zeoo à 24CO liv. de revenu, ils
font en plus grande partie de 1 1 à 1500 livres : il
y en a de plus petits, ceux fur-tout qui appartiennent
à des payfans.
Le mot Domaine vient de Dominium y qui
fignifie propriétaire d’ un fonds.
Le Domaine eft quelquefois le produit d’une
propriéié. Ou diftingue Domaine immuable &
Domaine muable. Les cens & rentes feigneuriales
forment le premier , & le revenu des Fermes
forme le fécond. ( Tes sier )
DOMAINE congéable. ( Bail à ) C’eft un
Bail par lequel le Propriétaire, en retenant la
Propriété de fon héritage , en tranfporte la fu-
perfiiie & la jouiffance à un Colon , moyennant
une redevance annuelle , fur - tout en payant
une fomme en commençant la. jouiffance, lous
le nom de deniers d’entrée; & en outre, à condition
qu’il pourra toujours rentrer clans fa propriété
en donnant congé, & en rembourfant les
améliorations luperficiaires du fonds & des édi-
fiees. Ces fortes de Baux font fort en ufage dans
la Bretagne, & fur - tout dans le Morbihan.
Voyei le mot B ail & le Diélionnaire de Jurif-
prudence. ( Tessier )
DOMAIN 1ER. Propriétaire d’ un Domaine, c’eft-
i-d ire ,d ’une Ferme ou Métairie. { T es sier. )
DOM B E Y , D ombey Jt.
Nouveau genre dont nous devons la connoif- ,
D O N T 09
fance à Dombey, qui Ta obfervé avec beaucoup
de foins au Chily. Cet arbre porte les deux fexes
fur deux pieds différens : fes fleurs, difpofées en
chatons, ont quelque analogie avec celles des
Pins ; mais fon feuillage r<ffemble à celui des
Protêts. Quant aux autres points d’analogie, tels
que d’être réfineux, d’habiter les pentes des
montagnes centrales, ils le rapprochent de la
famille des Pins.
Ffpèce.
t . D ombey du Chily.
Dombey a chilenfs'. Lam. f> Du Chily*
C’eft un grand arbre toujours verd, dont îe
tronc eft excellent pour la mâture des vaiffeàux :
on peut préfumer, de ce qu’il s’élève avec lenteur,
que fon bois eft conjpaéle. Ses fruits fe
mangent comme les Châtaignes.
Culture. Nous n’avons aucune donnée fur la
culture; l’analogie nous fait préfumer q ue ,
pour en jouir en Europe, il fàudroit fe procurer
des graines, les ftratifier, pendantle voyage,
entre des couches de fable, & avoir foin de les
femer aumomentde leur arrivée. Comme tous les
arbres réfineux, il eft préfumable qu’il fupporte
difficilement la tranfplantation ; dès-lors, autant
que polfible, il fàudroit le femer en place, 011
du moins ne lever le jeune plant qu’avec beaucoup
de précautions. Les Naturaliftes penfent
que cet arbre, une fois naturalifé dans nos climats
, y réufliroit ; & ce feroit une acquifition
pour nos forêts, notamment fous le point de
vue de bois de mâture s s’il eft vrai comme on
le dit, mais comme j’en doute, que le melêze
foit trop pefant pour être employé à cet ufage.
( X. R e y n ie r . )
DOMINÉ. Variété du Pois dont le grain eft
blanc, gros comme le Michaux, mais moins
rond : il s’accommode facilement des terreins
un peu rudes. On ne le feme guères qu’au
printemps. Voyeç Pois. (L. Re ynie r . )
DOMPTAIRE. Nom que Ton donne dans
la_Camargue, à un Boeuf privé & auquel on en
joint un autre qui n’a pas encore porté le joug,
pour dompter ou accoutumer ce dernier au travail.
( Tessier. )
DOMPTER. Se dit d’un Boeuf, d’un Cheval
ou tout autre animal dont on peut retirer quelque
utilité, & que l’on dreffe pour les ufages
auxquels on les deftine. Voye[ Boeuf & C h ev a l .
T essier. )
DOMPTE-VENIN. Nom vulgaire de l’efpèce
d’Afelépiade, connue fous le nom d'Afclépiadc
blanche. Voyei A sclépiade. ( X. R e y n ie r . )
DONVILLE. Variété du Poirier dont le fruit,
de groffeur médiocre , eft de forme allongée &
en pointe vers la queue. Sa peau eft unie, jaune
du côté de l’ombre, colorée d’un rouge v if du
côté du ibleil. Ce fruit fe conferve jufqu’à k