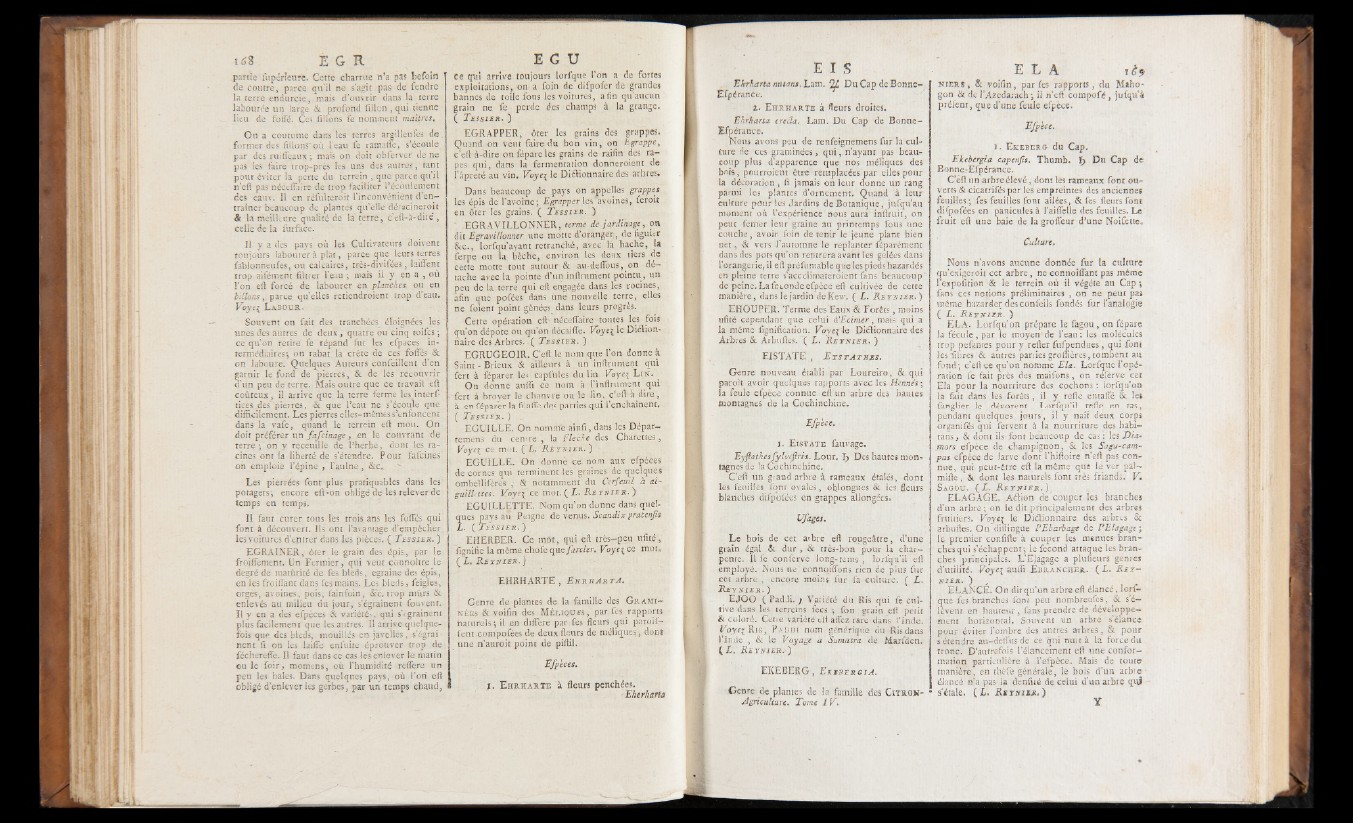
partie fupérîeure. Cette charrue n*a pas befoin
de coutre, parce qu’il ne s’agit pas-de fendre
la terre endurcie, mais d’ouvrir dans la terre
labourée uq large & profond fillcn , qui tienne
lieu de foffé. Ces filions fe nomment maîtres.
On a coutume dans les terres argilleufes d e .
former des filions" où l’eau fe ramafl'e, s’écoule
par des ruI(féaux ; mais on doit obferver de ne
pas les faire trop-près les uns des autres, tant
pour éviter la perte du terrein , que parce qu’il
n'eft pas néceflaire de trop faciliter l’écoulement
des eaux. Il en réfulreroit l’inconvénient d’entraîner
beaucoup de plantes quelle déracineroit
& la meilleure qualité de la terre, c’eft-à-diié,
celle de la furface.
11 y a des pays où les Cultivateurs doivent
toujours labourer à plat, parce que leurs terres
fablonneufes, ou calcaires, très-divifées, laiflent
trop aifément filtrer l’eau ; mais il y en a , où
l’on eft forcé de labourer en planches■ ou en
lillons, parce qu’elles retiendroient trop d’eau.
V o y t \ Labour.
Souvent on fait des tranchées éloignées les
unes des autres de deux, quatre ou cinq t-oifes ;
ce qu’on retire fe répand fur les efpaces intermédiaires
; on rabat, la crête de ces foffés &
on labourei Quelques Auteurs confeiflent d’en
garnir le fond de pierres, & de les recouvrir
d’un peu de terre. Mais outre que ce travail -eft
coûteux, il arrive que la terre ferme les in ter f-
tiçes des'pierres, & que l’eau-ne s’écoule que
difficilement. Les pierres elles-mêmes s’enfoncent
dans la vafe, quand le terrein eft mou. On
doit préférer un fajcinagt, en le couvrant de
terre; on y receuille de l’herbe, dont les racines
ont ia liberté de s’étendre. Pour fafeines
on emploie l’épine , l’aulne, &c._
Les pierrées font plus pratiquables dans les
potagers; encore eft-on obligé de les relever de
temps en temps.
Il faut curer tous les trois ans les foffés qui
font -à découvert. Ils ont Avantage d’empêchér,
les voitures d’entrer dans les pièces. ( T e s s i e r . )
EGRAINER, ôter le grain des épis, par le
froiffement. Un Fermier, qui veut connoître le
degré de maturité de fes bleds, egraine des épis,
en les froiffant dans fes mains. Les bleds, feigles,
orges, avoines, pois, lainfoin, STc. trop murs &
enlevés au milieu du jour, s’égrainent fouvenr.
Il y en a des efpèces & variété*, qui s’égrainent
plus facilement que les autres. Il arrive quelquefois
que des bleds, mouillés en javelles, s’égrai •
nent fi on les laiffe enfuite éprouver trop de
féchereffe. Il faut dans ce cas les enlever le matin
©u le foir , momens, où l’humidité reffere un
peu les baies. Dans quelques pays, où l’on eft
obligé d’enlever les gerbes, par un temps chaud,
ce qui arrive toujours iorfque l’on a de fortes
exploitations, on a foin de difpofer de grandes
bannes de toile fous les voitures, afin qu’aucun
grain ne fe perde des champs à la grange.
( T e s s i e r . )
EGRAPPER, ôter les grains des grappes.
Quand on vèut faire du bon vin, on E grappe,
c’eft à-dire on fépare les grains de raifin des râpes
qui, dans la fermentation donneroient de
l’âpreté au vin. Voyei le Dictionnaire des arbres.
Dans beaucoup de pays on appelles grappes
les épis de l’avoine; Egrapper\e% avoines, fer oit
en Ôter les grains. ( T e s s i e r . )
- EGR A VIL LONN ER, terme de jardinage, on
dit Egravillonner une motte d’orangéî), de figuier
&c., lorfqu’ayant retranché, avec là hache, la
ferpe ou la bêche, environ les deux tiers de
cette motte tout autour & au-deffous, on détache
avec la pointe d’un infiniment pointu, un
peu de la terre qui eft engagée dans les rocines,
afin que pofées dans une nouvelle terre, elles
ne foient point gênées dans leurs progrès.
Cette opération eft1; néceflaire toutes les fois
qu’on dépote ou qu’on décaifl'e. Voyei le Dictionnaire
des Arbres. - ( T e s s i e r . )
EGRUGEOIR. Ç’e ftle nom que l’on donne à
Saint-Brieux & ailleurs à un infiniment qui
fert à féparer le* capfules du lin Voyei L in. ^
On donne aufli ce nom à l’infirument qui
- fert à broyer le chanvre ou le lin, c ’eft-a dire,
à en féparer la filaffe des parties qui l’enchaînent.
( T e s s i e r . )
EGUILLE. On nommé ainfi, dans .les Dépar-
temèns du centre., la Fléché des Charettes,
V o y e i ' c e m o t . Ç L . R è y n i e r . )
EGUILLE. On donné ce- nom aux efpèces
de cornes qui terminent les graines- de quelques
ombellifères , & notamment du Cerfeuil a aiguillettes.
Voye f ce mot. ( L. R e y n i e r . )
EGUILLETTE. Nom qu’on donne dans quelques
pays au Peigne de venus. Scandix pratenjis
L. ( T e s s i e r . )
EHERBER. Ce mot, qui eft très-peu ufité,
fignifie la même chofe que farcler. Voye\ ce mot.
( L. R e y n i e r . )
EHRHARTE, E n r h a r t a .
Genre de plantes de la famille des G r am inées
& yoifin des Méliques, par fes rapports
naturels ; il en diffère par fes fleurs qui paroif-
fent com pofées de deux fleurs de méliques, dont
une n’auroit point de piftil.
Efpèces.
I . E h rh a r t e à fleurs penchées.
. . - Eherharla
E I S
Ekrharta muant. Lam. 21 Du Cap de Bonne-
Efpérance.
2. Ehrharte à fleurs droites.
Ehrha.no. erecla. Lam. Du Cap de Bonne-
Efpérance.
Nous avons peu de renfeignemens fur la culture
de ces graminées, qui, n’ayant pas beaucoup
plus d’apparence que nos méliques des
fo^is, peurroient être remplacées'par elles pour
la décoration , fi jamais on leur donne un rang
parmi les plantes d’ornement. Quand à leur
culture pôur les Jardins de Botanique, jufqu’au
moment où l’expérience nous aura inflruit, on
peut femer leur graine au printemps fous une
couche, avoir foin de tenir le jeune plant bien
net, & vers l’automne le replanter féparément
dans des pots qu’on rentrera avant les gelées dans
l’orangerie, il eft préfumable que les pieds hazardés
en pleine terre s’accclimateroient fans beaucoup’
de peine. La fécondé efpèçe eft cultivée de cette '
manière, dans le jardin de Kew. ( L. R e y n i e r . )
ËHOUPER. Terme des Eaux & Forêts, moins
ufité cependant que celui à’Ecimer, mais qui a
la même lignification. Voyel le Dictionnairedes
Arbres & Arbuffes.( L. R e y n i e r . )
EISTATE , E y s t a t m e s .
Genre nouveau établi par Loureiro, & qui
paroît avoir quelques rapports avec les Hennés ;
la feule efpèce connue eft un arbre des hautes
montagnes de la Cochinchine.
Efpèce.
i. Eistate fauvage.
Eyflathesfylvcftris. Lour. ï) Des hautes montagnes
de la Cochinchine.
. C’eft un grand arbre à rameaux étalés, dont
les feuilles font ovales, ob.longues & les fleurs
blanches difpbfées en grappes allongées.
Ufages.
Le bois de cet arbre eft rougeâtre, ' d’une
grain égal & dur , & très-bon pour la charpente.
Il fe confervè long-rems , lorlqu’il eft
employé. Nous ne tonnoiffons rien de plus fur
cet arbre , encore moins fur fa culture. ( L.
R e y n i e r . )
EJOO ( Paddi. j Variété du Ris qui fe cultive
dans les terreins fecs ; fon grain eft petit
& coloré. Cette variété eft affez rare dans l’Inde,
j/oyq Ris ,, P AUDI nom générique du Ris dans
l’Inde ., & le Voyage à Sumatra de Marfden.
( L . R e y n i e r . )
EKEBERG, E k m b e r g i a .
Genre de plantes de la famille des Citron- *
Agriculture. Tome 1 V.
E L A 1 ^ 9
n ter s , & voifin, parles rapports, du Maho-
gon & de l’Azedarach ; il n’eft compofé, jufqu k
préfenr, que d’une feule efpèce.
Efpèce.
ï . E k e b e r g du Cap.
Ekebergia capenjis. Thumb. £ Du Cap de
BonnerEfpérance.
C ’éft un arbre élevé, dont lés rameaux font ouverts
& cicatrifés par les empreintes des anciennes
feuilles; fes feuilles font allées, & fes fleurs font
difpofées en panicules à Pai (Telle des feuilles. Le
fruit eft une baie de la groffeur d’une Noifettc.
Culture.
Nous n’avons aucune donnée fur la culture
qu’exigeroit cet arbre, ne connoiffant pas même
I’expofition & le terrein ou il végété au Cap;
fans ces notions préliminaires , on ne peut pas
même hazarder desconfeils fondés fur l’analogie
( X. R e y n i e r . )
ELA. Lorfqu’on prépare le fagou , on fépare
la fécule, par le moyen de l’eau: les molécules
trop pefantes pour y refter fufpendues, qui font
les-fibres & autres parties groffières, tombent au
fond; c’éft c e qu’on nomme EU. Lorfque l’opération
fe fait près des maifons, on réferve cet
Ela pour la nourriture des cochons: iorfqu’on
la fait dans les forêts, il y refte entaffé & les
fanglier le dévorent. Lorfqu’il refte en tas,
pendant quelques jours, il y naît deux corps
organisés qui fervent à la nourriture des habi-
tans, & dont ils font beaucoup de cas: les Dia-
mors efpèce de champignon, & les Sagu-cam-
pas efpèce de larve dont l’hiftoire n’eft pas connue,
qui peut-être eft la même que le ver pal-
mifte, & dont les naturels font très friands. V.•
Sagou. (X . R e y n i e r . ) _
ELAGAGE. À&ion dé couper les branches
d’un arbre; on le dit principalement des arbres
fruitiers. Voye\ le D i c t i o n n a i r e des a r b r e s &
arbuftes. On diftingue VEbarbagc de VElagage\
le premier confifte à couper les menues branches
qui s’échappent; le fécond attaque les branches
principales. L ’Elàgage a plufieurs génies
d’utilité. Voye\ aufli É b r a n c He r . (X . R e y n
i e r . )
ELANCE. On dit qu’un arbre eft élancé, lorfque
fes branches font peu nombreufes, & s’élèvent
en hauteur, fans prendre de développement
horizontal. Souvent un arbre s’élance
pour éviter l’ombre des autres arbres, & pour
s'étendre au-deffus de ce qui nuit à la force du
tronc. D’autrefois l’élancement eft une conformation
particulière à l’efpèce. Mais de toute
manière, en tbèfe générale, le bois d’un arbre •
élancé n’a pas la denfité de celui d’un arbre qui
s’étale. (X . R e y n ie r . ) Y