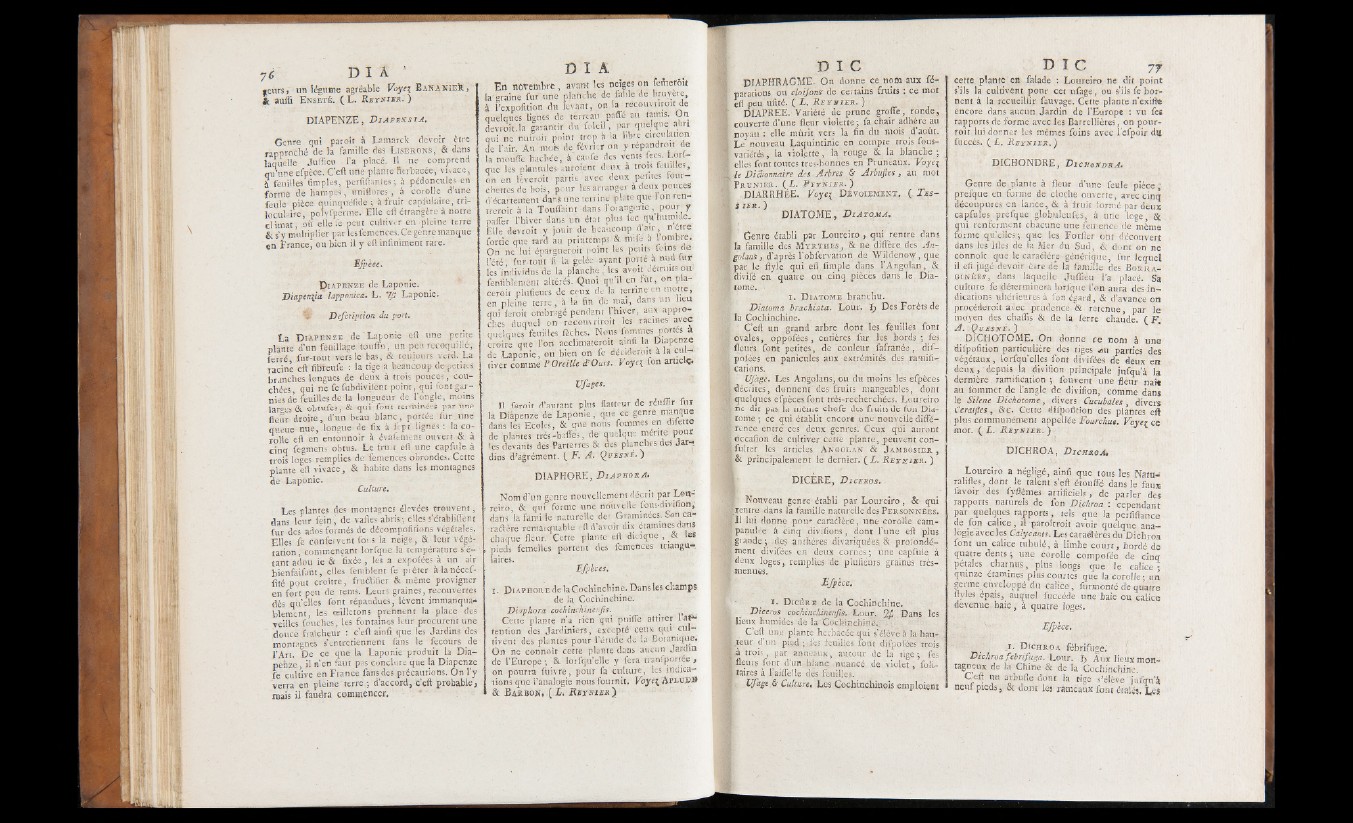
\
jeursj un légume agréable Voyti Ba k a n ie S , J
t e suffi Enseté. ( L. R s y s i i x . ) |
DIAPENZE, Diafxksia.
Genre qui paroît il Lamarck devoir être |
rapproché de la famille des Liserons, & dans
laquelle Juffieu l’a placé. Il ne comprend
qu’une efpêce. C’efl une plante Herbacée, vu ace,
à feuilles (impies, perfifianles; à pédoncules en
fôrme de hampes, uniflores, à corolle d’une
feule pièce quinquéfide ; à fruit capfulaire, tri- 1
loculairé, polyfperme. Elle eli étrangère à notre
climat, ou elle fe peut cultiver en pleine terre
& s’y multiplier par les femences. Ce genre manque
en France, ou bien il y ell infiniment rare.
Efpcee.
Ç iapenze de Laponie.
Diapentfa lappordca. L. *lp Laponie.
% Defctiption du port.
L a D iapen ze de'Laponie eft une petite
plante d'un feuillage, touffu, un peu recoquillé,
ferré, fur-tout vers le bas, & toujours verd. La
racine eft fibreufe : la tige a beaucoup de petites
branches longues de deux à trois pouces, couchées,
qui ne fe fubdivifent poinr, qui font garnies
de feuilles delà longueur de l’ongle, moins
larges & ebtufes, & qui font terminées par Une
fleur droite, d'un beau blanc, portée fur.une
queue nue, .longue, de fix à fepr lignés-, la corolle
eft en entonnoir à évafement ouvert & à
cinq fegmens obtus. Le fruit eft une capfule à
trois loges, remplies de femences obrondes. Cette
plante eft vivace, & habite dans les montagnes
de Laponie.
Culture.
Les plantes des montagnes élevées trouvent,
dans leur fein, de vaftes abris ; elles s’établiffent
fur des ados formés de décompolirions végétales.
Elles fe confervent fous la neige, & leur végétation,
commençant lorfque la température s'étant
adou ie & fixée, les a expofées à un air
bienfaifanr, elles femblent fe prêter à lan é c e f-
fité pour croître, fruélifier & même provigner
en fart peu de tems. Leurs graines, recouvertes
dès qu elles font répandues, lèvent immanquaa
blement, les oeilletons prennent la place des
veilles fouches, les fontaines leur procurent une
douce fraîcheur : c’eft ainfi que. les Jardins des
montagnes s’entretiennent fans le fecours de
l’Art. De ce que la Laponie produit la Diap
r é , il n’en faut pas Conclure que la Diapenze
fe cultive en France fans des précautions. On l’y
verra en pleine terre ; d’accord, c’eft probable,
mais il faudra commencer.
En novembre, avant les neiges on fetberôit
la' graine fur une planche de fable de bruyère,
à l'expofition du levant, on ta recouvrirait de
quelques lignes dé terreau paffé au tamis. On
devrait.la garantir du fole il, par quelque abri
qui ne nuiroit point trop il ia libre circulation
de l'air. An mois de février on y répandroit de
la moufle bâchée, Acaufe des venrs fccs. Lorfque
les plan ml es- àiif oient deux à trois feuilles,
on en lèveroit partie avec deux petites four
chettes de bois, pour les arranger à deux pouces
d'écartement dans une terrine plate que 1 on ren-
trercit à la Touffaint dans l’orangerie , pour y
paffer l’hiver dans un état plus iec qu humide.
Elle devroit y jouir de beaucoup d’a ir , n être
fortie que tard au printemps & nr.fe a 1 ombre.
On ne lui épargnerait point les peins loms de
l’été fur tout fi la gelée ayant porté à nud iur
les individus de la planche , les avoir détruits ou
fenfiblemeut altérés. Quoi qu’il en fû t, on placerait
plufieurs de ceux de la terrine en motte,
en pleine terre, à la fin de mai, dans un lieu
qui ferait ombragé pendant 1 hiver, aux approches
duquel on recouvrirait les racines avec
quelques feuiiles lèches. Nous femmes portés à
■ croire que l’on acclimaterait ainfi la Diapenze
de Laponie, ou bien on fe déciderait a la cultiver
comme VOreille d’ Ours. Voye[ fon aruc Ç,
Ufages.
Il ferait d’autant plus flatteur de réuffir fur
la Diapenze de Laponie, que ce genre manque
dans les Ecoles, & que nous fouîmes en dilette
de plantes très-baffes, de quelque mérite pour
les devants des Parterres & des planches des Jardins
d’agrément. (. F. A. Q u ïs n i. )
DIAPEIORE, D i a p u o x A.
Nom d’un genre nouvellement décrit par Lou-
. reiro, & qui forme une nouvelle fous-divifion,'
dans la famille naturelle des Graminées. Son ca-
raflère remarquable eft d’avoir dix étamines dans
chaque fleur. Cette plante eft dioique , les
i pieds femelles portent des femences triangu-
laires.
Efpèces.
i . Diaphore de la Çochinchine. Dans les champs
de la Çochinchine.
Diapkora cochinchinerijis. •' _ s
Cette plante n’a rien qui puiffe attirer 1
tention des. Jardiniers, excepté ceux qui cultivent
des plantes pour l’étude de la Botanique.
On ne connoîr cette planté dans aucun Jardin
de l’Europe-, & lorfqu’elle y fera tranfportëe *
on pourra fuivre, pour fa culture, les indications
que l’analogie nous fournit. Voye\ ApRU.P®
i & Barbon. (X . )
DIAPHRAGME. On donne ce nom aux fé-
r parafions ou cloi/ons' de certains fruits : ce mot
I eft peu ufité. ( X. R e y n ie r . )
i DIAPRÉE. Variété de prune grotte, ronde,
I couverte d’une fleur violette-, fa chair adhère au
l ' noyau : elle mûrit vers la fin du mois ^d’août. I Le nouveau Laquintinie en compte trois fous-
! variétés, la violette, la rouge & la blanche -,
K elles font toutes tres-bonnes en Pruneaux. Voyei
jf le Dictionnaire des Arbres & Arbufies , au mot
■ P R U N IE R . ( X. E î.YN IER . )
[ DIARRHÉE. Voyei Dévoiement. ( T es- I S 1ER. )
DIA TOM E , D i a tom a.
I Genre établi par Loureiro, qui rentre dans
1 la famille des Myrthes , & ne diffère, des An-
Wgolani} d’après l’obfervation de Wildenow, que
■ par le- ftyle qui eft fimple dans l’Àngoîan, &
i divifé en quatre ou cinq pièces dans le Dia-
|| tome., ■ i. Diatome branchu.
Dialoma brachiata. Lour, Des Forêts de
P la Çochinchine. ,.
i C ’eft un grand arbre dont les feuilles font
» ovales, oppofées, entières fur les bords ; fes
• fleurs font petites, de couleur fafranée, dif-
poféés en panicules aux extrémités des ramifi-
■ carions. L UJhgè. Les Angolans, ou du moins les éfpèces
1 décrites, donnent des fruits mangeables, dont
P quelques éfpèces font très-recherchées. Loureiro
|| ne dit pas. la même chofe des fruits de fon Dia-
i* tome; ce qui établit encor* une nouvelle diffé-
| fence entre ces deux genres. Ceux qui auront
Koccafion de cultiver cette plante, jjeuvent con-
« fulte r les articles Angolan & Jambosier ,
principalement le dernier. (X. R e y n i e r . )
DICÈRE, D iceros.
»■ Nouveau genre établi par Loureiro, & qui
»rentre dans la famille naturelle des Personnées.
ffîll lui donne pou»- caraélère, une corolle cam-
B panulée à cinq divifions, dont l’une eft plus
Ig grande ; -des anthères divariquées & profondé-
Bment divifées en deux cornes ; une capfüle. à
k deux loges, remplies de plufieurs graines très-
M menues.
EJplce.
i. Dicère de la Çochinchine.
, . Dieews cochinchinenfis. Lour. Dans les
■ lieux humides‘de la Cocbinchinë,
I C’eft une plante herbacée qui s’élève à la hau-
Kteur d’un pied,; fés feuilles font difpofées trois
K,à trois , par anneaux, autour de la tige ; les
■ fleurs font d’un blanc nuancé de violet, foli-
■ taires à l’aiffelle dès feuilles. ,
I- .UJdge,& Culture. Les Cochinchinois emploient
cette plante en falade : Loureiro ne dit point
s’ils la cultivent pour cet ufage, ou s’ils fe bornent
à la recueillir fauvage. Cette plante n’exifte
encore dans aucun Jardin de l’Europe : vu fes
rapports de forme avec les Barrellières, on pour-
roit lui donner les mêmes foins avec l ’efpoir du
fuccès. ( X. R e y n i e r . )
DICHONDRE, D i c r o n d r a .
Genre de plante à fleur d’une feule pièce:
prefque en forme de cloche ouverte, avec cinq
découpures en lance, & à fruit formé par deux
cap.fules prefque giobttleufes, à une loge &
qui renferment chacune une femence de même
forme qu’elles; que les Forfter ont découvert
dans les Ifl.es de la Mer du Sud, ,& dont on ne
cônnoît que le caraélére générique, fur lequel
il eft jugé devoir être dé la famille des Boiuia-
gin é e s , dans laquelle Juflîeu l ’a placé. Sa
culture fe (déterminera loiique Ton aura des indications
ultérieures à fon égard, & d’avance on
procéderoit avec prudence & retenue, par le
moyen des chaflis & de la ferre chaude. ( F .
A. Qu es n é . )
DICHOTOxME. On donne ee nom à une
difpofition particulière des tiges Ju parties des
végétaux, lqrfqu’elles font divifées de deux en
deux , depuis la divifion principale jufqu’à la
dernière ramification ; fouvent une fleur naît
au foin met de L’angle de divifion, comme dans
le Silene Dichatome, divers Cucubales divers
Ceraiftes, &c. Cette difpofition des plantes eft
plus communément appellée Fourchus, Voyc\ ce
mot. f X. R e y n i e r . )
DICHROA, DicHRoÀé
Loureiro a négligé, ainfi que tous les Natu-
raliftes, dont le talent s’eft étouffé dans le faux
favoir des fyftêmes artificiels, de parler des
rapports naturels de fon Dichroa. i cependant
par quelques rapports, tels que la perfiftance
de fon calice, il paroîtroit avoir quelque analogie
avec les Calyeants. Les caraâères du Dichroa
font un calice tubulé, à limbe cou rt, bordé de
quatre dents ; une corolle compofée de cinq
pétales charnus, plus longs que le calice •
quinze étamines plus courtes que la corolle ; un
germe enveloppé du calice , furmonté de quatre
ftyles épais, auquel fuccède une baie ou calice
devenue baie, à quatre loges,
Efpece,
J. Dichroa fébrifuge.'
Dichroa febrifuga. -Lour. ï> Aux lieux montagneux
de la Chine & de la Çochinchine.
CAeft un arbufte dont la tige s’élève jufqu’à
neuf pieds & dont les rameaux font étalés» LéS