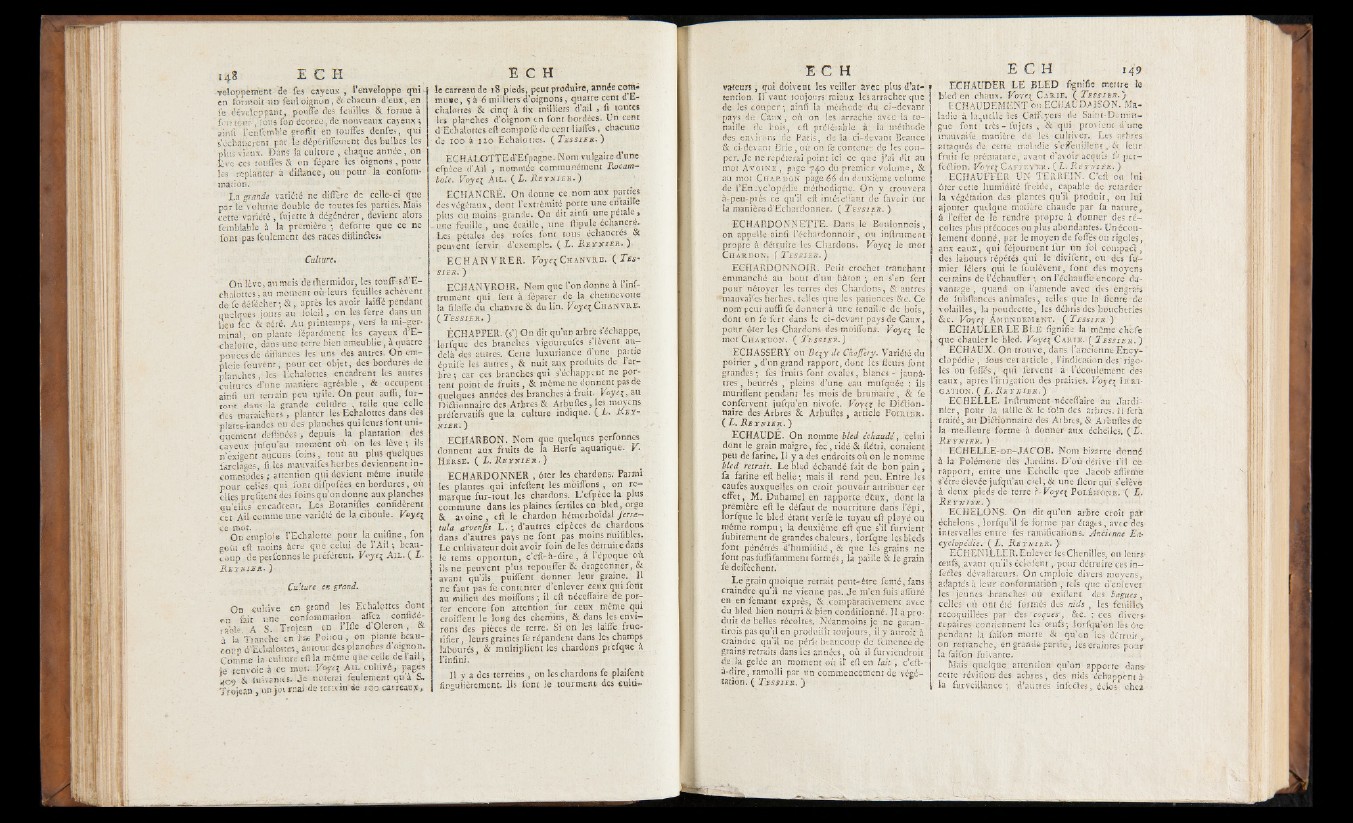
veloppement de fes cayeux , l’enveloppe qui -
en formoii un fenloignon, & chacun d’eux, en
fe, développant, pouffe des feuilles & forme à
f:n tour-, ; ou s fon écorce, de nouveaux cayeux •,
air.fi fenlcmble groffu en touffes denfes, qui
s’échancrent par le dépériffement des bulbes les
plus vieux. Dans la culture , chaque année , on
t v e ces touffes & on fépare les oignons, pour
les replanter à diftance, ou pour la confom-
ination. r
La grande variété ne diffère de celle-ci que
par le volume double de toutes fes parties. Mais
cette variété , lujette à dégénérer, devient alors
femblable à la première ; deforte que ce ne
font pas feulement des races diflin&es.
Culture.
On lè ve, au mois de thermidor, les touffes d’E -
chalottes, au moment où-leurs feuilles achèvent
de fe dé lécher, & , 3Près ies aTO*r laiffé pendant
quelques jours au foleil, on les ferre dans un
lieu f'ec & aéré. Au. printemps, vers’ la mi-germinal,
on plante féparément les cayeux d’E -
chalotte, dans une terre bien ameublie, à quatre
pouces de diflances les uns des antres. On emploiefouvenr,
pour cet objet, des-bordures de
planches, les- Echalottes, encadrent les autres
cultures d’une manière agréable , & occupent
ainft un terrain peu utile. On peut aufli, fur-
tour dans la grande culture , telle que celle
des maraîchers j planter les Echalottes dans des
plates-bandes ou des planches qui leurs font uniquement
deftinées, depuis la plantation des
caveUx jufqu’au moment où on les lève ; ils
n’exrient aucuns foins, tout au plus quelques
iardases, fi les mauvaifes herbes, deviennent incommodes
; attention qui devient même inutile
pour celles qui font difpofées en bordures, où
elles profitent des foins qu’on donne aux planches
qu'elles encadreur. Les Botaniftes confidèrent
cet Ail-comme une variété de la ciboule. Voyez
tGOn>emploie l’Echalotte pour la cuifine , fon
goût eft moins âcre que celui de l’Ail y beaucoup
de perfonîiesle préfèrent. Voyez A;l . ( X.
Re y n ie r . )
Culture. en grand.
On cultive en grand les Echalottes dont
fait une confommation allez coqfîdé-
rad^ A S. Troje^n en i’Ifle d’Ole ron, &
à la Tranche en l:ae Poitou., on plante beau-
cono d’Ecbaloues, autour des planches d’oignon.
Comme la culture efiîa même que celle de l’ail ,
fe renvoie à ce met; Voyez A il . cultivé, pages
, Q9 & iuivantes. Je noterai feulement qu a S.
Trojepn un joi mal de temin de 200 carreaux.
le carreau de 18 pieds, peut produire, année cotn-
mu*e, 5 à 6 miiliers d’oignons, quatre cent d E-
chalortes & cinq à lix milliers d’ail , fi toutes
les planches d’oignon en font bordées. Un cent
d’Echalottes eft compofé de cent liaffes, chacune
de 100 à i i o Echalottes. { T essier. )
ECHALOTTE d’Efpagne. Nom vulgaire d’une
cfpèce d’Ail , nommée communément Rocam-
'bote, Voyez A i l . ( X . Reynier.')
ECHÀNCRÉ. On donne ce nom aux parties
des végétaux, dont l’extrémité porte une entaille
plus ou moins-grande. On dit ainfi une pétale,
aine feuille, une écaille, une flipule échancré.
Les. pétales j 3es rofes font tous échancrés &
pement fervir d’exemple. ( L. R e ynie r . )
E C H A N V R E R . VoyezCh an v r e . ( Tessier.
)
ECHANYROIR.. Nom que l ’on donne à l’inf-
trument qui. fert à féparer de la chenncvorte
la filaffe du chanvre & du lin. Foyq; C hanvrç .
( Tessier. )
ÉCHAPPER, (s’) On dit qu’un arbre s’échappe,
lorlque des branches vigoureufes s’ièverît au-
delà des autres. Cette luxuriance dune partie
épuife les autres, & nuit aux produits de Tar-
bre ; car ces branches-qui s’échappent ne portent
point de fruits, & même ne donnent pas de
quelques années des branches à fruit. Veyez, au
Diaionnaire des Arbres & Arbuftes, les moyens
préfervatifs que la culture indique. (X . R e y nier.
)
ECHARBON. Nom que quelques perfonnes
donnent aux fruits de la Herfe aquatique. V.
Herse. ( X. Re y n ie r . )
ECHARDONNER , ôter les chardons. Parmi
les plantes qui infeftent les moiffons , on remarque
fur-tout, les chardons. L e fp è ce la plus
commune dans les plaines fertiles en bled, orge
& a\ oine , eft le chardon hémprhoïdal ferra-
tula arvenjîs L . -, d’autres efpèces de chardons
dans d’àutres pays ne font pas moins nuiûblès.
Le cultivateur doit avoir foin de les détruire dans
le tems opportun, c’éft-à-dire, â 1 époque ou
ils ne peuvent plus repouffer & drageonner, &
avant qu’ils puiffent donner leur graine. Il
ne faut pas fe contenter d’enlever ceux qui font
au milieu des moiffons -, il eft néceffaire de porter
encore fon attention fur ceux même qui
croiffent le long des chemins, & dans les environs
des pièces de terre. Si on les laiffe. fructifier,
leurs graines fe répandent dans les champs
labourés, & multiplient les chardons prefque à
l’infini.
Il y a des terreins, ou les chardons fe plaifent
finguiièrement. Ils font le tourment des eultirvaleurs,
qui doivent les veiller avec plus d’attention.
Il vaut toujours mieux les arracher que
de. les couper ; ainfi la méthode du ci-devant
pays de Caux , où on l-ès arrache avec la te--
naille de bois, eft préférable à: la méthode
des en\irons dé- Paris, de la ci-devant Beauce ■
& ci-devant Brie , où on fe contente de les couper.
Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit au
mot Av o in e , page 740 du premier volume, &
au mot C hardon page 66 du deuxième.volume
de l’Encyclopédie méthodique. On y trouvera
à-peu-près ce qu’il eft iméreffam de favoir fur
la manièred’Echardonner. ( T essier. ).
ECHARDONNETTE. Dans le Boulonnois |
on appelle ainfi l’échaMonnoir, ou infiniment
propre à détruire les Chardons. Voyez le mot
C h a r d o n . ( T essier. )
ECHARDONNOJR. Petit crochet tranchant
emmanché au bout d’un bâton ; en s’en fert
pour nétoyer les terres des Chardons , & autres
mauvaiCes herbes, telles que les patiences&c. Ce
nom peur aufti fe donner à une tenaille de bois,
dont on fe fert dans le ci-devant pays de Caux,
pour ôter les Chardons des moiffons. Voyez le
mot Chardon. ( T e ssier. )
ECHASSERY ou Z?cjy de CaaJJery. Variété du
poirier , d’un grand rapport, dont les fleurs font
grandes; fes fruits font ovales, blancs - jaunâtres
, beurrés , pleins d’une eau mufqnée : ils
muriffent pendant les mois de brumaire, & fe
confervent jufqü’en nivofe. Voyez le Diétiôn-
naire des Arbres & Arbuftes, article P o ir ie r .
( X. Re y n ie r . )
ECHAUDE. On nomme bled échaudé, celui
dont le grain maigre-, fe c ,r id é& flétri, contient
peu de farine. Il y a des endroits où on le nomme
bled retrait. Le bled échaudé fait de bon pain ’
fa farine efi belle; mais il rend peu. Entre les
caufes auxquelles on croit pouvoir attribuer cet
effet, M. Duhamel en rapporte dêux, dont la
première eft le défaut de nourriture dans l’épi,
Iorfque le bled étant verfé le tuyau eft ployé ou
même rompu; la deuxième eft que s’il fur vient
fubitement de grandes chaleurs, lorfqne les bleds
font pénétrés d’humidité, & que les grains ne
font pasfufnfamment formés, la paille & le grain
fe deffèc fient.'
Le grain quoique retrait peut-être femé, fans
craindre qu’il ne vienne pas., Je m’en fuis affuré
en en femant exprès, & comparativement avec
du bled bien nourri &bien conditionné. Il a produit
de belles récoltes. Néanmoins je ne garanti
rois pas qu’il en produisît toujours, il y auroit à
craindre qu’il ne périr beaucoup de lèmence de1
grains retraits dans les années, ou il furviendroit
de la gelée au moment où ir eft e-n lait \ c’eft--
â-dire , ramolli par un commencement de végétation.
( T e s s ie r . )
ECHAUDER LE BLED fi-gnific mettre le
bled en chaux. Vove^ C arie. ( T essier, j
E CH AUDEM ENT ou ECBAUDA1SON. Maladie
à laquelle les Caffbyers de Saint-De min-
gue font très - fujers , qui provient d’une
mauvaife manière de les cultiver. Les arbres
attaqués: de cette maladie sefiemUent, & leur
fruit fe prématuré, avant d’avoir acquis ù per-
feélion. Voyez C a f f e t e r . ( L. R e y n ie r . )
ECHAUFFER UN TERREÎN. C ’efl ou lui
ôter cette humidité froide, capable de retarder
la végétation des plantes qu’il produit, ou lui
ajouter quelque matière chaude par fa nature,
â l’effet de le rendre propre à donner des ré-
' coites plus précoces ou plus abondantes. Un écoulement
donné, par le moyen de foffés ou rigoles,
aux eaux, qui féjournent fur un fol compaéi,
des labours répétés.qui le diviférir, ou des fumier
lélers qui le fuulèvent, font des moyens
certains de l’échauffer ; on l’échauffe encore davantage
, quand on l’amende avec des engrais
de fnbftances animales, telles- que la fiente de
volailles, la poudrette, les débris dés'boucheries
&c. Voyez Amendement. ( Tessier ") -
ECHAULER LE BLÉ fignifis la jmême chcfe
que chauler le hléd. Voyez C ar ie . ( T e s s ie r . )
ECHAUX. On trouve, dans l’ancienne Encyclopédie
, fous ’cet article , l’indication des'rigoles
ou foffés, qui fervent à l’écoulement des
eaux, après l'irrigation des prairies. Voyez Ir r i -
-G ation. ( L. Rf. ynier . )
ECHELLE. Infiniment néceffaire au Jardinier,
pour la taille & le foin des arbres. 11 fera-
traité, au DiéHonnairé des Arbres, & Arbuftes de
la meilleure forme à donner aux échelles. (X .
Re y n ie r . )
ECHELLE-de-JACOB. Nom bizarre donné
à la Polémone des Jardins. D’où dérive fi! ce
rapport, entre une Echelle que Jacob affirme
s’étre élevée jufqu’au ciel, & une fleur qui s’élève
à deux pieds de terre ?- Voyez P o l ém o n e . ( X.
R e y n ie r . )
ECHELONS. On dir qu’un arbre croît pair
échelons , îorfqu’ii fe forme par étages . avec des
intervalles entre fes ramifications. Ancienne Eh-
cyclopédie^'( X. R e y n ie r . )•'
ECHENILLER. Enlever les Chenilles, ou leurs*
oeufs, avant qu’ils éc lofenrp our détruire ces in—
feéles dévadateurs. On emploie divers moyens,
adaptés à leur conformation ,' tels que d’enlever
les jeunes .branches-où exifient des bagues ,
celles-où ont été formés des nids , les feuillet
recoquillées par des 'coques', &c. : ces divers-
repaires*^Contiennent les oeufs; jorfqu’on les ôte
pendant la faifon morte & qu’on les détruit
on retranche, en grande-partie-, les erainres pour
la faifon fuivante.
Mais quelque, attention qu’on apporte dans
cette réviltonides arbres, des nids échappent à
la furvcilknee d'autres infcéles, écios chez