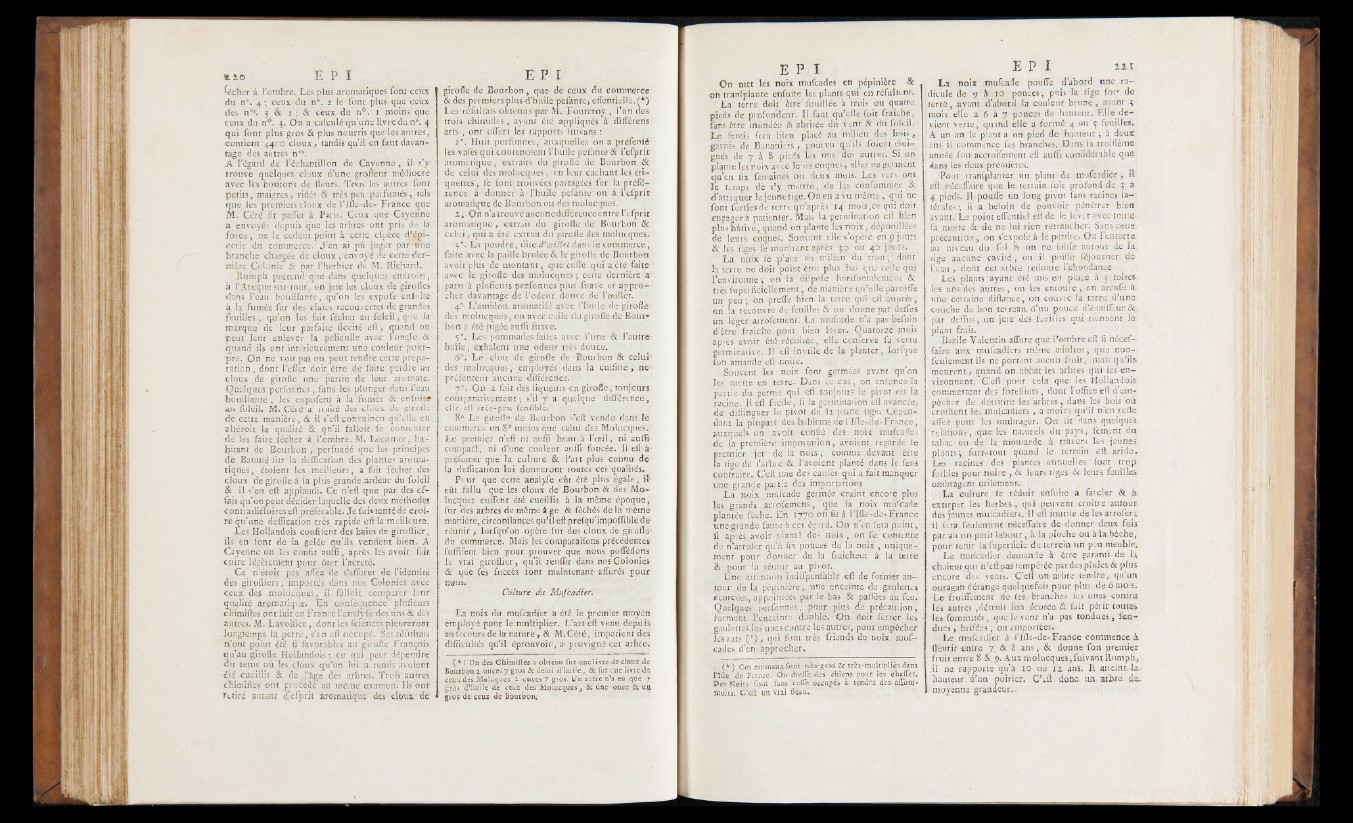
lécher à l’ombre. Les plus aromatiques font ceux
du n°. 4 *, ceux du n°. 2 le font plus que ceux
des n0s. 3 &. i ; & ceux du nQ. 1 moins que
ceux du n°. 3. On a calculé qu’une livre du n°. 4
qui font plus gros & plus nourris que les autres,
contient 4400 d o u x , tandis qu’il en faut davantage
des autres n0s.
A l’égard de l’échantillon de Cayenne, il s’y
trouve quelques doux d’une groffeur médiocre
avec lès boutons de fleurs. Tous les autres font
petits, maigres, ridés & très peu parfumés, tels
que les premiers doux de l’Ifle-de- France que
M. Céré fit paffer à Paris. Ceux que Cayenne
a envoyé« depuis que les arbres ont pris de la
force, ne le codent point à cette efpèce gPépicerie
du commerce. J ’en ai pû juger par line
branche chargée de doux , envoyé de cette dernière
Colonie & par l’herbier de M. Richard.
Rumph prétend que dans quelques endroits,
à l’Areque sur-tout, on je ce les doux de girofles
dans l’eau bouillante, qu’on les expofe enfuire
à la fumée fur des claies recouvertes de grandes
feuilles, qu’on les fait fécher au foléil, que la
marque de leur parfaite ficcité e f i, quand on
peut leur enlever la péliculle avec l’ongle &
quand ils ont intérieurement une couleur pourpre.
On ne voit pas on peut tendre cette préparation
, dont l’effet doit être de faire perdre au
doux de girofle un-e^partie de leur aromate.
Quelques, per formes, fans les plonger dans l’eau
bouillante , les expofent à la fumée & en foi ter
an foleil. M. Céré a traité des doux de girofle
de cette manière, & il s’eft convaincu qu’elle en
sltéroit la qualité & qn’il falloir fe contenter
de les foire lécher à l’ombre. M. Lecomte, habitant
de Bourbon , perfuadé que les principes
de Baumé fur la déification des plante? aromatiques,
étoient les meilleur;, a fait fécher des
doux de girofle à la plus grande ardeur du foleil
& il s’en efi applaudi. Ce n’eft que par des ef-
fojs qu’on peut décider laquelle des deux méthodes
contradictoires efi préférable. Je fui« tenté de croire
qu’une déification très rapide efi la meilleure.
Les Hollandois confifent des baies de giroflier,
ils en font de la gelée qu’ils vendent bien. A
Cayenne on les confit auffi, après les avoir fak
cuire légèrement pour ôter i'acreté.
Ce n’étoit pas aflez- de s’afîurer de l’identité
des girofliers, importés dans nos Colonies avec
ceux, des moiucqnes, il. falloir comparer leur
qualité aromatique. En conféquence* plufieurs
chimiftes ont fait en France l’analyfe des uns & des
autres. M. Lavoifier, dont les fciences pleureront
longtemps la perte, s’en efi occupé. Ses rëftdtats
n’ont poiut été fi favorables au girofle François
qu’au girofle Hollandois ; ce qui peut dépendre
du teins où les doux qu’on lui a remis avoient
été cueillis & de l’ âge dés arbres. Trois autres
chimiftes ont procédé'aü même examen. Ils ont
retiré autant d-efprit aromatique des clôux de
girofle de Bourbon, que de ceux du commerce
& des premiers plus d’huile pefante, effentielle. (*)■
Les réfultats obtenus par M. Fourcroy , l’un des
trois chimiftesayant été appliqués à différens
arts , ont offert les rapports fui va 11s :
i°. Huit perfonnes, auxquelles on a préfenté
les vafes qui contenoient l’huile pefante & l’efprit
aromatique, extraits du girofle de Bourbon &
de celui des molucqu.es, en leur cachant les étiquettes
, fe font trouvées partagées fur la préférence
à donner à l’huile pefante ou à l’efprit
aromatique de Bourbon ou des molucques.
2.. On n’a trouvé aucune différence entre l’efprit
aromatique, extrait du girofle de Bourbon &
celui, qui a été extrait du girofle des molucques;
30. La poudre, dite d>oeillet dans le commerce,
faite avec k paille brûlée & le girofle de Bourbon
avoit plus de montant, que ceÉle qui a été faite
avec le girofle des molucques*, cette dernière a
paru à plufieuis perfonnes plus fuave et approcher
davantage de l’odeur douce de' l’oeillet.
40 L ’amidon aromatifé avec l’huile de. girofle
dés molucques, on avec celle du girofle de Bour*
bon a été jugée aufli fuave.
5°. Les pommadas faites avec l’une & l’autre
huile, exhalent une odeur très douce.
6°. Le clou de girofle de Bourbon & celui
des molucques, employés dans la cuifine, ne-
préfenrent aucune-différence.
7 0. On a fait des liqueurs en girofle, toujours
comparativement *, s’il y a quelque différence y
elle efi très-peu fenfible.
8° Le girofle de Bourbon s’eft vendu dans lë
commerce un 8e moins que celui dès Molucques.
Le premier n’eft ni auifi beau à l’oeil , ni aufli
compatft, ni d’une couleur aufli foncée. Il efi à
préfumer que la culture & Part plus connu de
la déification l;.ui- donneront toutes ces qualités.
Pour que éette analyfe eût été plus'égale, il'
eût fallu que les doux de Bourbon & des Mo-
lucques enflent été cueillis à la même époque,
fur des arbres de même à ge & fècbés de la même
manière, circonftances qu’il efi prefqu’impoflible de
réunir , lorfqu’on opère fur des doux de girofle-
du commerce. Mais les comparaifons précédentes
fuffîfent bien pour prouver que nous poffédons
le vrai giroflier, qu’il reuffit dans nos Colonies-
& que fés fuccès font maintenant affurés pour
nousv
Culture du Mufcadier;
La noix du mufcadier a été le premier moyen
employé pour le multiplier. L’art-efi venu depuis
au fecours de la nature, & M.Cëré, impatient des
difficultés qu’il éprouvoit-, a- provigné cet arbres
(:.* ) Un des Chimiftes a-obtenu fur une livre de ctbux de
Bourbon z onces7 gros & demi d’huile, & fur une livre de
ceux des,M®iuques, 2. onces 7 gros. Un autre n’a eu que 7
gros d’hüile de ceux des Molucques, 8c une oncç Ôc uft
gros de- ceux de bourdon,
E P I
On met les noix mufeades en pépinière &
on tranfplante enfuite les plants qui en réfultenr.
La terre doit être fouillée à trois ou quatre
pieds de profondeur. Il faut qu’elle foit fraiche,
fans être inondée & abritée du vent & du foleil.
Le femis fera bien placé au milieu, des bois,
garnis de Bananiers, pourvu quils foient éloignés
de 7 à 8 pieds les uns des autres. Si on
plante les noix avec le us coques, elles ne germent
qu’en fix femaines ou deux mois. Les vers ont
le temps de s’ y mettre, de les consommer &
d’attaquer la jeune tige. On en a vu même , qui ne
font fortiesde terre qu’après 14 mois,ce qui doit
engager à patienter. Mais la germination efi bien
plus hâtjve, quand on plante les noix, dépouillées
de leurs coques. Souvent elle s’opère en 9 jours
& les tiges fe montrent après’ 36 ou 40 jours.
La: noix fe p’ace au milieu du trou, dont
la terre ne doit point être plus bas que celile qui
l ’environne*, on la difpofe horifontalement &
très fupeificiellement, de manière qu’elle pâroiffe
un peu-, on preffe bien la terre qui efi auprès,
on la recouvre de feuilles & on donne par deffus
un léger arrofement. La mufeade n’a pas befom
d’être fraiche pour bien lever. Quatorze mois
après avoir été récoltée, elle ccnferve fa.vertu
germinative. Il efi inutile de la planter, lorfque
fon amande efi noire.
Souvent les noix font germées avant qu’on
les mette en terre. Dans ce cas, on enfonce la
pairie du germe qui efi toujours le pivot ou la
racine. H efi facile, fi la germination efi avancée,
de difiinguer le pivot.de la jeune tige. Cependant
la plupart des habitans de ITfle-de-Franee,
auxquels on avoit confié des noix mufeades
de la première imporration, avoient: regardé Je
premier jet de la noix, comme devant être
la tige de l’arbre & l’avoient planté dans le fens
contraire^ Ç ’eft une des caufes qui a fait manquer
une grande partie des importatidns
La noix mufeade germée craint encore plus
les.,grands arrofemens, que la noix mufeade
plantée fèché. En 1770 on fit à lTfle-de-France
une grande faute.à cet égard. On n’en fera point ,
fi après- avoir planté des noix , on fe contente
de n’arrofer qu’à fix poùces de la noix , uniquement
pour donner de la fraieheur à la terre
& pour la réunir au pivot.
Une attention indifpenfable efi de former autour
de là pépinièreune enceinte de gaiiiettes
écorcéeSj appointées par le bas & pafiées au feu.
Quelques perfonnes, pour plus de précaution ,
forment, l’enceinte double. On doit ferrer les
gauler tes les unes contre les autre;, pour empêcher
les rats ( f ) , qui font très friands de noix muf-
cades d’en approcher.
. (*) Ges animaux.font très-gros & trcs-multipliés dans
flflc de France. On dreile des chiens pour les Ghaffer.
Bes Noirs font fans celle occupés à tendre des-'aflbm-
aioirs.. C’eft un. vrai fléau».
La noix mufeade pouffe d’abord une radicule
de 9 à 10 pouces, puis la tige fort de
terré, ayant d’abord la couleur brune, avant 3
mois elle a 6 à 7 pouces de hauteur. Elle devient
verte, quand elle a formé 4 ou 5 feuilles.
A un an le plant a un pied de hauteur *, à deux
ans il commence fes branches. Dans la troifième;
année fon accroifement efi aufli confidérable que
dans les deux premières.
Pour iranfplanter un plant de mufcadier, il
efi néceffaire que le terrain foit profond de 3, à
4 pieds. Il pouffe un long pivot fans racines latérales*,
il a befoin de pouvoir pénétrer bien
avant. Le point effentiel efi de le lever avec toute-
fa motte & de ne lui rien retrancher. Sans cette
précaution , on s’expofe à le pfjrdre. On l’enterre
au niveau du fol & on ne lai fié autour de la.
tige aucune Cavité, ou il puiffe féjourner de
l’eau , dont cet arbre redoute l’abondance
Les plants ayant été mis en place à 3 toises
les 11ns des autres , on les entoure, on arrofe à-
une certaine difiance, on couvre la terre d’une,
couche de bon terreau, d’un pouce d’épaiffeur &.
par deffus, on jeie des feuilles qui tiennent le.
plant frais.
Bazile Valentin affure que l’ombre efi fi nécef—
faire aux' mufeadiers même adultes, que non-
feulement ils ne portent aucun fruit, mais qu’ils
meurent, quand on abbat les arbres qui les environnent.
G’eft pour cela que les Hollandois-
commettent des forefiiers, dont l’office efi d’empêcher
de détruire les arbres, dans les bois où
! croiffent les mufeadiers , à moins qu’il n’en refie
affez pour les ombrager. On lit dans quelques.-
relations, que les na.ureis du pays , fement du
tabac ou de la moutarde à travers les jeunes
plants*, fort-tout quand le terrain efi aride»
Les racines des plantes annuelles font trop
foibles pour nuire , & leurs, tiges Scieurs feuilles
ombragent utilement.
La culture fe réduit enfuite à farder & à
extirper les herbes, qui peuvent croître autour,
des jeunes mufeadiers. Il efi inutile de les arrofer*,.
il fera feulement néceffaire de donner deux fois
par an un petit labour, à la pioche ou à la bêche,
pour tenir la fuperficie du terrein un peu meuble..
Le mufcadier demandé à être garanti de la
chaleur qui n’efi pastèmpérée pardes pluies & plus
encore des vents. C’eft un arbre tendre, qu’un
ouragan dérange quelquefois pour plus de 6 mois.
Le froidement de fes- branches les unes contre
les autres ,détruit fon écorce & fait périr toute»
les fommités, que le venr n a pas tondues, fendues
, brifées , ou emportées.
Le mufcadier à l’ifle-de-France commence à
fleurir entre. 7 & 8 ans, & donne fon premier
fruit entre 8 & 9-, Aux molucques,fuivant Rumph,
il ne rapporte qu’à 10 ou 12 ans. Il atteint,, la*
hauteur d’un poirier. C’ cfi. donc uel aibre déc
* moyenne grandeur..