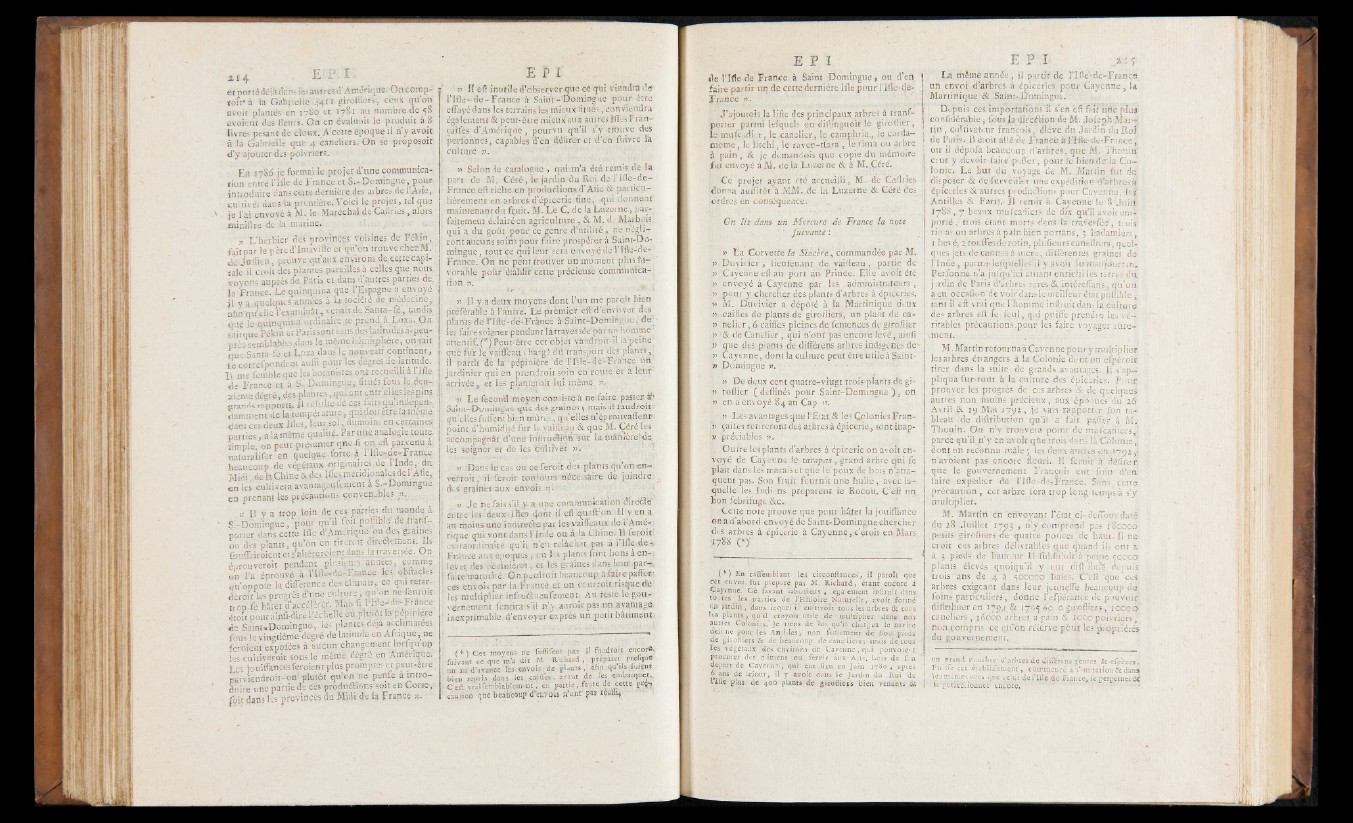
et porté déjà dans le; autres il' Amérique. Oü comptoir*
à la GabpeUe 44X1 girofliers, ceux qtton
avoir plantés en 17S0 tt 1781 au nombre de 58
avoiént des fleurs. On en évalüoit le produit à 8
livrés pesant de doux. A cette époque il n’y avoir
à la Gabrielle que 4 caneliers. On se proposoit
d’y ajouter des poivriers.
En 1786 je formai le projet d’une communication
entre rifle de France et S.-Domingue,-pour
introduire dans celte dernière des arbres de l’Asie,
cultivés dans la,première,Voici le projet, tel que
\ jg j‘gj envoyé à M. le Maréchal de Câlines., alors
miniflre de la marine.
n L’herbier des'"provinces ■ Voisines’ de Pékin,
fait par le père d’Imaviile’ei 'qu’on trouve chez®,
dé Jaflieu , prouve-qu’aux environs de cejte capitale
il croît des plantes pareilles à celles que nous,
voyons auprès de .Paris etdansd’autres parties de,
la France. Le quinquina que l’Espagne a envoyé
jl y a quelques années à la.société de médecine,
afin qiïjeile l’examinât, venait.de Santa-fe., tandis
mie le atlincruina ordinaire.se prend, a Loxa. On
S & s et Paris sont sous Ses latitudes àèpeu-,
près semblabies.dans le.même hémisphère,.on-sait
que Santa-fé et Loxa dans le nouveau’ continent,
ie correspondent auilr pour les dégrés de latitude.
1\ me femble-que les botanistes ont recueilli a 1 me
de France et à-S.'.pamingue.; limés fous le deuxième
dégré, dès .plantes, quipnt entrtiiesloe pins
grands rapports, 11 réfulte-dç cesùaits qvmndepen,
damment de la température-, qui doit être la même
dans ces deux Lies, leur sol, dumcins en certaines;
parties , a la même qualité. Par une analogie toute,
limpla on peut présumer que fi on. eft parvenu.a
naturaîifer en quelque.forte, à r ifle -ÿ -F r a n a ;
beaucoup d e végétaux originaires,de 1 Inde,- du
Midi de la Chine & des Mes méridionales de l’Afie,
on les cultivera avaniagculeriient à S-—Domingue
en prenant les précautions convenables 71.
u II y a trop loin de.ces. parties du monde a
c -Domingue , pour qu’il fpit pofliblé de tranf-
porter dans cette Me 'd’Amériqae ou dey graines;
ou des plants, qu’on en- tirerait direélement. Ils
fouffriroient et s’altéreroient dans la traversée. On
éprouverait pendant plusieurs années, comme,
on l’a éprouvé à l’ Ilk-de-F.r.ance les, obftaçles
qu oppofe la différence des1 climats,: ce « M M
deroit les progrès, d’une culture , | u on ne laarOit
trop-fe hâter tfaccék.er. 'Mais fi 1‘Me-dè-Frànce;
étoft pour ainli-dire Pëchelleou plutôt la pépirtpre
de Saint-Domingue , les plantes déjà acclimatées
fous le vingtième dégré de latitude en Afrique , ne
feroient expofées à aucun changement lorfau on
les cultiverait sous le même dégf'é en Amérique.
Les jouiflancesferoient plus promptes e t peut-être
paryiendroit-on plutôt; qivon :ne petife à introduire
une partie de cés productions soit en-Corse,
{oit dans Ls provinces du Midi de la France ».
» H eft inutile ^observer que ce qui viendra de
riûe-de-FranGé à' Saint -'Domingue pour être
eftayë dans les terrains les mieux fitués, conviendra
également & peut- être mieux aux autres Ifles Françaises
d’Amérique, pourvu qu’il s y trouve des
perfonnes, capables d’en délirer et d en fuivre la
culture ».
• » Selon de catalogue > qui m’a été remis de la
- ' part de AI. Céré, le jardin du Roi de l’ Ifte-dc-
Frarice eft riche en produétionsrd’Aüe & particulièrement
en arbres, d’épicerie fine,, qui donnent
maintenant du fçuit. M. Le C. de la Luzerne, pâj-
faitemeuj éclairé en agriculture, & M. do Marboisr
qui a du goût*pour, ce genre d’utilité , ne négli-
. ront aucuns soins pour faire prospérer à Saint-Domingue,
tout ce qui leur sera envoyé de l’Ifle-de-t
France-.' On né peut trotiver un moment plùsFa-
vorable pour étàblir cette’ précieuse comtnunica-
tîon ».
» Il y a deux moyens,dont l’un me paraît bien
préférable à l’autre. Lé. premier ëft d’envoyer des.
plants dé rifle-dë-Frànce à Sâinr-Domiégue, demiesfaire
soigner pendan t là rraVëi“séd par tftvhomme1
attentif.^*)Peut-être cét objet yûndfoir-il.la peiné'
■ qué fuî: le vâifïe'aq chargé du traèsjfdn dés plants,,
il pàrtît de la " pépinière de' TIllê-dè^France un
jardinier oui en prendroir soin en fouie ët à leur
; arrivée,,.et lés pointerait lui mêmç,
■ » Le fécond moyen consiste à ne faire passer* ah
| Sâint-Domin^ué que des graines j in gis i l faudroit -
! qu’c 11 es fuffent bien mûres., quelles n’éprbiLvaffent.
- point.d’hûmidixé fur le vaifleàu & que M. Céré les
accompagnât d une inftrüdlRVn !sûr la mânièret-de,
lés soigner'et de les triïltîvë’r _
yj .Dans le cas ou ce feroit des plants qu’on en-r
vefroit, il'feroit toujours nécessaire de joindre:'>
dîcs graines aux envois » i
| » Je ne fais s’il y- a une communication direèïé
■ entre lès deu*»iftes >1 eftqucft'pn 11 y en a.
’ au moins une indiiiecVe; par les TaiffeauX'de L Àmé-^
rique qui vont dans i Inde ou à la Chine. Il ferait
‘ extraordinaire qu ii n’en; relâchât.pas ;à 1 Ifleide.-/
. France aux époques>:ou Ls plants font bons à en- ;
I lever des pépinièreset -lès graines dans leiubpar-?j.
j faite maturité. On petdroit beaucoup àfairepafferr
I cgg envois par la Francè et on .GGiirroit risque de
les multiplier infruftueufement. Au reste le.gou-
* vdrnement fentira^s’il n’.y auroitpas ;nn .avantage
' inexprimable d’envoyer exprès un petit bâtiment!
( * ) C<*s moyens ne fûffifent pas il faudroit encor®^
füivant ce que m’a dit M Richard , préparer prefquc
un an d’avance ' fes, renvois de plants , afin qu ils :lpie;nt
bien, repris ,da'qs les ..caflfies , ay ant de les embarquer,,
C ’eft. vraifemblablem-ip, en partie, faute de cette pi§-?
caution que beâuçëup d”euŸQ'is n’ ont" £as reufit?
E | I
de rifle-de France à Saint Domingue , ou d’en
faire partir un de cette dernière. I fie .pour Ufle-de-
France n.
~ ' J ’ajoutois la lifte des principaux arbres à tranf-
porter parmi lëfquels on difîinguoit lé giroflier,
le mufeadier, le canelier, le camphria^ le cardafut
envoyé à AI. de la Luzerne & à M..Çéré..
Ce projet ayant été accueilli, M. de Cafiries
donna auffitôt à.MAL.de la Luzerne & Céré des
ordres en conséquence.
Gn lit dans un Mercure de France la note
' fuivante :
v> La Gorvetfe la Sincère, commandée par M.
3>> Duvivier , lieufenant de vailîeau , partie de-
» Cayenne efî au port au Prince. Elle avoit été
» envoyé à Cayenne par, les.. administrateurs,
j? pour y Gherçher des plants d’arbres à épiceries.
» M. Duvivier a déposé, à la Martinique deux
33 câilVes de plants de girofliers, un plant de ca-
33 relier, 6 caiffes pleines de femences de giroflier
33 ■ & de Canelier, qui n’onf pas encore lèvé, ainfî
33 que des. plants de différens arbres indigènes de“-
33 Cayenne, dont la culture peut être utile à ^aint-
» Domingue 3». •
33 De deux cent quatre-viugt trois-plants de gi-
». roflier (deflinés pour Saint-Domingue), on
33 en a env oyé 84 au Cap 3V.
33 Les avantages que l'Etat & les Colonies Fran-
■33 çailes retireront des arbres à épicerie, spntinap-
» préciables ?>.
Outre les plants d’arbres à épicerie on avoir envoyé
de Cayenne le tarapas, grand arbre qui fe
plait dans les marais et que le poux de bois .n attaquent
pas. Son fruit fournit une huile, avec laquelle
les Indiens préparent ie Rocou. C’eft un.
bon fébrifuge .&c.. _
Cette note prouve que pour hâter la jouiflance
on a d’abord envoyé de Saint-Domingue chercher
des arbres à épicerie à Cayenne, c’étoit en Alars
1788 (*y
( * ) En raflemblànt les c ircônftanc es , i l paroît que
ce t en v o i, fu t préparé par M . R ich a rd , é tant encore a
Cayenne.' C e favant iab o riéux , éga lement inftruit dans
toutes les parties de l ’I-lflroire N a tu re lle, a v o it fo rmé
un jardin , dans lequel ii- cn lt ivo it tou s les arbres & tons
ks plants , qu’il e rp y o it utile .de multiplier dans' nos
autres Co lo n ie s.' Je tiens de fu i q u ’il ch arg ea le navire
defbné pour les A n ii t le s , non feulement de ,é;o-d pieds
de .g iro flie rs & de beaucoup de ca n e ilie is ; mais de. tous
le s vég étaux des environs de C a y en n e , q u i .pouvoiei.c
procurer des a imens o u fe rv i r - a u x A rts . Lors de fi n
départ de C a ÿ ’ef>ns , qui eut lien en Juin 1780. y -après
6 ans de iejoui ,■ ' il y a v o it dans le Jardin du R o i 'de t
H fle plus de 4.00 plants de g iro flie x s bien venants §5 ■’
E P L , u î
La même année, il partir de rifle-de-Franco
un envoi d’arbres à épiceries pour Cayenne, U
Martinique & SainrDomingûe.'
Depuis ces importations il s’en èft fait bùe plug
confidérable, fous Ja direélion de M. Jpfegh Alar-î
tin , cultivateur françois, élève du Jardin du Roi;
de Paris. 11 étoit allé de France àTIfte-de-France^
ou il dépofa beaucoup d'arbres, qiie M. Thouin
crut y devoir faite pufTer, pour le bien de'la Colonie.
Le but du voyage de M. Martin fur de'
dis poser & defurvéiikr une expédirion d’arbresà
épiceries & autres productions pour Cayenne, le|
Antilles & Pari?.- Il remit à Cayenne le 8 Juiii
17 8 8 ,7 beaux mufeaniers de dix au il avoit emi,
porîé , trois étant morts dans la rfaverfëe , troiÿ
ria a? ou arbres à.pain bien porrans, 3 l-adatniers,
1 hevë, ijtouffesderotin, plusieurscanelliers/quelr.-
qués jets de cannes, à sucre, différentes -graines de;
r i n i l , parmi'lefquèlleà il- y avoit du manjoumn^
. Perfonne. n’a ju.fqif.ici autant enrichi les terres du
j -rdin de Paris cParbres rares;& intérefians, qu’on
a eu occaüon de voir'dans le meilleur état pcftible j
j tant if eft vrai que l’homme inftruit dans ia.eulture
des arbres eft le feul, qui puifle prendre les véritables
précautions .pour les faire voyager sûre-
i-ment.
M. Martin retourna à Caj'enne pour y multiplier
les arbres étrangers à la Colbnie dont on efpéroic
tirer, dans la suite -de grands - avantagé*.. Ii s’appliqua
fur-rout à la" culture des' ëpiceriesf Pour
prouver les progrès de ces arbres & de quelques
autres non moins précieux, aux épo mesMu 26
Avril _& je) Mai 1792, je vais rapporter fon ra4-
bleau de diftlributian qu’il a fait pafter à Ma
Thouin. Gu n’ y trouvera point de mqfçadiers-J
parce qu’il n’y en avoir qûe trois dans la Colonie jf
dont un reconnu mâle ; les deux autres e n -1792,>
n avoient pas" encore fleuri. Il feroit.â délire r.
que le gouvernement François eut foin d’en
faire expédier de i’Ifle-de-France. Sans cette
précaution, cet arbre fera trop long-temps à s’y
multiplier.
M. Alartin en envoyant l’état ci-deftoils daté
du 28 Juillet" 1793 ,• n’y comprend pas^ iScoco
petirs girofliers de quatre pouces de haut. Ii ne
croit ces arbres délivrables que quand ils ont i
à ,3 pieds de hauteur II fùbfi-ftoirià peiiie 50000
plants élevés quoiqu’il y eut diftribuë depuis
trois'ans de 4 à çboÔè“0 baies. C'en que ces
arbres exigeant dans leur jeuneffe beaucoup de
foins particuliers, donne rëfp’ér'ancë de pouvoir
difiribüer en I794.& 1795 é'pyo girofliers, iGôoq-’
caneliers, jép co arbres à pain & fcoopoivriers,
non compris ce qu*on réfer.ve'pôur les propriétés
du gouvernement.
un grand nom b re d’ arbres de «ditveruis genres ât elpèces^
Eûi fie ce t é ts b liiiem e n t , com menc é à 'l ’ im ira t io ii& d an sj
.Ûn-? de f i l l e 'de-Eraiïçe, j e perpétuer £§'
ie p'erfeélioiiner encore.