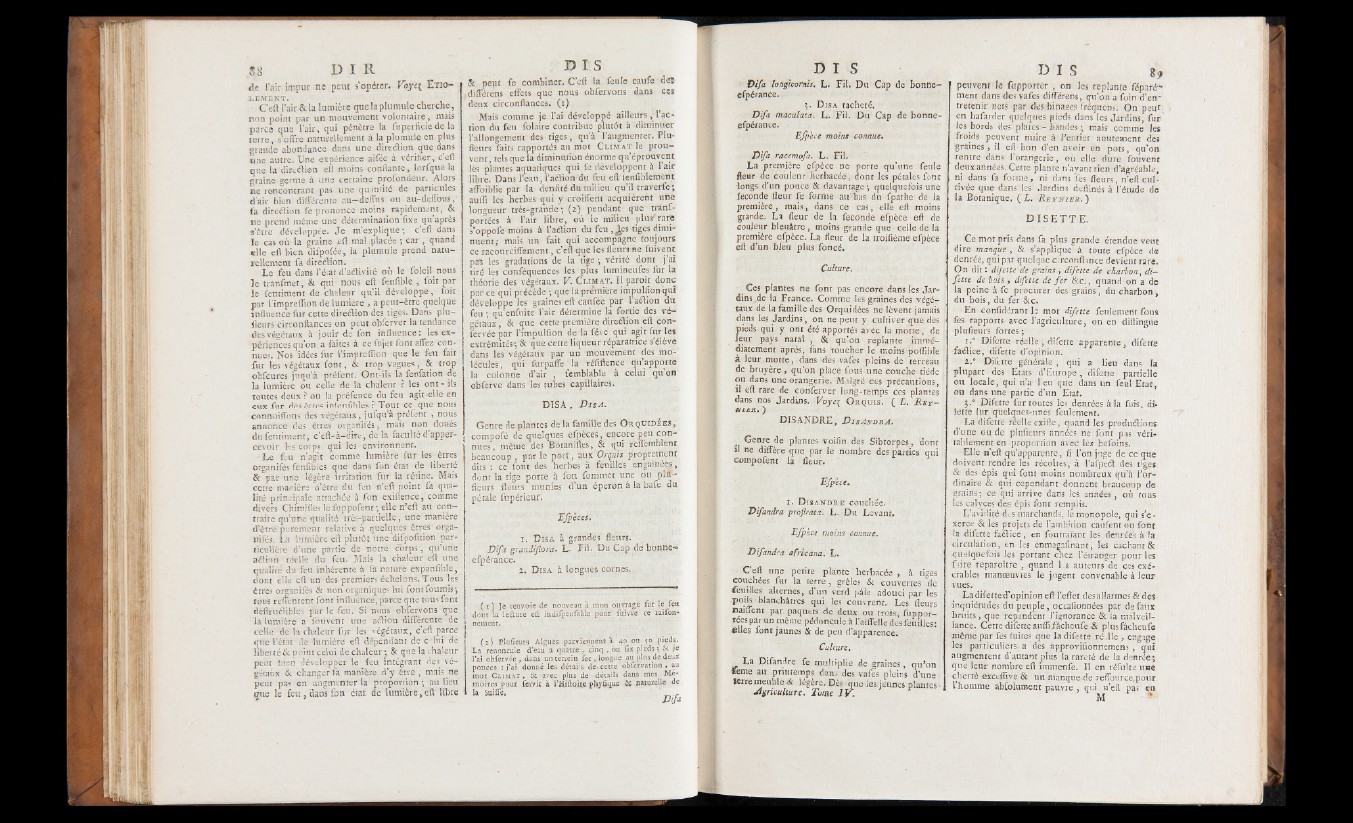
S..8 D I R
de l’air impur ne peut s’ opérer. Voyc\ É t io l
e m e n t .
C’eft l’air & la lumière que la plumule cherche ,
non point par un mouvement volontaire, mais
parce que l’air -, qui pénètre la fuperficie de la
terre, s’offre naturellement à la plumule en plus
grande abondance dans une direélion que dans
une autre. Une expérience aifée à vérifier, ceft
que la direôHôn elt moins confiante, lorfque la
graine germe à une certaine profondeur. Alors
ne rencontrant pas une quantité de particules
d’air bien différente au-deffns ou au-deffous, ■
l'a direélion le prononce moins rapidement, &
ne prend même une détermination fixe qu après
s’être développée. Je m’explique; c’eft dans
le cas où la graine ,eft mal .placée ; car , quand
elle eft bien difpofée, la plumule prend naturellement
fa direélion.
Le feu dans l’éiat d’aélivité où le foleil nous
le tranfmet, & qui nous eft fenfible , foit par
le fentiment de chaleur qu’il développe, l'oit
par l’impreflion de lumière , a peut-être quelque
influence fur cette direélion des tiges. Dans plu-
fieur-s circonftances on peut obferver la tendance
des végétaux à jouir de fon influence : les expériences
qu’on a faites à ce fujet font affez connues.
Nos idées fur i’impreffion- que le feu fait
fur les végétaux font, & trop vagues, & trop
obfeures jnqu’à préfenr. Ont-ils la fenfation de
la lumière ou celle de la chaleur | les ont - ils
toutes deux? ou la préfence du feu agit-elle en
eux fur des êtres infenfibles ? Tout ce que nous
connoiffons des végétaux, jufqu’à préfent , nous
annonce des êtres organisés, mais non^ doués
du fentiment, c’eft-à-dire, de la faculté d’apper-
cevoir lts corps qui les environnent.
L e feu n’agit comme lumière fur les êtres
organifés fenfibles que dans fon état de liberté
& par une légère irritation fur la rétine. Mais
cette manière d’être du feu n’eft point fa qualité
principale attachée à fon exiftence, comme
divers Chimîfies le fuppofent ; elle n’eft au contraire
qu’une qualité très-partielle, une manière
d’être purement relative à quelques êtres organifés.
La lumière eft plutôt une difpofttion particulière
d’une partie de notre corps, qu’une
aélion _ réellè du feu. Mais la chaleur eft une
qualité du feu inhérente à fâ nature expahiible,
dont elle eft un des premiers échelons. Tous les
êtres organifés & non organiques lui font fournis;
tons reffement font influencé, parce que tous font
deftruétiblès par le feu. Si nous obfervons que
la lumière a fouvent une aélion différente de
celle de la chaleur fur les végétaux, c eft parce
que l’état de lumière eft dépendant de c: lui de
liberté & point celui de chaleur ; & que la chaleur
peut bien développer le feu intégrant des végétaux
& changer fa manière d’y être , mais fie
peut pas en augmenter la proportion ; au lieu
mie le feu , dans fon état de lumière, eft libre
D I S
I & peut fe combiner. C’eft la feule caufe de§
différèns effets que nous obfervons dans ces
deux circonftances. (i)
Mais comme je l’ai développé ailleurs, l’action
du feu folaire contribue plutôt à diminuer
l'allongement des tiges, qu’à l’augmenter. Plu-
fleurs faits rapportés au mot C l im at le prouvent,
tels que la diminution énorme qu’éprouvent
lés plantes aquatiques qui fe développent à l’air
libre. Dans l’eau , l’aélion du feu eft lenfiblement
affoibiie par la denfité du milieu qu’il traverfe ;
suffi les herbes qui y croiflent acquièrent une
longueur très-grande; (2) pendant que transportées
à l’air libre, où le milieu plus' rare
s’oppofe moins à l’aélion du feu , ^es tiges diminuent,*
mais un fait qui accompagne toujours
ce racourciffement, c’en que les fleurs ne fuivent
pas les gradations de la tige ; vérité dont j’ai
tiré les conféquences les plus lumineufes fur la
théorie des végétaux. V. C limat. Il paroît donc
par cè qui précède ; que la première impulfion qui
développe les graines eft cavtfée par l’aéïion du
feu ; quenfuite l’air détermine la fortie des végétaux
, & que cette première direélion eft con-
fervée par l’impulfion de la fève qui agit fur les
extrémités; & que cette liqueur réparatrice s’élève
dans les végétaux par un mouvement des molécules,
qui furpaffe la réfiftence squ’apporte
la colonne d’air , femblable à celui qu on
obferve dans les tubes capillaires.
D ISA , Dis A.
Genre de plantes de la famille des O rquidees ,
compofé de quelques efpèces, encore peu connues,
même des Botaniftes, & qui reffemblent
beaucoup , par le port, aux Or qui s proprement
dits : ce font des herbes à feuilles engainées,
dont la tige porte à fon fommet une ou plu-
fleurs fleurs munies d’un éperon à la bafe du
pétale fupérieur.
Efpèces.
T. Disa à grandes fleurs.
Difa grandiflora. L. Fil. Du Cap de bonne—
efpéràncé.
2. Disa à longues cornes.
( x ) Je renvoie de nouveau à mon ouvrage fur le fett
dont la lefture eft indifpenfâbîe poür filivre ce raifon-
nement.
( z ) Tlufîeurs Algues parviennent à 40 ou 50 pieds.
La renoncule d’eau a quatre , cinq , ou fix pieds ; & je
l’ai obfervée , dans unterrein fec , longue au plus de deux
pouces : j’ai donné les détails de. cette obfervation , au
-mot Climat, 8c avec plus de détails dans mes Mémoires
poui fervir à l’IIjftoir.e phyûque & naturelle de
la SuüTe, r
D I S
Difa tongicornis. L. Fil. Du Cap de bonne-
efpérance.
5. Disa tacheté. •
Difa maculata. L. Fil. Du Cap de bonne-
efpérance.
Efpbcc moins connue.
Difa. racemofa. L. Fil.
La première efpèce ne porte qu’une feule
fleur de couleur-herbacée, dont les pétales font
longs d’un pouce & davantage ; quelquefois une
fécondé fleur fe forme au'bas du fpathe de la
première, mais, dans ce cas, elle efl moins
grande. La fleur de la fécondé efpèce eft de
couleur bleuâtre, moins grande que celle de la
première efpèce. La fleur de la troifième efpèce
eft d’un bleu plus foncé.
Culture.
Ces plantes ne font pas encore dans les Jardins,
de la France. Comme les graines des végétaux
de la famille des Orquidées ne lèvent jamais
dans les Jardins , on ne peut y cultiver que des
pieds qui y ont été apportés avec la motte, de
leur pays natal , & qu’on replante immédiatement
après, fans toucher le moins poffible
à leur motte, dans des vafes pleins de terreau
de bruyère, qu’on place Cous une couche tiède
ou dans une orangerie. Malgré ces précautions,
il eft rare de conferver long-temps ces plantes
dans nos Jardins. Voye% O r q u i s . ( L. R e y n
i e r . )
DISANDRE, D i s Andra.
\ Genre de plantes voifin des Sibtorpes . dont
il ne diffère que par le nombre des parties qui
compofent la fleur.
Efpèce.
i . D is a n d r e couchée. ‘
Dfandra proftrata. L. Du Levant.
Efpèce moins connue.
Difandra africana. L.
C ’eft une petite plante herbacée , à tiges
couchées fur la terre, grêles &. couvertes de
feuilles alternes, d’un verd pâle adouci par les
poils blanchâtres qui les couvrent. Les fleurs
naiffent par paquets de deux ou trois, Rapportées
par un même pédonquleà l’aiffelle des feuilles:
€Ues font jaunes & de peu d’apparence.
La Difandre fe multiplie de graines, qu*on
Cerne au printemps dans des vafes pleins d’une
ferre meuble légère. Dès que les jeunes plantes
Agriculture. Tome IV .
D I S
peuvent le fupporter , on les replante féparé-
ment dans des vafes différèns, qn’on a foin d’entretenir
nets par des binages fréquens. On peut
en hafarder quelques pieds dans les Jardins, fur
les bords des plates-bandes; mais comme les
froids peuvent nuire à Fenrier aoutement des
graines, il efl bon d’en avoir en pots, qu’on
rentre dans 1 orangerie, où elle dure fouvent
deux années. Cette plante n’avanr rien, d’agréable,
ni dans fa forme, ni dans fes fleurs, n’eft cultivée
que dans les Jardins deftinés à l’étude de
la Botanique. ( L. Reynier.')
D I S E T T E .
Ce mot pris dans fa plus grande étendue veut
dire manque, Si s’applique à toute efpèce de
denrée, qui par quelque circonfhnce devient rare.
On dit : dijette de grains, difette de charbon, di-
fette de bois , difette de fer & c ., quand on a de
la peine à fe procurer des grains, du charbon,
du bois, du fer &c.
En confidérant le mot difette feulement fous
fes rapports avec l’agriculture, on en diftingue
plusieurs fortes ;
i.° Difette réelle ; difette apparente, difette
faélice, difette d’opinion.
2.0 Difette générale, qui a lieu dans la
plupart des Etats d’Europe, difette partielle
ou locale, qui n’a f e u que dans un feu 1 Etat,
ou dans une partie d’un Etat.
3.0 Difette fur toutes les denrées à la fois, difette
fur quelques-unes feulement.
La difette réelle exifte, quand les produélions
d’une ou de plufieurs années né font pas véritablement
en proportion avec les befoins.
Elle n’eft qu’apparente, fi l’on juge de ce que
doivent rendre les récoltes, à l’afpeél des tiges
& des épis qui font moins nombreux qu’à For-
dinaire & qui cependant donnent beaucoup de
grains; ce qui arrive dans les années, où tous
les calyces des épis font remplis.
L’avidité d-s marchands, le monopole, qui s'exerce
& les. projets de l’ambition caufent ou font
la difette faélice, en foutraïant les denrées à la
circulation, en les enmagafinant, les cachant &
quelquefois les'portant chez l’étranger pour les
frire reparoître , quand l.s auteurs de ces exécrables
manoeuvies lè jugent convenable à leur
vues.
La difette d’opinion eft l’effet desallarmes & des
inquiétudes du peuple, occafiormées par de faux
bruits, que répandent l’ignorance & ia malveillance.
Cette difette suffi fâcheufe & pîusfâcheufe
même par fes fuites que la difette ré-Jle , engage
les particuliers, a des approvifionnemens ,' qui
augmentent d’autant plus la rareté de la denrée 3
que leur nombre eft immenfe. Il en réfulte une
cherté exccffiye & un manque-de reffource.pour
1 homme abfolument pauvre , qui n’efl pas en