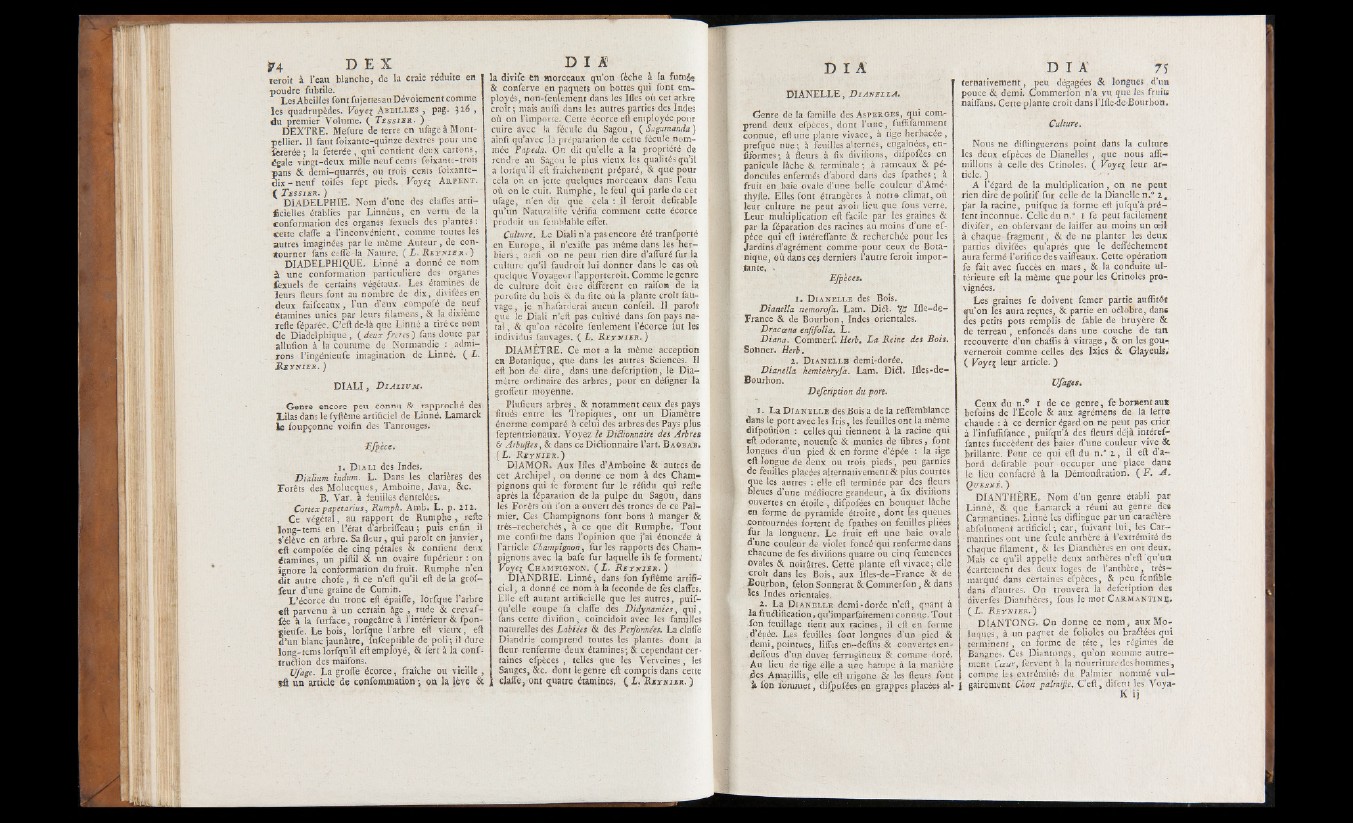
teroit à l’eau blanche, de la craie réduite en
poudre fubtile.
Les Abeilles font fu jettes au Dévoiement comme
les quadrupèdes. Voye{ Abeilles , pag. 316 ,
du premier Volume. ( Te s s ie r . )
DEXTRE. Mefure de terre en ufage à Montpellier.
11 faut foixante-quinze dextres pour une
feterée; la feterée, qui contient deux cartons ,
égale vingt-deux mille neuf cents foixante-trois
pans & demi-quarrés, ou trois cents foixante-
d ix -n e u f toifes fept p ie d s .Voye[ A r pen t .
^ EflADELPHIE. Nom d'une des claffes artificielles
établies par Linnéus, en vertu de la
conformation des organes fexuels des p?antes :
cette clafle a l’inconvénient, comme toutes les
autres imaginées par le même Auteur, de contourner
fans c elfe-la Nature. ( X. R e y n ie r . )
DIADELPHIQUE. Linné a donné ce nom à une conformation particulière des organes
fexuels de certains végétaux. Les étamines de
leurs fleurs.font au nombre de dix, divifées en
deux faifeeaux, l’un d’eux compofé de neuf
étamines ùnies par leurs filamens, & la dixième
refte féparée. C’eft de-là que Linné a tiré ce nom
de Diadelphique , ( deux freres) fans doute par
allùfion à la coutume de Normandie : admirons
l ’ingénieufe imagination de Linné. ( L.
B.s r n ie s . )
D IA L I , D i a l i v m .
Genre encore peu connu & rapproché des
XJlas dans le fyftême artificiel de Linné. Lamarck
le foupçonne voifin des Tanrouges.
Efpècti
1. D ia li des Indes.
Dialium indum. L. Dans les clarières des
Forêts des Molucques, Amboine, Java, &c.
B. Var. à feuilles dentelées.
Cortex papetarius, Rumph. Amb. L. p. 212.
Ce végétal, au rapport de Rumphe , refte
long-tems en l'état d’arbrifleau ; puis enfin il
s’élève en arbre. Sa fleur, qui paroît en janvier,
cft compofée de cinq pétales & contient deux
étamines, un piftil & un ovaire fupérieur : on
ignore la conformation du fruit. Rumphe n’en
dit autre chofe, fi ce n’eft qu’il eft delà grof-
feur d’une graine de Cumin.
L ’écorce du tronc eft épaifle, lorfque l’arbre
cft parvenu à un certain âge , rude & crevaf-
fée à la furface, rougeâtre à l’intérieur & fpon-
gieufe. Le bois, lorfque l’arbre eft vieux, eft
d’un blanc jaunâtre, fufceptible de poli-, il dure
long-tems lorfquïl eft employé, & fert à la conf-
truélion des maifons.
Ufage. La grofle écorce, fraîche ou vieille ,
sft un article de confommation \ on la lève de
la divife feft morceaux qu’on fiche à la fumé«
& conferve en paquets ou bottes qui font employés,
non-feulement dans les Ifles où cet arbre
croît ; mais auffi dans les autres parties des Indes
où on l’importe. Cette écorce eft employée pour
cuire avec la fécule du Sagou, ( Sagumanda)
àinfi qu’avec la préparation de cette fécule nommée
Papeda. On dit qu’elle a la propriété de
rendre au Sagou le plus vieux les qualités qu’il
a lorfqu’il eft fraîchement préparé, & que pour
cela on en jette quelques morceaux dans l’eau
où on le cuir. Rumphe, le feul qui parle de cet
ufage, n’en dit que cela : il leroit defirable
qu’un Naturalifte vérifia comment cette écorce
produit un femblable effet.
Culture. Le Diali n’a pas encore été tranfporté
en Europe, il n’exifte pas même dans les herbiers
v airfi on ne peut rien dire d’afluré fur la
culture qu’il faudroit lui donner dans le cas où
quelque Voyageur l’apporteroit. Comme le genre
de culture doit être différent en raifon de la
porofité du bois &. du fite où la plante croît faU-
vage, je n’hafarùerai aucun confeil. 11 paroît
que le Diali n’eft pas cultivé dans fon pays natal,
& qu’on récolte feulement i’écorçe fut les
individus fauvages. ( L. R e y n i e r . )
DIAMÈTRE. Ce mot a la même acception
en Botanique, que dans les autres Sciences. Il
eft bon de dire, dans une defcription, le Diamètre
ordinaire des arbres, pour en défigner la
groffeur moyenne.
Plufieurs arbres, & notamment ceux des pays
fitués entre les Tropiques, ont un Diamètre
énorme comparé à celui des arbres des Pays plus
feptentrionaux. Voyez le Diâionnaire des Arbres
& Arbuftes, & dans ce Diélionnaire l’art. Baobab.
(L . Re yn ie r .)
D1AMOR. Aux Ifles d’Amboine & autres de
cet Archipel, on donne ce nom à des Champignons
qui fe forment fur le réfidu qui refte
après la féparation de la pulpe du Sagou, dans
les Forêts où l’on a ouvert des troncs de ce Palmier.
Ces Champignons font bons à manger &
très-recherchés, à ce que dit Rumphe. Tout
me confirfne dans l’opinion que j’ai énoncée à
l’article Champignon, fur les rapports des Champignons
avec la bafe fur laquelle ils fe forment,
Voyei C h a m p ig n o n . (X . R e y n i e r . )
DIANDRIE. Linné, dans fon fyftême artificiel
, a donné ce nom à la fécondé de fes claffes.
Elle eft autant artificielle que les autres, puif-
qu’elle coupe fa clafle des Didynamies, q u i,
fans cette divifion, coïncidoit avec les familles
naturelles des Labiées & des Perfonnées. La clafle
Diandrie comprend toutes les plantes dont la
fleur- renferme deux étamines-, & cependant certaines
efpèces , telles que les Verveines, les
Sauges, &c. dont le genre eft compris dans cette
j c l a f f e ,q u a t r e étamines, ( I . w r H i s . )
DIANEL LE, T>i Ahezt.a .
Genre de la famille des Asperge», qui comprend
deux efpèces, dont l’une, fuflifatnment
connue, eft une plante vivace, à tige herbacée ,
prefque nué; à feuilles alternes, engainées, en-
fiformes; à fleurs à fix divifions, difpofées en
panicule lâche & terminale -, à rameaux & pédoncules
enfermés d’abord dans des fpathes ; à
fruit en baie ovale d’unè belle couleur d’Amé-
thyfle. Elles font étrangères à notre climat, où
leur culture ne peut avoir lieu que fous verre.
Leur multiplication eft facile par les graines &
par la féparation des racines au moins d’une ef-
pèce qui eft intéreffante & recherchée pour les
Jardins d’agrément comme pour ceux de Botanique,
où dans ces derniers l’autre feroit importante.
«
Efpèces,
1, Dianelle des Bois.
Dianella nemorofa. Lam. Diél. *lp Ifle-de—
France & de Bourbon, Indes orientales.
Draccena cnfifolia. L.
Diana. Commerf. Herb, La Reine des Bois,
Sonner. Herb,
2. Dianellb demi-dorée.
Dianella hemichryfa. Lam. Diél. Ifles-de-
Bourbon.
Defcription du port.
ï . La D ianelle des Bois a de la reffemblance
«lans le port avec les Iris, les feuilles ont la même
difpofition : celles qui tiennent à la racine qui
eft odorante, noüeufe & munies de fibres, font
longues d’un pied & en forme d’épée : la tige !
cft longue de deux ou trois pieds, peu garnies
de feuilles placées alternativement & plus courtes
que les autres : elle eft terminée par des fleurs
bleues d’une médiocre grandeur, à fix divifions
ouvertes en étoile , difpofées en bouquet lâche
en forme de pyramide étroite, dont tes queues
contournées fortent de fpathes ou feuilles pliées
fur la longueur. Le fruit eft une baie ovale
d’une couleur de violet foncé qui renferme dans
chacune de fes divifions quatre ou cinq femences
ovales & noirâtres. Çette plante eft vivace j elle
croît dans les Bois, aux Ifles-de-France & de
Bourbon, (elon Sonnerat & Çommerfon, & dans
les Indes orientales,
2. La D ia n e l l e demi-dorée n’eft, quant à
2a fi unification;» qu’imparfaitement connue. Tout
-fon feuillage tient aux racines, il eft en forme
; d’épée. Les feuilles font longues d’un pied &
demi, pointues, liftes en-deffüs & couvertes en-
deffous d’un duvet ferrugineux & comme doré,
Au lieu de tige elle a une hampe à la maniète
des Amariliis, elle eft trigone & les fleurs, font
ii fon fommçt, difpofées en grappes placées alternativement,
peu dégagées & longues d’un
pouce & demi. Çommerfon n’a vu que les fruit»
naiffans. Cette plante croît dans ITfle-de Bourbon.
Culture.
Nous ne difiinguerons point dans la culture
les deux efpèces de Dianelles, que nous afli-
millons à celle des Crinoles. ( Voyei leur ar-?
ticle. ) • -
A l’égard de la multiplication, on ne peut
rien dire de pofitif fur celle de la Dianelle n.° 2^
par la racine, puifque fa forme eft jufqu’à pré-
lent inconnue. Celle du n.° 1 fe peut facilement
divifer, en obfervant de laiffer au moins un oeil
à chaque fragment, & de ne planter les deux
parues divifées qu’après que le defféchement
aura fermé l ’orifice des vaiffeaux. Cette opération
fe fait avec fuccès en mars, & la conduite ultérieure
eft la même que pour les Crinoles pro-,
vignées.
Les graines fe doivent femer partie auflitét
qu’on les aura reçues, & partie en oétobre, dans
des petits pots remplis de fable de bruyère &
de terreau, enfoncés dans une couche de tan
recouverte d’un chaflis à vitrage, & on les gou^
verneroit comme celles des Ixies & Glayeufo#
( Voyei leur article. )
Vfages.
Ceux du n.° ï de ce genre, fe bornentaut
befoins de l’Ecole & aux agrémens de la lerr©
chaude : à ce dernier égard on ne peut pas crier
à l’infuffifanee, puifqu’â des fleurs déjà intéref-
fantes fuccèdent des baies d’une couleur vive &
brillante. Pour ce qui eft du n.° 2 , il eft d’abord
defirable pour occuper une place dans
le lieu confacré à la Démonftration. ( F . A .
Qu ESN É. )
DIANTHÈRE„ Nom d’un genre établi par
Linné, & que Lamarck a réuni au genre dés
Carmantines. Linné les diftingue par un cara&ère
abfolument artificiel; car, fuivant lui, les Car—
mantines ont une feule anthère à l ’extrémité de
chaque filament, & les pianthères en ont deux.
Mais ce qu’il appelle deux anthères n’eft 'qu’un
écartement des deux loges de l’anthère, très-
marqué dans certaines efpèces, & peu fenfible
dans d’autres. On trouvera la defcription des
diverfes Dianthères, fous, le mot Carmantine,
( X. R e yn i e r . )
DIANTONG. On donne ce nom, aux Mo-
luquçs, à un paqnet de folioles ou braélées qui
terminent, en forme de tète, les régimes de
Bananes. Ces Piantongs, qu’on nomme autrement
Coeur, fervent à la nourriture des hommes,
comme les.extrémités du Palmier nommé vul-
| garnement Chou palmife. C’eft, difent les Voyais
ij