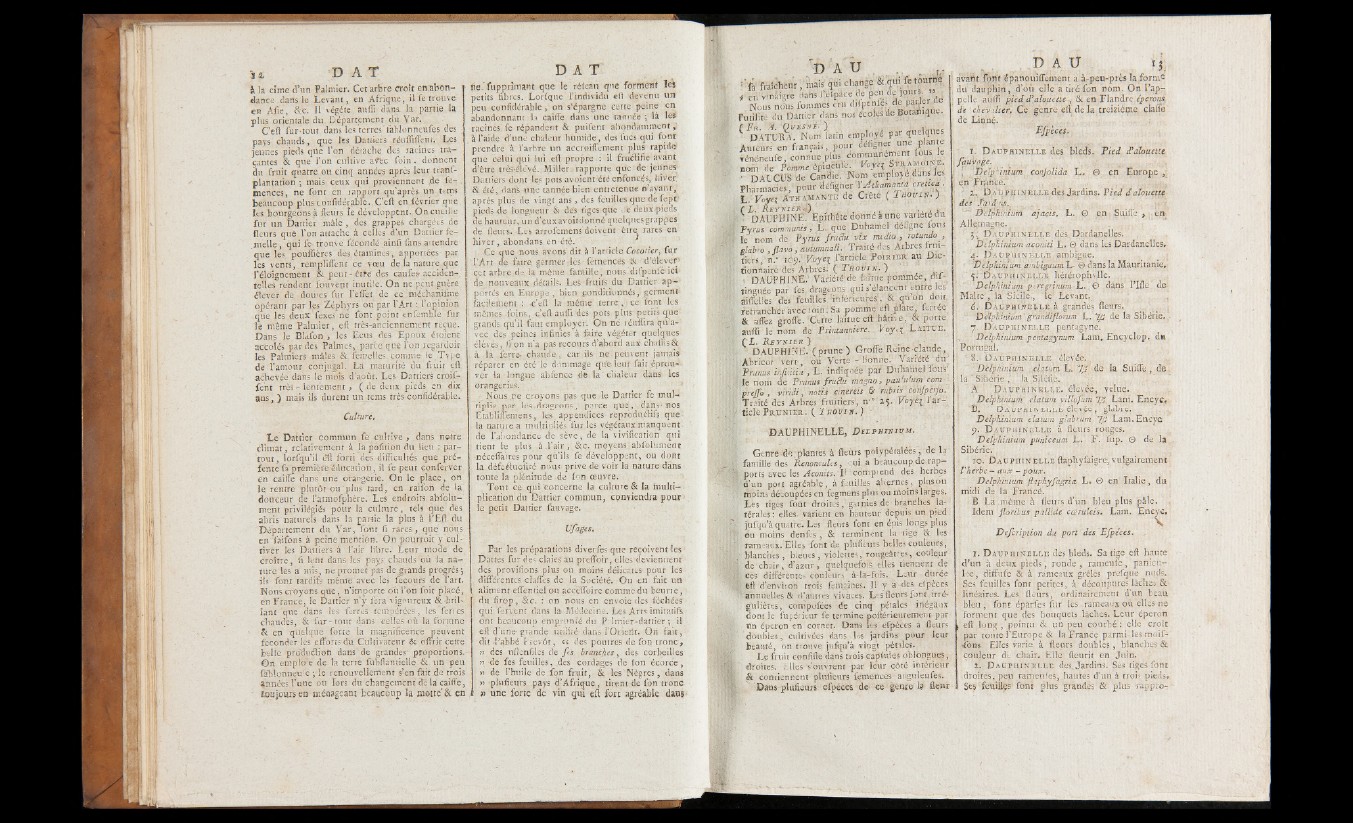
à là cime d’un Palmier. Çet arbre croit en;àbôn-
dance dans le Levant, en Afrique, il fe trouve
en Alîe, &c. Il végété aufli dans, la partie la
plus orieptale du Département du Var.
C’eft fur tour dans les ten es T'ablonncufes dès :
pays chauds, que- les Dattiers réufliflenf.- Les
jeunes pieds que l’on détache des racines traçantes
& que l’on cultive a fée foin . donnent
du fruit quatre ou cinq années après leur tranf-
plantatîon ; mais ceux qui proviennent ,dfr ffi-
mencës, ne font en rapport qu’après un tems
beaucoup plus confidêrable. MC’eft en février que
les bourgeons à fleurs fe développent. On cueille
fur un Dattier mâle, des grappes chargées de
fleurs qué l’on attache à celles d’un Dattier femelle,
qui fe- trouve fécondé_ainfi fans attendre
que les pouffières. des. étamines,, apportées par
les vents,.remplifienf ce voeu de la nature.que
l'éloignement & peut - êtfe des çaufes- accidentelles
rendent fouvent inutile. On ne peut guère
élever de doutés fur l'effet/de ce. mécbaniflne
opérant par les Zéphyrs ou par l’Art : l’opinion
que les deuxfexes ne font point enfemble fur
le même Palmier, eft très-anciennement reçue.
Dans le Bîafon > les Ècus des Epoux étoîenf
accolés par dés Palmes,, parce'que l’on regarcîoit
les Palmiers mâles &. femelles, comme le . Ty pe
de l’amour conjugal. Là maturité du fruit eft
achevée dans le mois d’août. Les Dattiers croif-
fe’nt très - lentement, ( .de deux pieds en dix
ans ) mais ils durent un tems très-confidêrable.
Culture,
Le Dattier commun fe t cultive > dans notre
Climat, relativement à la pofirion du lieu : partout
, lorfqu’i l e l l forti des difficultés que préfente
fa première éducation, il fe peut conferver
en calife dans une orangerie. On le place, on
le rentre plutôt-ou plus tard, en rai fon de la
douceur de l’atmofphère. Les endroits abfolu-’
ment privilégiés pour la culture, tels que des
abris naturels dans la partie la plus à PEffi du
Département du Var, font fi rares, que nous
en faifôns à peine mention. On p.ourroit y cultiver
les Dattiers à l’air libre; Leur mode dei
croître , fi lent dans les pays-chauds'où la nature
les a mis , ne promet pas de grands progrès -,
sis- font tardifs même avec les fecoufs de l’art.
Nous croyons que, n’importe où l’on foir placé,,
en France, le Dattier n ’y fera vigoureux & brillant
que dans les ferres tempérées, les feri es
chaudés,V& fur-tout dans celles, où la fortune
v & en quelque forte la magnificence peuvent
féconder les efforts du Cul tivateur & offrir cette
belle production dans- de grandes” proportions. -
On emploie de là terre fubflàntielle & un peu
lab'-Qnneu'e - le renouvellement s’en fait de trois
annéèsTune ou Tors du changement de là caiffe,
toujours en ménageant beaucoup la moue* & en
fie.Supprimant que le réleau que forment les
petits fibres. Lorfque l’individu «fi devenu un
peu confidêrable, on s’épargne cette peine en
abandonnant h caiffe dans une tannée-, là les
racines, fe répandent & puifent abondamment
à l’aide d’une chaleur humide, des lues qui font
prendré à l’arbre un accroiffement plus rapide
que celui qui lui eft propre *, il fructifie avant
d’être très-àe'vé. Miller./rapporte que de jeunes
Dattiers dont les pots avoient été enfoncés,: hiver.
& été, dans une tannée bien entretenue n’ayânr,
après plus de vingt ans? des feuilles que de fept
pieds de longueur & dés tiges que >:e deux-pieds
de hauteur, un d’eux avoitdonné quelques grappes
dé fleurs. Les arrofemens doivent être rares en
hiver, abondans en-étë.
Ce que nous ayonsdit à l’article Cocotier, fur
l ’Art de faire germ.er-les-fémences d’élever1'
çet arbre de la même famille, nous dïfpenféiçi-
de nouveaux détails. Les fruits du Dattier apportés
en Europe, bien conditionnés, germent
facilement : ^c’eft la même terre;, : ce font les
mêmes foins, c’efl auffi des p.ots plus petits que
grands qu’il faut employer. On né réuflïra qu’avec
dès peines infinies à faire végéter quelques
élèves, /ion n’a pas recours d’abord aux' chalusSc
, à la ferre- chaude, car ils ne peuvent jamais
/ réparer en été 'le dommage qu^leur fair/éprou--
ver la longue abfence de la ' clialeur dans les
Orangeries.
Nous ne croyons pas que le Dattier fe multiplie
par les drageons, parce que, .dans - nos
Etabîiffemens, les/appendices reproductifs que
la nature a multipliés fur les végétaux manquent ■
de l’abondance de sève, de la vivification qui
tient le plus à .l’a ir , &c. moyens abfûliiment
-néceffaires pour qu’ils fe développent, ou dont
■ la défeéluofiré nous prive de voir là nature dans
toute la plénitude de fon oeuvre-.'
Tout ce qui Concerne la culture & la Inulti-
. plicatipn du Dattier commun, conviendra pour
le petit Dattier fauvage. à
Ufages,
Par les préparations diverfes que reçoivent les
Dattes fur des claies au preffoir, elles deviennent
des provifions plus où. moins délicates pour lés -
différentes claffes de la Société. On en fait un
aliment effemiel où acceïïbire comme du beurie,,
• du firop, &c. : on nous en envoie des .féchées'
qui fervent dans là Médecine. Les Arts imitatifs
ont beaucoup emprunté du P: Imiér-dattier i il
eft d’une-grande .imlité dans l’Orient. Ori fait,
dit d’abbé fre vôt, et des poutres de fon tronc,
- » des uflenfilés de f s branches, des corbeilles
» de Tes fenil les, des cordages dé Ion écorce,
» de l’huile de fon fruit, & les’ Nègres , dans
1 v) -plufieurs pays d’Afrique, tirent de Ion tronc
i » une forte de vin qui eft fort agréable dans
: ’iâ fraîdhènr mais qui changf -fe toufne
■ ï P f f l p m rttpâcem tiXM m a s
Nous nous fomm'ës M ?Wpen%
l uul'té du Dattier clans nos étolts de Botafiiq .
. ^JATÜR^V. Nom latin employé Par quélçjuej
Auteurs en français1, pour dëfigner u” e “.P
Vénéneufe, connue plus communément fous le
n o S de titane.
‘ DAUCUS de Candie1 Nom employé dans les
Pharmacies, pour déficher 'VAïatAânid creticà.
h- Voyn A TH A ilA 'N TK 'd e C ïê t ê ( T uoviii. )
n HDApUiPPHpIWNEk E1 pithète donné a. une variété du
Tyrtà commuais, L. que Duhamel déSgne fous
le nom de Pyrus fruSu vix midio , rotundo ,
glabro 3 flavô, autumnclï. Traité des .Arbres tVui-
tiers ^n.° 10$/ .1 article Poirier, au Dictionnaire
des Âtbfési ( Ttio ù'rx. ) . -
- DAUPHINE.’ Variété1 dè Mtue pomtnée, dii-
tinguée par fes, drageons gui s’élancénr entré les
aiffeliés .dès' feuilles îihférieùres;, & i qà on don.
fetrarichér avec foin: Sa pomme eft .plate, fertéè
& affez groffe. Cette laitue eft hâtive; « porte,
au/fi le nom de Printannière. Voy<i L aitue.
CL. Re y n ie r ) •
DAUPHINE.'( prune ) Groffe Reine •claudq ,
Ahricor vert;, où Verté — bottne.; Variété du
: Prunus irjîutia , L. indiquée par Duhamel fou's'
■ le nom de Prunus fruSu magno 3 pauiuiutji càm -
; prèjfo y viriâi , . nàti's çinerèis & rubris cürfpérfo.
Tr.ùté des-Arbres fruitiers1, n-° 25.. Foÿè^l’ar-
t ticle Pr u n ié r . ( T uouik. )
DAUPHINELLE, D el ph in ium .
■ Genre de plantés à fteùrs -polypétaléés j de la
farnillé des Renoncules, qui a beaucoup, de rapports
avec les Aconits.Ti icompiend des herbes
d’un port agréable, àfeuiiles alternes, plus ou
moins découpées en fegmens plus ou moins larges.
Lès tiges fout droites, garnies de branches latérales:
elles.'varient^en hauteur depuis un pied
jüfqu’à quatre. Les fleurs font en épis longs plus
bu moins denfes , & terminent la tige & les
•rameaux. Elles font de plufiéuis belles couleurs,
blanches, bleues, violettes, rougeâtres,.couleur
de chair, d’azur? quelquefois elles tiennent de
ces différentes couleurs à-la-fois. Leur durée
eft d’environ trois femaines. Il y a d es e( pèces
annuelles & d’autres vivaces. Lt s fleurs font.irrégulières,
compofées de cinq pétales inégaux
dont le fupérieur fe termine poft;éri.eurement~par
ttn éperon en corner. Dans lés efpèces à fleurs
doubles, cultivées dans ;1ôs jardins pour leur
beauté, on trouve jufqu’â vingt pétales.
Le fruit conlifie dans trois capfuies oblongues,
droites. Elles s’ouvrent par leur côté intérieur
& contiennent plufieurs femences anguleufes.
Dans plufieurs efpèces de- ce genre 1? fleur
avant font ëpanouiffément a à-peu-près la JormP
du (Jatiphin, d’ôù elle a tiréTon nom. On l ’ap-
pelle auffi pièd d*alouette-, & en Flandre éperons,
de : chev iller, Ce genre, ell de la treizième, dalfe
de Linné.
EJpècçs.
i l D au'phinelle des bleds. Pied d'alouette
, JaUyqge.
; • . Delphinium conjolida L . © en Europe ,
| en France/
: 2.L ' D.au pîi 1 welde. des Jardins. Pied datouetpe
des fard ’P?.' t |',y.
'"Delphinium djacis. L. © en Suifîe > en
’ Allé,magne.
; - 3 : P au pRin e l l e des Dardanelles.
Delphinium aconiti L . P dans les Dardanelles*
1 ' 4. D a üFi-ïiN ÊL le ,;àmbjgue..
t>/lplùki^àmbf^ûm L. © d’ans la Mauritanie,’
5: D A'üpiïmRLrè h'ërêrop hy .lle..
’Delphipîiim pcregnnüm-. L . ' © dans PIfle de-
Malte1, làr ^îçîlé;, ' le • Levant.
6. DÀjjRHijvEÊLE.à grandes fleurs.
Delphinium ‘ gràndijlorum L. de la Sifiériè.
; - 7. D auphinelee pentagyne.
k Delphinium pentagynum Lam. Encyçlop. dm
Portugal.'
\ r; 8.: P à'uph iNisELE élevée/. '
Delphinium, ^elatiim L/?$jf.^de la Suiffe, de.
la " Sibérie ! ,lâ Siiéiie.
A D a u ph in e lé e . élevée, yelué.
Delphinium eïaturii yillofurh *ys Lani. Encyç*
'% ' Dauphin e l le - éleyéé, glabre.
Delphinium elatuni glabrum. JJj Lam.Encyc
c). D auphine'lLjE à fleurs’ rouges.
Delphinium pufiiceùm L . F. fup. © de la
Sibérie.,
to. D au ph in e l le ftaphyfaigrej vulgairement
Vherbe - aux - poux.
Delphinium ftqphyfagria L . 0 en Italie, du
midi de la Fraricé.
B La .même à fleurs d’un bleu plus pâle. ,
Idem floribus pallide ccèruleis. Lam. Encyc*
Defcription du port des Efpèces. ,
1. D a^ph in e l le des bleds. Sa tige eft haute
d’un à deux pieds, ronde , rameufe, panicu-T-
lé e, diffufe & à rameaux grêlés prefque nucîs.
Ses fetiillès font petites, à découpures lâcher &
linéaires. Les;1 fleurs, ordinairement d’un beau
1 bleu , font éparfes fur lés -rameaux où elles ne
forment que dés bouquets lâches. Leur éperon
E eft long , pointu & fin peu courbé : elle croît
par toitre l’Europe & la France parmi-les moif-
^ons Elles varie à fleurs doubles , blanches &
couleur dè chair. Elle fleurit en Juin.
2. D au ph in e l le des.Jardiris. Ses tiges font
droites, peu rameutes;, hautes d’un à trois pieds*
Ses feuilles1 font plus grandes & plus rappror