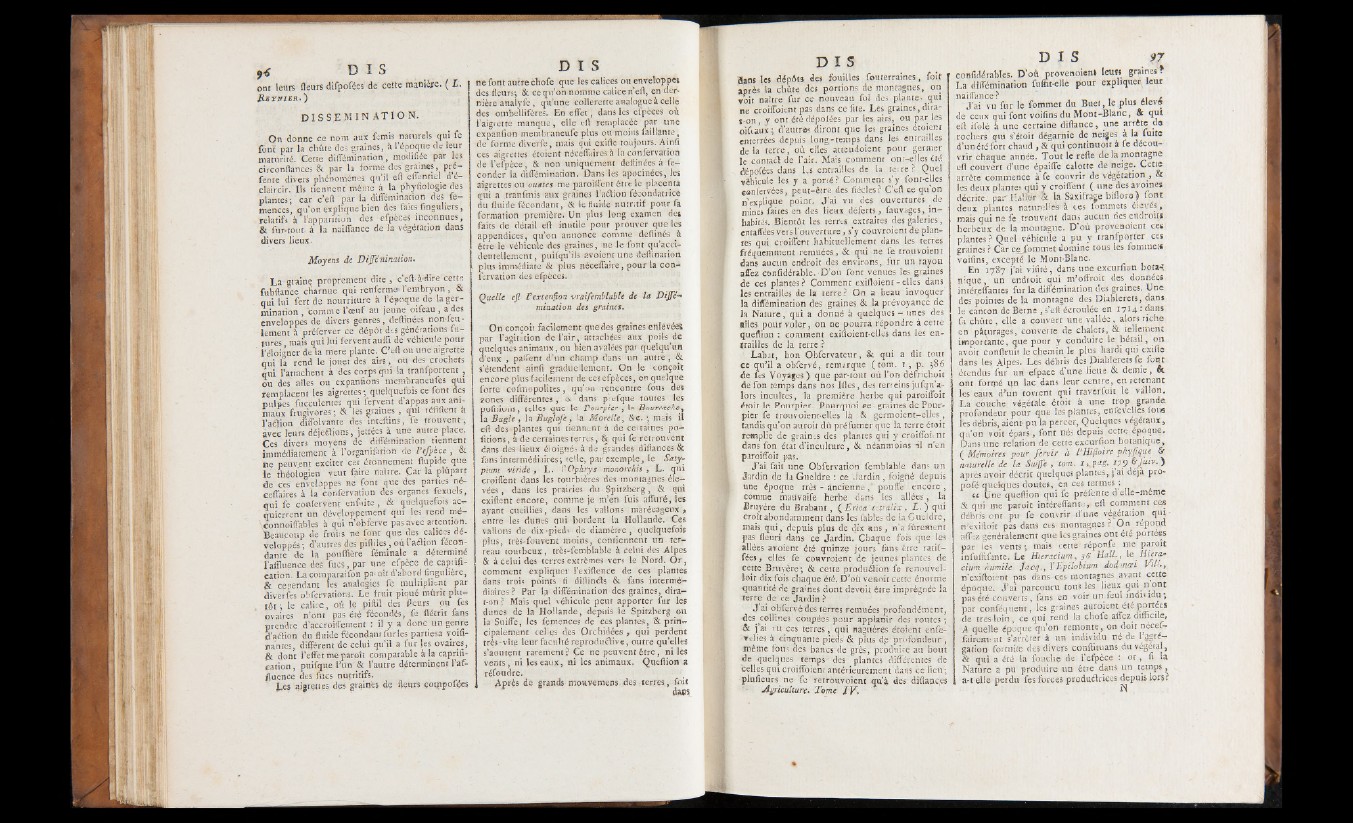
D I S
ont lents fleurs difpofées de cette M M M L. I
RS TNIER. )
D I S S E M I N A T I O N .
On donne ce nom aux femis naturels qui fe
forif par la chute des graines, à l’époque de leur
maturité. Cette diffémination, modifiée par les
circonftances & par la forme des graines, préfente
divers phénomènes qu’il eft elTentiel d é-
claircir. Ils tiennent même à ta phyfiologie des
plantes; car c’eft par la diffémination des fe -
mences, qu’on explique bien des faits finguhers,
relatifs à l’apparition des efpèces inconnues,
& fur-tout- à la naiflance de la végétation dans
divers lieux.
Moyens de Difté ni nation.
La grainq proprement dite, c’eft-à-dire cette
fubftance charnue qui renfermer l’embryon , &
qui lui fert de nourriture à l’époque de la germination
, comme l’oeuf au jeune oifeau , a des
enveloppes de divers genres, deftinées non-feulement
à préferver ce dépôt des générations futures
mais qui lui fervent aufïi de véhicule pour
l’éloigner de la mere plante. C’eft ou une aigrette
qui la rend le jouet des airs, ou des crochets
qui l’attachent à des corps qui la tranfportent , !
ou des ailes ou expanfions membraneufes qui
remplacent les aigrettes ; quelquefois ce font des
pulpes fuccuientes qui fervent d’appas aux animaux
frugivores ; & les graines , qui téfiftenr à
l ’aélion diffolvante des inteftins, fe trouvent ,
avec leurs déje&ions, jettées à une autre place.
Ces divers moyens de diffémination tiennent
immédiatement à l’organifarion de l’ efpèce , &
ne peuvent exciter cet étonnement ftu pute que
le théologien veut faire naître. Car la plupart
de ces enveloppes ne font que des parties né-
ceffaires à la conferyation des organes fexuels,
qui fe confervent enfoite , & quelquefois aCr-
quierrent un développement qui les rend mé-
\connoiftables à qui n’obferve pas avec attention.
Beaucoup de fruits ne font que des calices développés;
d’autres des piftiles, où l’a«5lion fécondante
de la poufflère féminale a déterminé
faffluence des fucs, par une efpèce de caprification.
La comparaifon pa< oit d’abordï- fin gu Hère,
& cependant les analogies fe multiplient par
diverfes ohfervations. Le fruit piqué mûrit plutôt
; le calice, où le piftil des fleurs pu fes
ovaires n?ont pas été fécondés, fe flétrit fans
prendre d’accroiffement ; il y a donc un genre
d’aéiion du fluide fécondant furies partiesa voifi-
nantes, différent de celui qu’il a fur les ovaires,
£t dont l’effet me paroît comparable à la caprification
, puifque l’un & l’autre déterminent l’affluence
des lues nutritifs.
Les aigrettes des griffes de fleurs çotppof^es
D I S
ne font autre chofe que les calices ou «enveloppe*
des fleurs; & ce qu’on nomme calice n’eft, en dernière
analyfe , qu’une collerette analogue à celle
des ombellifères. En e ffet, dans les efpèces où
l’aigrette manque, elle eft remplacée par une
expanfion membraneufe plus ou moins lai H ante,
de forme diverfe, mais qui exifte toujours. Ainft
ces aigrettes étoient néceflaires à la confervation
de l’efpèce, & non uniquement deftinées à féconder
la diflémination. Dans les apocinées, les
aigrettes ou ouates me paroiffent être le placenta
qui a tranfinis aux graines l’aélion fécondatrice
du fluide fécondant, & le fluide nutritif pour fa
formation première. Un plus long examen des
faits de détail eft inutile pour prouver que les
appendices, qu’on annonce comme deftinés jà
être le véhicule des graines, ne le font qu’acci-
dentellement, puifqu’ils avoient une deftination
plus immédiate & plus nécefl'aire, pour la con-<
fervation des efpèces.
Quelle eft Vextenfton vraifemblable de la Difle-*
mination des graines.
On conçoit facilement que des graines enlevées
par l’agitation de l’air, attachées aux poils de
quelques animaux, ou bien avalées par quelqu’un
d’éux , paffent d’un champ dans un autre, &
s’étendent ainft gradueilement. On le conçoit
encore plus facilement de ces efpèces, en quelque
forte cofmopolites , qu’on rencontre fous des
, zones différentes, & dans p-cfque toutes les
polirions, telles que le Pourpier, la Bourrache,
la Bugle, la Buglofe , la Morelle, &c. ; mais il
eft des plantes qui tiennent à de certaines po-
fitions, à de certaines terres, & qui fe retrouvent
dans des lieux éloignés à de grandes diftances &
fans intermédiaires; telle, par exemple, lé Saty-
piunt viride, L. VOphrys monorchis, L. qui
croiflcnt dans les tourbières des montagnes éle-—
vées, dans les prairies du Spitzberg, & qui
exiftent encore, comme je m’en fuis affuré, les
ayant cueillies, dans les vallons marécageux,
entre les dunes qui bordent la Hollande. Ces
vallons de dix-pieds de diamètre, quelquefois
plus, très-fouvent moins, contiennent un terreau
tourbeux , très-femblable à celui des Alpes
& à celui des terres extrêmes vers le Nord. O r ,
comment expliquer l’exiftence de ces plantes
dans trois points fi diflindls & fans intermédiaires
? Par la diffémination des graines, dira-
t-on ? Mais quel véhicule peur apporter fur les
dunes de la Hollande, depuis le Spitzberg ou
la Suiffe, les femences de ces plantes, & prin«*
cipalem.ent cellgs des Orchidées , qui perdent
très-vite leur faculté reproductive, outre qu’elles
s’aoûtent rarement ? Ce ne peuvent être, ni les
vents, ni les eaux, ni les animaux. Queftion a
réfoùdre.
Après de grands mouvemens des terres, fait
dans
D I S
flans les dépôts des fouilles fouterraines, foit
après la chûte des portions de montagnes, on
voit naître fur ce nouveau fol des plante* qui
ne croiffoient pas dans ce fite. Les graines, dira-
t-on, y ont été déposées par les airs, ou par les
oiftaux ; d’autres diront que les graines étoient
enterrées depuis long-temps dans les entrailles
de la terre, où elles attendoient pour germer
le contaél de l'air. Mais comment onr-eJles été
dëpofées dans Ls entrailles de . la terre ? Quel
véhicule les y a porté? Comment s’y fonr-ejles
«»nfervées, peut-être des fiécles ? C eft ce qu’on
n explique poinr. J ’ai vu des ouvertures de
mines faites en des lieux déferts, fauvages, inhabités.
Bientôt les terres extraites des galeries,
entaffées vers l’ouverture, s’y couvroient de plantes
qui croiflenr habituellement dans les terres
fréquemment remuées, & qui ne fe trouvoient
dans aucun endroit des environs, fur un rayon
affez confidérable. D’où font venues les graines
de ces plantés? Comment exifloient-elles dans
les entrailles de la terre ? On a beau invoquer
la diffémination des graines & la prévoyance de
la Nature, qui a donné à quelques - unes des
ailes pour voler, on ne pourra répondre à cette
queftion : comment exifloient-elles dans les entrailles
de la terre ?
Lab.it, bon Obfervateur, & qui a dit tout
ce qu’il a obfervé, remarque ( tom. I , p. 306
de fes Voyages ) que par-tout où l’on défrichait
de fon temps dans nos Ifles, des terreins jufqn’a- jj
tors incultes, la première herbe qui paroiffoit |
étoit le Pourpier. Pourquoi e e . graines de Pourpier
fe trouvoient-elles là & germoient-elies,
tandis qu’on auroit dû préfumer que la terre étoit
remplie de graines des plantes qui y croiffohnt
dans fon état d’inculture, & néanmoins i l n’en
paroiffoit pas.
J ’ai fait une Obfer.vatiôn femblable dan? un
Jardin de la Gueldre : ce Jardin, foigné depuis
une époque très- ancienne ,’ pouffe encore ,
comme mauvaife herbe dans les allées, la
Bruyère du Brabant, ( Erica tttralix , L . ) qui
croît abondamment dans les fables de la Gueldre,
mais qui, depuis plus de dix ans, n’a fùrement
pas fleuri dans ce Jardin. Chaque fois que les
allées avoient été quinze jours fans être ratif—
fées, elles fe couvroient de jeunes plantes de
cette Bruyère ; ■ & cette produ&ion fe renouvel-
loit dix fois chaque été, D’où venoit cette énorme
quantité de graines dont devoit être imprégnée la
terre de ce Jardin ?
J ai obfervé des terres remuées profondément,
des^coUines coupées pour applanir des routes ;
& j’ai vu ces terres, qui naguères étoient ente-'
velies à cinquante pieds & plus dp'profondeur ,
même fous des bancs: de grès, produire au bout
de quelques temps' des plantes différentes de j
celles qui croiffoient antérieurement dans ce lieu;
plufieurs ne fe retrouvoient qu’à des diflaoeps
Agriculture. Tome IV .
d i s
confîdérables. D’où provenoienl leu« graine* ?
La diffémination fumt-elle pour expliquer leur
J ’ai vu fur le fommet du Buet, le plus élev<$
de ceux qui font voifins du Mont-Blanc, & qui
eft ifolé à une certaine diftance, une arrête do
rochers qui s’étoit dégarnie de neiges à la fuite
d’un été fort chaud , & qui çontinuoit à fe découvrir
chaque année. Tout le refte delà montagne
eft couvert d’une épaiffe calotte de neige. Cette
arrête commence à fe couvrir de végétation , &
les deux plantes qui y croiffent ( une des avoines
décrite: par lUlfttr la Saxifrage bifloro) font
deux plantes natureHcV à ces Commets élevés,
mais qui ne fe trouvent dans aucun des endroits
herbeux de la montagne. D ou proveaoient ces
plantes ? Quel véhicule a pu y tranfporter ces
graines ? Car cejommet domine tous les Commets
voifins, excepté le Mont-Blanc.
En 1787 j’ai vifiré, dans une excurfmn bota*?.
nique, un endroit qui m’offroit des^ données
intéreffanres fur la diffémination des graines. y nc
des pointes de la montagne des Diabierets, dans
le canton de Berne , s’eft écroulée en 1714 : dans
fa chûte, elle a couvert une vallée, alors riche
en pâturages, couverte de chalets, & .tellement
importante, que pour y conduire le bétail, on .
avoir conftruit le chemin le plus hardi qui exifte
dans les Alpes. Les débris des Diabierets fe font
étendus fur un efpace d’une lieue & demie, &
ont formé un lac dans leur centre, en retenant
I les eaux d’un tovrpnt qui traverfoit le vallon.
I La couche végétale étoit à une trop grande.
profondeur pour que les plantes, enfevelies fou«
| les débris, aient- pu la percer, Quelques végétaux,
qivon voit épars , font nés depuis cette époque*
Dans une relation de cerre excttriîon botanique,
( Mémoires pour fervir à l’Hiftoire phyjique &
naturelle de la Suife , tom. i Kçag. 17? bjuiv. )
après avoir décrit quelques plantes, j’ai déjà pro-
pofé quelques doutes, en ces termes :
ce Une queftion qui fe préfente d elle-même
& qui me paroît intéreffants, eft comment ces
débris ont pu fe couvrir d’une végétation qui -
n’exiftoit pas dans ces montagnes ? On répond
a fit; z généralement que les graines ont été portées
par les vents ; mais cette réponfe me paroît
infuffifante. Le Hieracium, 36 Hall., \e Hiera*
cium humile jacq., l’ hpilobiwm dodoncci V u .,
n’exiftoient pas dans ces montagnes avant cette
époque. J ’ai parcouru tous les lieux qui n ont
pas-été couverts, fans en voir un feul individu;
par conféquent, les graines auroient été portées
de très-loin, ce qui rend la chofe affez difficile,
A quelle époque qu’on remonte, on doit nécef-
faircm; nt s’arrêter à un individu né de 1 agrégation
fortuite des divers conftituans du végétal,
& qui a été la fouche de l’efpèce : o r , fi la
Nature a pu produire un être daus un temps,
a-t elle perdu fes forces productrices depuis lors.