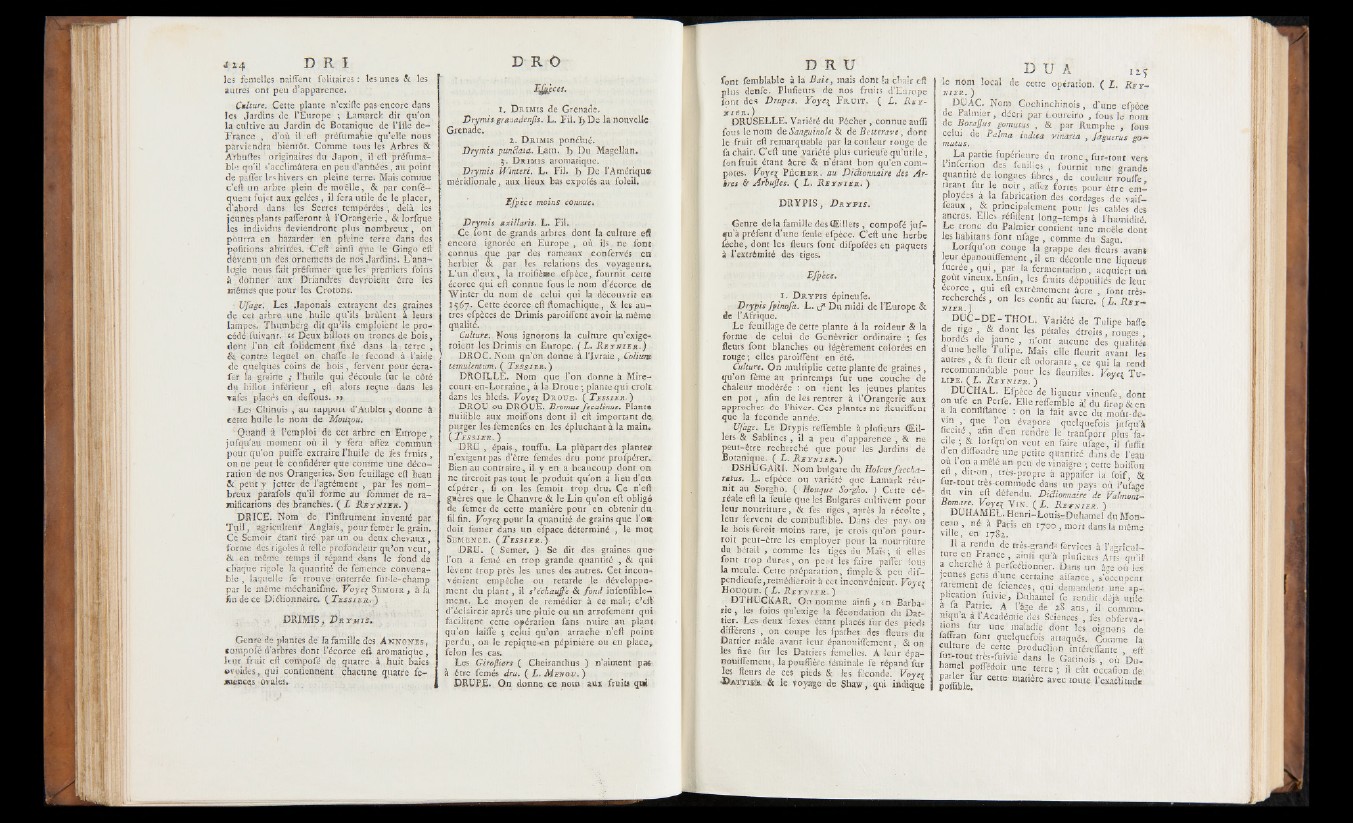
les femelles naiffent folitaires r les unes & les
autres ont peu d’apparence.
Culture. Cette plante n’exifte pas encore dans
les Jardins de l’Europe- •, Lamarck dit qu’on
la cultive au Jardin de Botanique de l’Ifle de-
France , d’où il eft préfumabie qu’elle nous
parviendra bientôt. Comme tous les Arbres &
Arbuftes originaires du Japon, il eft préfuma-
b k qu’il s’acclimâtera en peu d’années., au point
de pafl'er le«; hivers en pleine terre. Mais comme
c’efl un arbre plein de moelle, & par confé—
qlient fujet aux gelées, il fera utile de le placer,
d’abord dans . les Serres tempérées -, delà les
jeunes plants pafferont à l’Orangerie, &lorfque
les individus deviendront plus nombreux , on
pburra en bazarder en pleine terre dans des
pofitions ' abritées. • C’eft ainfi que le Gingo eft
dèvenu un des;;ofneiiietls de nos Jardins. L ’analogie
nous fait préfumér que les premiers foins
à d o n n e ra u x ’ Driandres devroient être les
mêmes que pour les Crotons.
- Ufage. Les Japonais extradent des graines
de cet arbro; une huile qu’ils brûlent à leurs
lampes. Thumberg- dit qu’ils emploient le procédé'
fuivanr. 'c« Deux billots ou troncs de bois,
dont l’un eft folidement ,fixé dans la terre ,
& contre: lequel on chaffe le fécond à l’aide
de quelques coins de bois , fervent pour écra-
fer la graine ,* l’huile qui découle fur le côté
du billot inférieur , eft alors reçue dans les
vafes placés en deflous. »
Les Chinois * au rapport d’A ub lct, donne à
cêt-te huile le nom de Mcu{out
Quand à Remploi de cet arbre en Europe ,
jufqu’au moment où il ‘y fera aftez commun
pour qu’on puifle extraire l ’huile de fes fruits,
on ne peut iè coiifidérer que comme Une décoration
de nos Orangeries. Son feuillage eft beau
& petit y jetter de l’agrément , par les nombreux
pafafols qu’il forme au fommet dé ramifications
des branchés. ( L Re y îTi 'er. )
DRICE. Nom de. l’inftrument inventé par
T u l l, agriculteur Anglais, pour femér le grain.
Ce Semoir étant tiré par un ou deux chevaux,
forme des rigoles à telle profondeur qu'on veut,
& en même temps il répand dans le fond de
chaque rigole là quantité de fèméncë convenable
, laquelle fe trouyp- enterrée fiit-le-champ
par le même méchanifmé. 'Voyez Sem o ir , à la
fin de ce DiéHonnaire. { T es sierr ) t
DÏÙMÏS, B r YJUTS..
Genre de plantes dé fa famille des A n non e s ,
«ompoîé d’arbres dont Fécorce eH aromatique ,
leur fruit eft co'mpofé de. quatre- à huit baies
©voides, qui contiennent chacune quatfe fe -
jnencçs ovales.
ï jp § i | :
1 . D r im i s de Grenade.
Drymis granadenfisj L . Fil. ï) De la nouvelle
Grenade.
2 . D r im i s p o n é lu é .
Drymis punclata. Lam. ï) Du Magellan.
3. Drimis aromatique.
Drymis Winteri. L . Fil. T) De l'Amérique
méridionale, aux lieux bas expofés au foleil.
Efpèce moins connue»
Drymis axillaris. L. Fil.
Ce font de ;grands arbres dont la culture eft
encore ignorée en Europe où ils. ne font
.connus que par des rameanx confervés en
herbier & par les relations des voyageurs.
L ’un d’eux, la troifièoee espèce, fournit cette
écorce qui eft. connue fous le nom d’écorce de
Winter du nom de celui qui la découvrit en
1567. Cette écorce eft ftomachique, & les autres
efpèces de Drimis paroiffent avoir la même
qualité.
Culture. Nous ignorons la culture qu’exige-
roient les Drimis en Europe. ( L. Re ynie r .)
DROC. Nom qu’on donne à l’Ivraie , Colium
temulentum. ( Tessier»)
DRQILLE. Nom que l’on donne à Mire-
court- en-T-orraine, à la Droue -, plante qui croît
dans les bleds. Voyei D r o u e - ( Tessier. )
DROU ou DROUE. Bromus fecalinus. Plante
nuifibie aux moiffons dont il eft important de,
purger les femenfes en les épluchant à la main.
\Tessier. )
DRÙ , épais , touffu. La plupart dès plantes-
n’exigent pas d’être femées dru pour profpérer..
Bien au contraire , il. y en a beaucoup dont, on
ne tireroit pas tout le produit qu’on a lieu d’en
efpérer , fi on les femoit trop dm. Ce n’eft
gttères que le Chanvre & le Lin qu’on eft obligé
de femer de. cette manière pour en obtenir du
fil fin. Voye[ pour la quantité de grains que l’on
doit femer dans un efpace déterminé , le mot
Se m e n c e . (.Tessier.)
DRU. ( Semer. ) Se dit dès graines que-
Pon a femé en trop grande quantité , & qui
lèvent trop près les unes des autres. Cet inconvénient
empêche ou retarde .le développement
du plant , il s7échauffé & fond infenfible—
ment. Le moyen de remédier à ce mal-*, c'efV
d’ éclaircir après une pluie ou un arrofemenr qui
facilitent cette opération fans nuire au plant
qu’on lai fie 5 celui qu’on arrache n’eft point
perdu, on le repiqiie-en pépinière ou en place,,
félon les cas.
Les Girofliers ( Cheiranthus ) n’aiment pas
à être femés dru. ( L. Menou. )
DRUPE. On donne ce nom aux fruits qui
font femblable à la Baie, mais dont la chair eft
plus denfe. Plufieurs de nos fruits d’Europe
font des Drupes. Yoye\ F r u i t . ( L. R e y n
ie r -)
DRUSELLE. Variété du Pécher, connue auffi
fous le nom dtS a n g u in o le 8c de B e t te r a v e , dont
le fruit eft remarquable par la couleur rouge de
fa chair. C’eft une yariété plus curieufe qu’utile,
fon fruit étant àcrë & n’étant bon qu’en compotes.
Voye^ Pê ch e r , au Dictionnaire des A r bres
& Arb u fles . ( L . R e y n i e r . )
D R Y P IS , D r y p i s .
Genre delà famille des OEillets, compofé juf—
qu’à préfent d’une feule efpèce. C’eft une herbe
lèche, dont les fleurs font difpofées en paquets
à l’extrémité des tiges.
Efpèce.
1. Dr y p is épineufe.
Drypis fpinofa. L . o* Du midi de l’Europe &
de l’Afrique.
Le feuillage de cette plante à la roideur & la
forme de celui de Genévrier o rd in a ir e fe s
fleurs font blanches ou légèrement colorées en
rouge; elles paroiffent en été.
Culture. On multiplie cette plante de graines ,
qu’on fème au printemps fur une couche de
chaleur modérée : on tient les jeunes plantes
en p o t , afin de les rentrer à l’Orangerie aux
approches de l’hiver. Ces plantes ne fleuriffent
que la féconde année.
Ufage. Le Drypis reffemble à plufieurs OEillets
& Sabiines, il a peu d’apparence , & ne
peut-être recherché que pour les Jardins de 1
Botanique. ( L. R e ynier. )
DSHUGARI. Nom bulgare du Holcusfaccka-
retus. L. efpèce ou variété que Larnark réunit
au Sorgho. ( Houque Sorgho. ) Cette céréale
eft la feule que les Bulgares cultivent pour
leur nourriture,. & fes tiges , après la récolte,
leur fervent de combuftible. Dans des pays ouïe
bois ferôit moins rare, je crois qu’on pour-
roit peut-être les employer pour la nourriture
du bétail , comme les tiges du Maïs ; fi elles
font trop dures , on peat les faire paffer fous
la meule. Cette préparation, fimple & peu cîif-
pendieufe,,remédiôroit à cct inconvénient. Voyez
H o u q u e . ( L. Re y n ie r . )
DTHUCKAR. Gn nomme ainfi >. en Barbarie
j les foins qu’exige la fécondation du Dattier.
Les deux fexes étant placés fur des pieds
différons ,. on coupe les fpathes des fleurs du
Dattier m â le avant leur épanoniffemenr, & on
lés fixe fur les Dattiers f e m e l l e s . À leur épà-
nouiffement, la poufiïèi’e féminale fe répand fur
les fleurs de ces pieds & les féconde. Voye\
•Dattier & le Voyage de Shaw, qui indique
le nom local de cette opération. ( L. Re y nier.
)
DU AC. Nom Cochinchinois, d’une efpèce
de Palmier, décri par Loureiro , fous le nom
Boraffus gomutus , & par Rumphe , fous
celui de P aima indiea vïnatia . faguerus go~
mutus. ’ b
... ■^’.a Part^e Supérieure du tronc, fur-tout vers
1 mlernon des feuilles , fournit une grande
quantité de longues fibres, de couleur rouffe
tirant fur le noir , alfez fortes pour être employées
a la fabrication des cordages de vaif-
feaux , & principalement pour les cables des
ancres. Elles réfiftent long-temps à l’humidité.
Le^ tronc du Palmier contient une moële dont
les habuans font ufage , comme du Sagu.
Lorfqu on coupe la grappe des fleurs avant
leur épanouinement , il en découle une liqueut
fucrée, q u i, par la fermentatipn, acquiert utl.
goût vineux. Enfin, les fruits dépouillés de leur
écorce , qui eft extrêmement âcre , font très*
recherchés, on les confit au 'fu c re .V L. R e y n
ie r . ) , . V
D U C -D E -TH O L . Variété de Tulipe baffe
u î ? e \ ^ ^ont ^es pétales étroits, rouges
bordés de jaune , n’ont aucune des qualité»
dune belle Tulipe. Mais elle fleurit avant les
autres, & fa fleur eft odorante, ce qui la rend
recommandable pour les fieuriftes. Vevci T u . U RB. (Z. Rïyvir-r,. )
DDCHAL. Efpèce de liqueur vineufe. dont
° , 6 e5„Perre- Ellerèffemble àf du firop&en
a la confiftance : on la fait avec du moût-devin
que l’on évapore quelquefois jufqu’à
ficcité , afin d’en rendre le tranfport plus facile
; & lorfq.u’on veut en faire ufage, il fuffit
d’en diffoudre une petite quantité d'ans de l’eau
ou 1 on a mêlé un peu de vinaigre -, cette boiffon
eli , dit-on, très-propre à appaifer la fo if, &
lur-tout très-commode dans un pays ôù i•ufage
du vin eft défendu, DiHionnaire de Valmont—
Bomare. Voye? V in , ( X. R e in 1er. y
DUHAMEL. Henri-Louis-Duhamel du Mort’—
cean , né à Paris en 1700, mort dans la même
ville, en 17S2..
II a rendu dé très-grand« ferviceS à l’agriculture
en France , ainlî qu’à plaf«u,s A re qu’il'
a cherché a perléèHonner. Dans un âge ou les.
jeunes gens d une certaine aifance , s’occupent
rarement de fciences, qui demandent une application
fuivie, Duhamel fe rendit déjà utile:
à. h P a t r ie . A l’âge de 2.11 ans, il commit
niqu’a à l’Académie des Sciences , Tes obferva-
tions fur une niàladïe dont les oignons de
(arrran font quelquefois attaqués-. Comme la
culture de cette produciion intéreffante , eft
lur-tout très-fmvie dans le Gatinois-, où Du-
hamel poffédoit une terre ; il eût occafion de
Paffihl tUr oeU6 mallère arec toute '’exatUtude