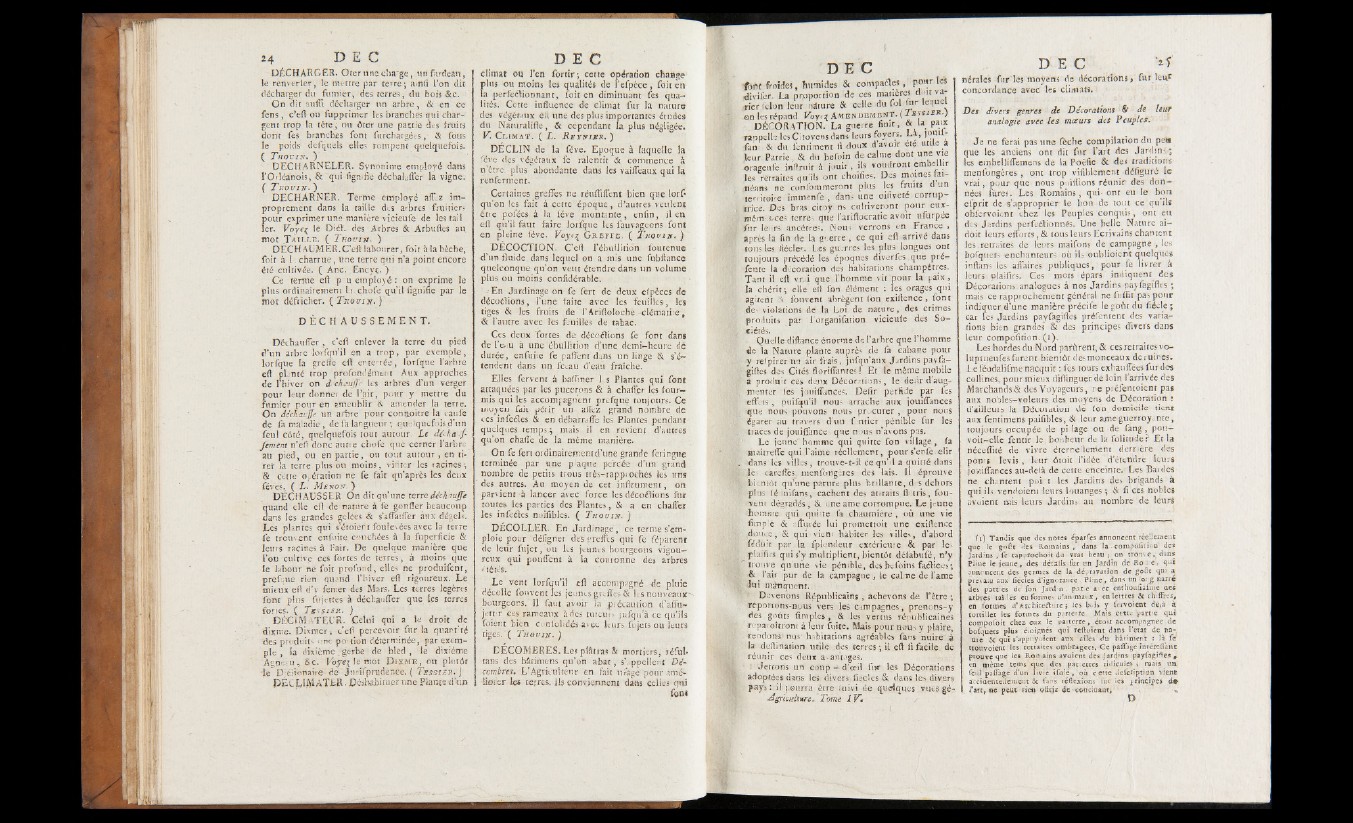
DÉCHARGER. Oter une cba'gc, un fardeau,
le renverler, le mettre par terre; ainü l’on dit
décharger du fumier, des terres, du bois &c.
On dit aufli décharger un arbre, & en ce
fcns , c’eft ou fupprimer les branches qui chargent
trop la tête& ou ôter une partie des fruits
dont fes branches font furchargées, & fous
le poids defqnels elles rompent quelquefois.
( T houin. )
DECHARNELER. Synonime employé dans
l’Ofléànois, & qui lignifie déchalafler la vigne.
( T houin. )
DECHÀRNER. Terme employé afEz improprement
dans la taille des arbres fruitiers
pour exprimer une manière vicieufe de les tail
1er. Voyeç le Diéh. des Arbres & Arbufies au.
mot T a il l e . ( T houin- )
DÉCHAUME R. C’eft labourer, foit à la bêche,
Toit à l . charrue, une terre qui n’a point encore
été cultivée. ( Ane. Encyç. )
Ce terme eft p u employé: on exprime le
plus ordinairement h Nchol'e qu’il lignifie par le
mot défricher. ( T h o u in . )
D É C H A U S S E M E N T .
Déchauffer , c’eft enlever la terre du pied
d*un arbre lorfqu’il en a trop, par exemple,
lorfque la greffe eft enterrée, lorfque l’arbre
efl pkmé trop profondément Aux approches
de l’hiver on dchaujj'.- les arbres d’un verger
pour leur donner de Pair, pour y mettre du
fumier pour en ameublir & amender la terre.
On déchaitjfe un arbre pour conooitre la canfe
de fa maladie, de fa langueur ; quelqucfois^d’un
feul côté, quelquefois tout autour. Le déchauf-
ftmtnt n’efi donc autre cbefe què cerner l’arbre
au pied, ou en partie, ou tout autour, en tirer
la terre plus ôu moins, viiirer les racines;
& cette opération ne fe fait qu’après les deux
fèves. ( L. Menon.*)
DÉCHAUSSER On dit qu’une terre décknuJTe
quand elle efl de nature à fe gonfler beaucoup
dans les grandes gelées & s’affaiffer aux dégels.
JLes plantes qui s’étoient fou!e\ées avec la terre
fe trouvent en fuite couchées à la fuperficie &
leurs racines à l’air. De quelque manière que
Tou cultive ces fortes de terres , à moins que
le labour ne foit profond, elles ne produifenr,
prefeue rien quand l’ hiver efl rigoureux. Le
mieux efl d'y femer des Mars. Les terres légères
font plus fujettes à déchaufier que les terres
fortes. ( Tes s i e r . )
DÉCIMaTEUR. Celui qui a le droit de
dixme. Dix mer * c’eft percevoir fur la quanrté
des produits une portion déterminée, par exemple
, Sa dixième . gerbe de bled , le dixième
Agnesu, &c. Vojt\ lé mot Dix m e , ou plutôt
le D-élmnaire de Jurdfprudenee. ( Te s s ie r . )
DÉCLIMATER- Déshabituer une Plante d’un
climat ou J’en fortir; cette opération change
plus ou moins les qualités de l’e fpèce, foit en
la perfeéhionnant, foit en diminuant fes qualités.
Cette influence de climat fur la nature
des végétaux êfl une des plus importantes études
du Naruralifle, & cependant la plus négligée.
V. C l im a t . ( L . R eynisr. )
DÉCLIN de la fève. Epoque à laquelle la
fève des végétaux fe ralentit & commence à
n’être. plus abondante dans les vaiffeaux qui la
renferment.
Certaines greffes ne réufliffent bien que lorf*
quon les fait à cette époque, d’autres veulent
être pofées à la lève montante, enfin, il en
efl qu’il faut faire lorfque les fauvageons font
en pleine fève. Voyc% G r e f f e . ( T houin. )
DÉCOCTION. C’efi l'ébullition fourenue
d’un fluide dans lequel on a inis une fubflance
quelconque qu’on veut étendre dans un volume
plus ou moins confidérable.
En Jardinage on fe fert de deux efpècés de
décodions, l’une faite avec les feuilles, les
tiges & les fruits de l’ Arifioloche clémathe,
& l’autre avec les feuilles de tabac.
Ces deux fortes de décodions fè font dans
deTe.iu à une ébullition d.’une demi-heure dé
durée, enfuite fe paffent dans un linge & s’étendent
dans un fccau d’eau fraîche.
Elles fervent à bafliner Es Plantes qui font
attaquées par les pucerons & à chaffer les fourmis
qui les accompagnent prefque toujours. Ce
moyen fait périr un allez grand nombre de
ces infedes & en débarraffe les Plantes pendant
quelques temps,; mais., il en revient d’autres
qu’on chaffe de la même manière.
On fe fert ordinairement d’une grande feringue
terminée par une plaque percée d’un grand
nombre de petits trous très-rapprochés les uns
des antres. Au moyen de cet infiniment, on
parvient à lancer avec force les décodions fur
toutes les parties des Plantes, & a en chafler
les infedes nuifibles. ( T houin. )
DÉCOLLER. En Jardinage', ce terme s’emploie
pour défigner des greffes qui fe féparent
de leur fujet/ou k s jeunes bourgeons vigoureux
qui pouffent à la couronne des arbres
'tétés.
Le vent lorfqu’il eft accompagné de pluie
décolle fouventfes jeunes greffes & ks nouveaux'
bourgeons. 11 faut avoir la précaution d’affu-
jett r ces rameaux à des tuteur jufqu’à ce qu’ils
foient bien cunlolidçs avçc leurs fujets ou leurs
tiges. ( Thouin. )
DÉCOMBRES. Les plâtras & mortiers, ré fui?
tans des bâtimens qu’on abat , s'appellent Dé-
ccmbres, L’Agriculteur en fait ufage"pour am'é>-
lioier les terres. Ils conviennent dans çelies qui
font
font froides, humides & compares, PolV ' cs
divifer. La proportion de ces matières doit varier
félon leur nature & celle du fol fur lequel
en les répand P'ôy.î A mendement. ( f t i s ï t i s .)
DÉCORATION. La guerre finit, « **. P»l!t
rappelle les Citoyens dans leurs foyers. L i , )ouil-
fan & du fenriment fi doux d’avoir été utile a
leur Patrie. & du befoin de calme dont une vie
orageufe indruir à jouir, ils voudront embellir
les retraites qu’ils ont choifies. Dés moines rai
néans ne confomineront plus les fruits d un
territoire immenfe , dans une oifiveté corruptrice.
Des bras, citoy ns cultiveront pour eux-
: tnêm-. S/ces terres que l’ariftocratie avoit ufurpée
fur leurs ancêtres. Nous verrons en France ,
après la fin dé la guerre, ce qui sft arrivé dans
tons les fiécle*. Les guerres les plus longues ont
toujours précédé les époques diverfes.que préfente
la décoration des habitations champêtres.
Tant il eft vr. i que l’homme vit pour la paix,
la chérit ; elle ell fon élément : les orages qui
agirent & fouvent abrègent ton exifience, font
de1- violations de la Loi de nature, des crimes
produits par l organifation vicieule des Sociétés.
Quelle diftance énorme de l’arbre que l’homme
de la Nature plante auprès de fa cabane pour
y retpirer m air frais, jufqu’aux Jardins payfa-
giftes des Cités floriffan tes ! Et le même mobile
à produit ces deux Décorations, le denr d’aug-
, menter les jpuiffances. Defir perfide par fes
effets , puifqu'il nous arrache aux jouiffances
que nous pouvons nous procurer, pour nous
égarer au travers d un f ntier pénible fur les
traces de jouiffance que nous n’avons pas.
Le jeune" homme qui quitte fon village, fa
inaîtreffe qui l’aime réellement, pours’enfê.elir
. dans les villes , trouve-t-il ceqn’ -l a quitté dans
le careffes_ menfongères des lais. Il éprouve
!• bientôt qu’une parure plus brillante, de s dehors
plus (éiuifans, cachent des anraits flitris, fou-
vtnr dégradés , & une ame corrompue. Le jrune
homme qui quhte fa , chaumière , où une vie
fimpiè & rltqrée lui promettoit une exifience
dôme, & qui viens habiter les villes, d’abord
féduit par la fpiendeur extérieu;e & par le'
plaifirs qui s’y multiplient, bientôt défabufé, n’y
/ ’ trouve qu une vie pénible, des befoins faélices*,
& l’air pur de la campagne, le çal ne de l’ame
lui manquent.
Devenons Républicains , achevons de Y être ;
reportons-nous vers les campagnes, prenons-y
des goûts fimples, & les vertus républicaines
reparoîtront à leur fuite. Mais pour nous y plaire,
fendons' nos habitations agréables fans nuire i
la defiination utile des terres ; il eft fi facile de
réunir ces deux avantages.
' Jerrons un coup - d’oeil fur les Décorations
adoptées dans les divers fiécles & dans les divers
pays: il pourra être luivi de quelques vues gé-
■ dgricidittre*. Tome 1 V\
nérales fur les moyens de décorations > fur leur
concordance avec les climats.
Des divers genres de Décorations b de leur
analogie avec les tnceurs des Peuplcs.
Je ne ferai pas une féche compilation du peu
que les anciens ont dit fur l’art des Jardins,-;
les embelliffemens de la Poëfie & des traditions
menfongères , ont trop vifiblement défiguré le
v ra i, pour que nous puiflions réunir des données
fûres. Les Romains, qui- ont eu le bon
efprit de s’approprier^ le bon de tout ce qu’ils
ofofervoient chez les Peuples conquis, ont eu
des Jardins perfectionnés. Une belle Nature ai-
doit leurs efforts, & tous leurs Ecrivains chantent
les. retraites de leurs maifons de campagne , les
bpfquets enchanteurs où ils oublioient quelques
inftans les affaires publiques, pour fe livrer à
leurs plaifirs. Ces mots épars indiquent des
Décorations analogues à nos Jardins payfagïftes ;
mais ce rapprochement général ne fuffit pas pour
indiquer d’une manière précifc le goût du fiécle;
car les Jardins payfagïftes préfentent des variations
bien grandes & des principes divers dans
leur compofition. ( i) .
Les hordes du Nord parèrent, & cesretraitesvo~
Iuptueu fes furent bientôt des monceaux de ruines.
Le féodalifme nacquit : fes tours exh.au ffées fur des
collines, pour mieux difiinguer de loin l'arrivée des
Marchands & des Voyageurs, re préfentoient pas
aux nobles-yoleurs des moyens de Décoration *
d’ailleurs la Décoration de fon domicile tient
aux fentimens paifibles, & leur ame guerroyante,
toujours occupée de pi 1 âge ou de fang, pou-
voir-elle fentir le bonheur de la folitude? Et la
néceflité de vivre éternellement derrière des
poms levis , leur ôtoit l’idée d’étendre leurs
jowiflances au-deià de cette enceinte.' Les Bardes
ne chantent poi t les Jardins des brigands à
qui ils vendoient leurs louanges ; & fi ces nobles
avoient nais leurs Jardins au nombre de leurs
f i ) Tandis que des notes épaffçs annoncent réeUement
que le goût des Romains , dans la - compôiîtion des
Jardins , fe rapprochoit du vrai beau; on t ro u v e d a n s
Pline le jeune., des détails fur un Jardin de Ro^- e , qui
annoncent des germes de la dépravation de goût qui a
prévalu aux fiécles d’ignorance - Pline, dans un foi g narre
des parties de fon Jard n . par e a ec enthoufiafme aes
arbres tal lés en formes u’an-maux , en lettres 8t chiffres,
en formes d* Architefture î les bois y fervoient dé/à à
tortiller les formes du parterre Mais cette partie qui
cotnpofoit chez eux le parterre, étoit accompagnée de
bofquets plus éloignés qui' reftoient dans l’état de na-:
uie & qui s’apptiyoient aux ailés du bâtiment : là fe
tçouvoient les retraites ombragées. Ce paffage intéreffaiit
prouve que les Ron.ains avoient des .Jarcj'ns payfagi^es ,
en même tems que des panerres ridicules ; ruais un
feul paflage d’un livre i.folé, où c ette delcnption vient
accidentellement Sc tans réflexions fur les principes d *
fa r t, ne peut rien offrir de concluant, v