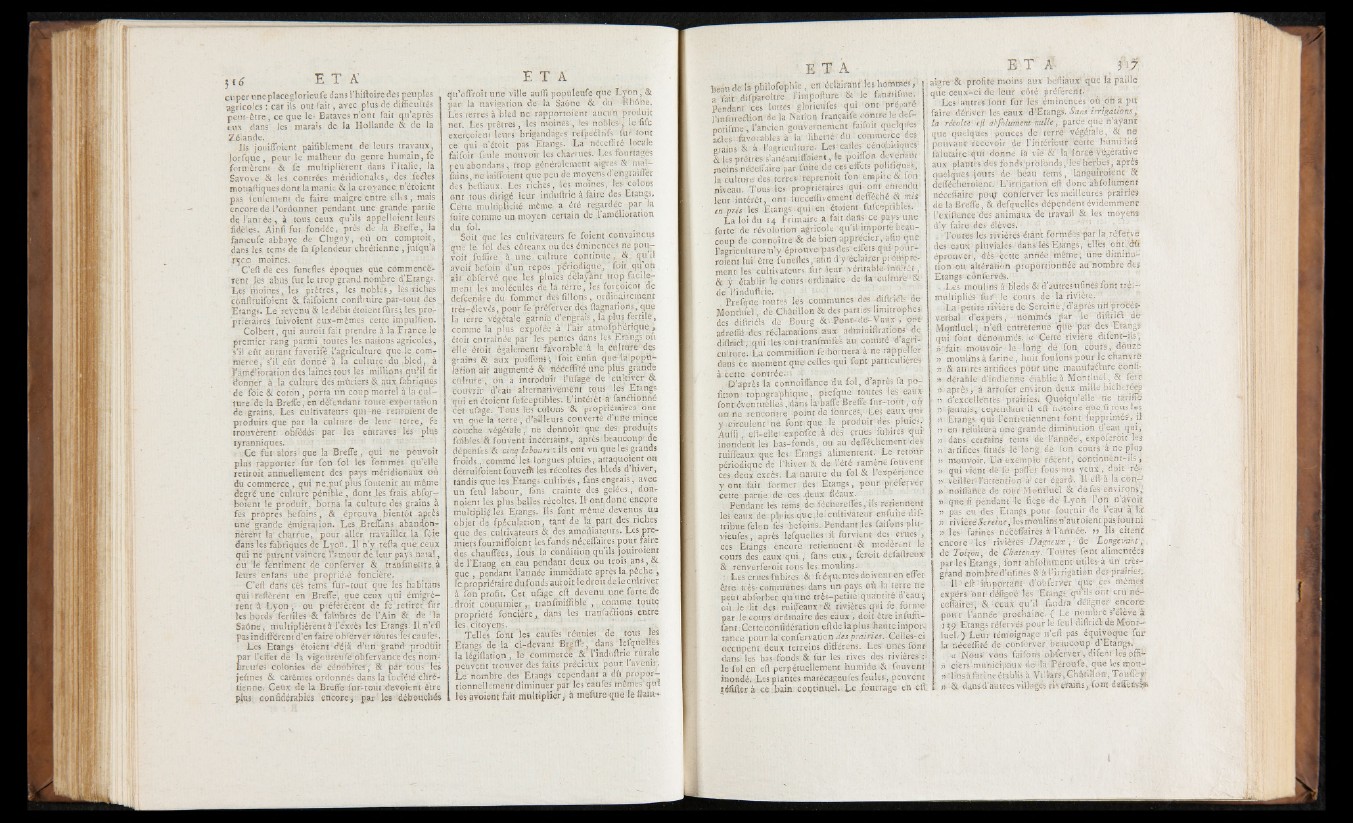
ciiper une placeglorieufe dans l'hiftoire des peuples
agricoles : car ils ont fait, avec plus de difficultés
peut-être, ce que les Bataves n’ont fait qu après
eux dans les marais de la Hollande & de la
Zélande.
Us jouiffoient paifiblement de leurs travaux,
lorfque , pour le malheur du genre humain, fe
formèrent & fe multiplièrent dans l’italie, la
Savoye & les contrées méridionales, des feéles
monafiiques dont la manie & la croyance, n étoient
pas feulement de faire maigre entre elles, mais .
encore de l'ordonner pendant une grande parue
de fanrée , à tous ceux qu’ils appelaient leurs
fidèles. Ainfi fut fondée, près de la Breffe , la
fameufe abbaye de Clugny, où on comptoit,
dans les te ms de fa fplendeùr chrétienne , jufqu’à
T^co moines.
C’efi de ces funeftes époques que commencée :
renr les abus fur le trop grand nombre d’Etangs. !
Les moines» les prêtres, les nobles., lès riches j
conftruifoîent & faifoient conftruire par-tout des_
Étangs. Le revenu & le débit étoient fûrs yles propriétaires
fuivoient eux-mêmes cette impuldon.
Colbert, qui auroit fait prendre à la France le
premier rang parmi toutes les nations agricoles,
s’il eût autant favorifé l’agriculture que,le com- ||
mèree j‘ s’il eût donné à la culture du bled, à
Làmé’ioration des raines;.tous les millions,qu’ il fit
donner à là culture dès mûriers & qux fabriques
de fôie & coton , porta un coup mortel à_ la-cul-
ture ’de la Breffe , en-défendant toute exportation
d e : grains. Les cultivateurs qui-ne retiroient de
produits que par la culture de leur terre, fe
trouvèrent obfédés par les entraves les plus
tyranniques.
- ,;Ce fut alors -que la Breffe,, qui fie - pôùvoït
plus rapporter for fon fol les fommés. qu’èllè
retiroit annuellement des pays méridionaux où
du commerce, qui ne.putplus foutenir an même
degré une culture pénible , dont .les frais abfqr-
boient le produit, borna la culture des grains à
fes propres be foin s , & éprouva bientôt après;
une grande émigration. Les ,Breffans • abandonnèrent
la' charrue, pour aller travailler; la foie
dans les fabriques de Lyon. Il n’y fefia que. ceux
qui ne purent vaincre l’amour .de leur pays'natal,
où le féntiment de conferve.r & tranfmettre. à
leurs ènfans une propriété foncière.
C’efi dans cés tems. fur-tout que les' habitans.
qui refièrent en Breffe, que ceux qui émigrèrent
à Lyon , ou préférèrent de fe .retirer fur
les bords -fertiles •& fakrbrês de l’Ain & de la
Saône, multiplièrent à l’excès les' EtangS. II. n’éfl
pas indifférent d’en faire ob'fërvér toutes lés câufës.
Les Etangs étoiènf déjà d’un1 grand1 produit
par l’effet de la vige ùréufe: ob fer van ce desnom-
breufes colonies de cénobites-,' & pair toits ’ les
jeûnes & carêmes ordonnés dans la foefété chrétienne.
Ceux de la Breffe furkoiù dévoient être
plus, confidérabies encore, par les débouchés
qn’offroit une ville aufii popüleufe que Lyon, &
par la navigation de la Saône & du Rhône,
Les terres à bled ne rapportoient aucun produit
net. Les prêtres, les moines, les nobles» le fife
exerçoiem leurs brigandages refpeêtrifs fut5 tout
ce qui n’étoit pas Etangs. La nécefiité locale
faifoir -feule mouvoir les charmes. Les fourtagës
peu abondans, trop généralement aigres & mal-
fains, ne laiffoient que peu de moyens d-engrainer
des beftiaux. Les riches, les moines, les colons
ont tous-dirigé leur induftrie à faire' des Etangs.
Cette multiplicité même- a été regardée par la
fuite comme un moyen certain de A amélioration
du fol.
-Soit que les cultivateurs,fé fôient convaincus
que le foi des côteanx ou des éminences ne pouvoir
fuffire à une cülruye continue',; qu’il
ayoit befoin d’un repos périodique., foit qù on
ait obfervé que les' pluies délayant trop facilement
les molécules de là terre , les fprçpiént de
defcënd.re du fommet; des filions, ordinairement
très-élevés, pour fe préferver dës'fiagnations, que
l’a terre végétale garnie d’éhgrâis ,1a plu| ferjile,
comme la plus expofée à l’air atmofpnérique
.étoit entraînée par les pentes dàrisles Efà’n^sôu
elle étoit également favorable à la cifituré ùes
grains & aux poiffons *, -jfbit enfin quëTa'.pppri-
lation ait augmenté & hêoeffité une plus, gràrtcfe
culture, on a introduit l’üfagé de 'cultiver 8t
couvrir d’eau 1 alternativement tous lés Etangs
qui en étoient fufeeptibles: L’intérêt â fancHonné
cet ufâge. Tous les’ colons & propriétaires ont
vu qiie la terre y (Railleurs couverte d’urle'mince
.couche végétale , ne dpnhoit que des. produits
foibles & fou vent incertains , après beaucoup' de
dépenfcS & cinq labours : ils ont vu que les grands
froids., comme'les longues pluies, attaquoient ou
détruifoient fou vent les récoltes des. bleds d hiver,
tandis que. les Étangs cultivés, fans engrais, avec
un feul labour, fans crainte des gelées., don>-
nqient les plus bellési.récoltes. Il ont donc encore
multiplié les Etangs. Ils font même devenus un
objet de fpéculation, tant* de la part des. riches
que des cultiyâteurs & des amodiateur.s. Les premiers
fourniffoient les fonds néceffaires pour faire
des chauffées, fous la condition qu’ils jouiroient
de l’Etang en.eau pendant deux o.u trois ans, &
que , pendant l’année immédiate après la pêche j
le propriétaire du.fonds auroit le droit de lecultiver
à fon profit. Cet ufage eft devenu .une forte.de
adroit coutumier, tranfmiflible , comme toute
propriété foncière, dans les 'tranfaSEions entre
les citoyens. * '
telles font les caufès' réunies de tous les
Etangs de la ci-deVani Briffe, dans lefquelles
la légifla'tion, lé commerce & l’indnftrie rurale
peuvent trouver dès faits précieux pour, l’avenir.
Le nombre des Etangs cependant a dû proportionnellement
diminuer par les caüfes méiïiës cju?
les avoient fait multiplier,1 à mefure que le flam-*
E T A
beau de la philofophie, en éclàirantles homnfos,
a fait difp'aroître l’impofture & [e fanaftilme-. ,
Pendant ces luttes glorieufes qui ont préparé
l’infureèUon de la N a t i o n françaife contré le dêl- :
potifme, l’ancien gouvernement faifoit q u e l q u e s ;
aéles "favorables à la' liberté’ du commerce des j
gjains & à l?agricultui‘e. Les cafles céno,biiïqire5-
& les prêtres s ’- a n é a n n f f i ô i e n t , le poiffon d e v e n a n t
moins néêeffairé par fuite de ces effets pplifidues;
la culture des ferres reprenoit fon empile ôt fon
niveau. Tousries p r o p r i é t a i r e s ;qüi- ont- e n t e n d u
leur intérêt, ont fueceffivement defféché & m i s
€n p r è s les E t a n g s ; qui. en étoient f u f c e p t i b l é s ;
La loi du 14 Frimaire a fait dans ce pays une
forte' de révolution agricole' qu liimportè beaucoup.
de connoître & de bien apprécier , afin que
l’agriculture ïi’y ép r ouv e> p aSf d es: e ffets qui'pqûr-
roient lu-i être funeftes,'afin d y'éclairer piônjpté-
iïient< les cultivateurs- fur leur véritable.-intérêt:,
& ÿ établir le coùfs ordinaire de-ia•culmfe’-l&
de Pinduftrie. 1 r 1 ; .^1 u
Prefque routes lés communes des -diltricts de-
MonrVdel, de CbûtiUon & des parties limitroiphés
des difiriéls de Bourg Pont-dé^Vaux , ouf
adreflë des réclamations.aux ad'minifirànoos -de ■
diftriôl'CÀqiii les.ont tranfmifes au, comité d’agriculture:
-La commiffion fe<bornera- à ne rappel 1er
dans ce moment que-celles qui font particulières
à:cette Contrée.; 1 ^ )
D’après la eonnoiffance du fo l, d après fa po7
finon : topographique.,. prefque toutes les eaux
fonféventuèlles ,-rdà>ns là7baffe Breffe fur—tout',- otj
air rie rencon tre point de fqnrces, Les eaujt -qû^
y ; circulent ne font que le produit dés, pl'üiés/
Aufii,:■ eft-rellei-êxpbfée à des crues fubites qur
inondent les bas- fonds, ou au defféchement-des
ruiffeaux que les P!tangs. alimentent. Le retour
périodique de' l’hiver & de 1! été ramène fou vent
ces deux excès: La'nature du fol & Inexpérience
y ont-fait former des Etangs, pour préferver
cette .partie de ces .deux fléaux. \ '
Pendant les tems de féehereffes, ils retiennent
les eaux de pliuiêslqU'e fié-cultivateur enfüîtë dif-
tribue félon fes befoinS. Pendant des faifons plu-
vieufes, après lefquelles: il fur vient des crues ,
ces Etangs èncore retiennent ’& modèrent le
cours des eaux qui-, fans eux-, -feroit défafireux'
& renverferoit tous les. moulins- '
* Les crues ftabirçs & ft équc. nres doivent en effet-
être très-communes» dans un pays où la terre ne
peut abforber qüùne très-petite quantité d èauy
où le lit des • ruiffeaux r & rivières qui fe forme
par le coiiTS^drdinaire des e'àux , doit être infuffi-
fant : Ge tte contidératioîn eft de la plus liante impor-;
tance, pour là confervation d e s p r a i r i e s . Celles-ci
occupent deux terreins différéns. Les unes font
dans, les bas-;fonds.& fur les rives des rivièresù
le'fol en eft perpétuellement humide fouyenf-
inondé. Ees plantés marécageufes. feules-, peuvent -
rélifter à; ce .bain continuel. Le fourrage en eft
E T A’ 3 X7
aigre & profite moins aux béftiàux' que la paille
que ceux-ci de leur côté préfèrent.
Les autres font fur les éminences -où on a pu
faire dériver lés eaux1 d’Etangs. Sans irrigations,
la récolte ':efl absolument nulle y parce que n ayant
que quelques poùees' de terré' végétale, & né
pouvant recevoir de l’iritérifeur cette humilité
la lu taire-qui donne la vié'& la forcé végétative
aux plantés :des- fonds;'profond?les herbes, après
quelques jôurs de-beau tems, larfguifoient Sc
' deffécheroient. L ’irrigatiénl ëft donc àbfolürnent
i néceffaire poiy conferver lés'meilleures prairies
! de la Breffe, & defquellès dépendent évidemment
> l’exiftence dés animaux de travail & les moyens
! d’y faire des élèves.' •
, - Tou tes les ri vièfês-étqnt form ëès par la. ré;fef vë
, des eaux pluviales ;dahs lés E^fiigs, elles ont dû
éprouver-, dèè^cette année même; üne dimiriu-
; tion^ou altératibn proportionftéé au’nombre des
Etangs cdftfervês." ‘ ! ' ' ' '
; - Les moulins’ à bleds & d’autres-ufinès font tr^s-*
multipliés furiVle cours de la rivière. ' ,
La petite rivièfé de Sèreinè'/d’après ùtl 'prbcès-
! verbal d’expérs, nommés par le diftriêt de
■ MqirtluéF;- -n’éft - èntreferiuë que 'par- deS -Et-âpgs
I qùi font dënô!mmës. Uc<!Cettè rivière difènt-ijs,
j »'fait moUvoir le long de fon cours, douze
! » moulins à farine, huit foulons pour le ehanyrè
i » & auirès artifices pouf une manufaéhire confi-
. ». dérable d’indiénnè établie à Montluel, & fért-
» après y à arrofer environ deux mille bicheréég
i » d’exceiléntës prairies;. Quoiqu’elle J ne tari fie
» jamais:j cependant il eft hôtôlre que fi tous les
jj Etangs qui l’entretiennent -font fupprimés5, iî
3T en réfülterà une grande diminution d eau qui,
, : 33 d an s , c e r t a in s t em s d é V a n n é e , e x p ô f e r ô i t l e s
33 ' a r t i f i c e s lu n é s l é ’ l o n g d ë f o n c o u r s à n e p l u s
I 33 m o u v o i r . U n e x em p l e r é c e n t , c o f i t ih u e n t - i f s ,
;-3 qui vient dë fe pafler foiis nos yeux , dôit ré-
j 33- : y ëiîlér> Fatrèntio 17 à; cet égard-. Il eft à la con-^
! » noîflancë de rôtit 'Mensltièl & de fes. environs»
33 que ft pèn;dant‘ -lé'fiègë de Lyoh I on n âvoit
J 33 pas eu des Etangs pour fournir de l’eau à lù.
■ 33 riviètëSereineles môûlin's n’auroien t pas fout ni
33 les farines néëeftairës à l’afméè. >5 Ils eitenc
en co re le s •rivières- Dagneitx , de Longevànt'.,-.
de Toïfon, de' Chatenay. Toütës font alimentées
par les Etangs, font abfôlurnenr utiles-à un très-
grand noinbrediilmts & à l’irfigàtioft desprairies».
Il »èft"important d’ôbfcrVer que' ces mêmes
expers ont défîg-né les EtangE qu’fis ont cru né-
ceffairès, '■ & ;ëeûx qu’il faudra défigneri encore
pour l’année prochaine. Ç Le - nombre s élève à
159 Etangs réferv-és pour le feul diftrièl de Mont—
luel. ) Leur ténioignage' n’eft pas équivoque fur
la nécefiité de confërÿer beau cou p d Etangs. .
-« N o u s - v o u s - ’f a i fo ris o b f e r v e r , d i f e è t l e s o fp - ;
| » 'c i é r s m u n i è ip a u x d e ;l'à ’P é r ô u f e , q u e le s m o i f o
' 3î ' l i n s k f à r in e é ta b lis à V i 'f à r s ^ G h â-tiM on', T o u f f e y '
' dans d’autres villa ges riv crains ,,fo ni daffetv-î»