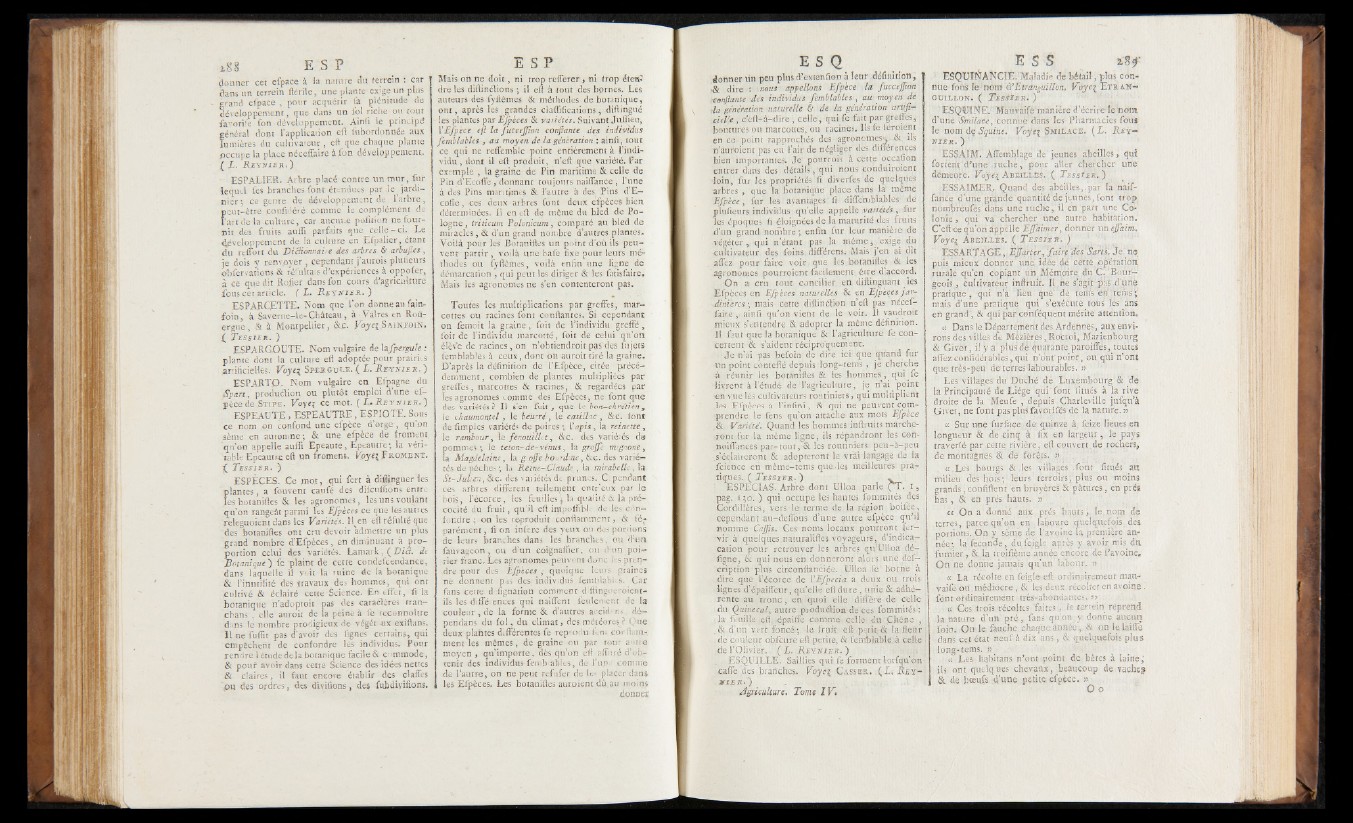
donner cet efpace à la nature du terrein : car
dans un terrein ftérile, une plante exige un plus :
grand efpace , pour acquérir la plénitude de .
développement, que dans un fol riche ou tout
favorite fon développement. Ainfi le principe
général dont l’application eft tubordonnée aux
lumières du cultivateur, eft que chaque plante
pçcupe la place nécejTaire à ion développement.
( X. R e y n i e r . )
ESPALIER. Arbre placé contre un m ur, fur
lequel fes branches font étendues par le^ jardinier*,
ce genre de développement de l’arbre,
peut-être .confidéré comme le complément de
Part de la culture, car aucune polition ne fournit
des fruits aufli parfaits que c e lle -c i. Le
développement de la culture en Efpalier, étant
du reffort du Dicdonnave des arbres & arbufies,
je dois y renvoyer , cependant j’aurois plutieurs
oh fer rations & réfultats d’expériences à oppofer,
à ce que dit Rofier dans fon cours d’agriculture
fous cet article. ( X. R e y n ie r . }
ESPARÇETTE. Nom que l’on donne au fain-
-foin, à Saverne-le-Château, à - Valres en Roue
r gu e , & à Montpellier, &_c. V°yei S a i n fo in .
f T e s s i e r . )
ESPARGOUTE. Nom vulgaire de lafpergute :
plante dont la culture eft adoptée pour prairks
artificielles. Voyei Sp e bg ule . < X. R e y n i e r .)
ESPARTP.. Nom vulgaire en Efpagne du
Spart, produélion ou plutôt emploi d’une efpèce
de St ip e . Voye[ ce mot. ( U R e y n ie r . )
ESPEAUTE , ESPEAUTRE, ESPIOTE, Sous
ce nom on confond une efpèce d’orge , qu on
sème en automne; & une efpèce de froment,
qu’on appelle auffi Epeaute, Epeautre; la véritab
le Epeautr-e, eft un froment. Voyci F r o m e n t .
£ T e s s i e r . )
ESPÈCES. Ce mot, qui fert à diôinguer les
plantes, a fouvent caufé des difeuflions entre
les botaniftes & les agronomes, les uns voulant
qu’on rangeât parmi les E/pèces ce que les autres
releguoieot dans les Variétés, ll^en eft réfulté que
des botanifles ont cru devoir admettre un plus
grand nombre d’Efpèces, en diminuant à proportion
.celui des variétés. Lamark, ( Di cl. de
Botanique ) fe plaint de celte condefcendance,
dans laquelle il voit la ruine de la botanique
& l’inutilité des travaux des hommes, qui ont
^cultivé & éclairé cette S c i e n c e . En effet, fi la
botanique h’adoptoit pas des c a r a c l e r e s fran—
ch a n s , elle auroit de la peine à fe reconnoître
dans le nombre prodigieux de végét ux exiftans.
Il ne fuffit pas d’avoir des fignes certains, qui
empêchent de confondre lés individus. Pour
rendre 1 étude delà botanique facile & commode,
& pour avoir dans cette Science des idées nettes
& claires, il faut encore établir des cl ailes
'pu des ordres , des divifions, des fubdiyifions.
Mais on ne d oit, ni trop refferer, ni trop étetfî
dre les difiinélions ; il en à tout des bornes. Lés
auteurs des fyftêmes & méthodes de botanique,
on t, après les grandes clalfifications, diftingué
les plantes par Efpèces & variétés. Suivant Jufîièu,
l Efpèce efl la JuceeJflon confiante des individus
femblables , au moyen de la génération : ainfi, tout
ce qui ne reffemble point entièrement à l’individu,
dont il eft produit, n’eft que variété. Par
exemple , la graine de Pin maritime & celle de
Pin d’Ecoffe, donnant toujours naiffance , l’une
à des Pins maritimes & l’autre à des. Pins d’Ecoffe
, ces deux arbres font deux efpèces bien
déterminées. Il en eft de même du bled de Pologne
, triticum Polonicum, comparé au bled de
miracles, & d’un grand nombre d’autres plantes-
Voilà pour les Botaniftes un point d’où ils peuvent
partir, voilà une baie fixe pour leurs méthodes
ou fyftêmes, voilà enfin une ligne de
démarcation , qui peut les diriger & les fatisfaire.
Mais les agronomes ne s’en contenteront pas.
Toutes les multiplications par greffes, mar-
j cottes ou racines font confiantes. Si cependant
on femoit la graine, foit de l’individu greffé,
foir de l’individu marcotté, foit de celui qu’on
élève de racines, on n’obtiendroit pas ses fujets
femblables à ceux, dont ôn auroit tiré la graine.
D’après la définition de l’Efpèce, citée précédemment,
combien de plantes multipliées par
greffes, marcottes & racines, & regardées par
les agronomes tomme des Efpèces, ne font que
des variétés ? Il s’en fuir, que le bon-chrétien,
le chaumontel, le beurré, le catillac , &c. font
de fimples variétés de poires ; Y apis, la reinette,
le rambour, le fenouillct, &c. des variétés d®
pommes ; le teton-de-venus, la gro/fe mignone■ ,
la Magdelairte, la g ojje bourdne, &c. des variétés
de pêches ; La Reine-Claude , la mirabelle , la
St-Julien,&c. des vaiiétésde prunes. G.pendant
ces arbres different tellement entr’eux par le
bois, l’écorce , les feuilles\ la qualité & la précocité
du fruit, qu'il eft iiyrpolfibl.- de les confondre
; on les reproduit conftamment, & fé-
parément, fi on inféré des yeux ou des posions
de leurs branches dans les branches, ou mua
fauvageon, ou d’un coignaffiér, ou d’un poirier
franc. Les agronomes peuvent donc les prendre
pour des E/pèces , quoique leurs graines
ne donnent pas des individus femblabl- s. Car
fans certe d.fignation comment d ftingueroient-
ils les différences qui naiflënt feulement de la
couleur , de la forme & d’autres accid-ns, dé—
pendans du f o l , du climat, des météores ? Que
deux plantes différentes fe repuod-u-ifent. corftam-;
ment les mêmes, de graine ou par tour antre
moyen, qu’importe, dès qu’on eft a lia ré d’obtenir
des individus-femb ables, de l’un ■ comme
d,e l’autre, on ne peut refufer de Je? placer dans
les Efpèces. Les botaniftesauroient du.au moins
donnée
donner lin peu plus d’èxtenfion à leur .définition 9
,& dire : nous appelions Efpèce la fuccej/ion
confiante des individus femblables , au moyen de
-la génération naturelle & de là génération artificielle
, c’eft-à-dire; celle, qui fe fait par greffes,
boùtures ou marcottes, ou racines. Us fe (croient
en ce point rapprochés des agronomes^, & ils
n’auroient pas eu l’air de négliger dès différences
bien importantes. Je pourrois à cette occàfion
entrer dans des détails ,'qui nous conduiroient
loin, fur les propriétés fi diverfes de quelques
arbres , que la botanique place dans la même
Efpèce, fur les avantages' fi diffémblablés* dé
plufieurs individus qu’elle appelle variétés ^Tur
les époques fi éloignées de la maturité des fruits
d’un grand nombre ; enfin fur leur manière de
végéter, qui n’étant pas la même, /exige du
•cultivateur des foins, différens: Mais j’en ai dit
allez pour faire voir que les botaniftes & les
agronomes pourroient facilement être d’accord.
-On a cru tout concilier, en diftinguant les
Efpècçs en Efpèces naturelles & en Ejpèces jardinières
\ mais cette diftinélion n’eft pas nécef- |
faire, ainfi qu’on vient de le voir. Il vaudroit .
mieux s’entendre & adopter la même définition.
Il faut que la botanique & l’agriculture fe concertent
& s’aident réciproquement.
-Je n’ai pas befoin de dire ici que quand fur
un point conteflë depuis long-tems | je cherché
-à réunir les botaniftes & les hommes, qui fe
livrent à l’étude de L’agriculture, je n’ai point
en vue lés cultivateurs routiniers, qui multiplient
les Efpèces à l’infini , & qui ne peuvent comprendre
le fens qu’on attache aux mots Efpèce
& Variété. Quand les hommes inftruits marcheront
fur la même ligne, ils répandront les con-
noiffances par-tout, & les routiniers' peu-à-peu
.s’écLaireront & adopteront le vrai langage de la
fciénce en même-tems que Les meilleures pratiques^
( T e s s i e r . ) v
ESPECIAS. Arbre- dont Ulloa parle ( T . i ,
pag. 130. ) qui occupe les hautes fommités des
Cordillères, vers Le terme de la région boifée ,
cependant au-deft’oùs d’une autre efpèce qu’il
nomme CaJJîs. Ces noms locaux pourront ler-
"vir à1 quelques naturâliftes voyageurs, d’indica-
cation pour retrouver les arbres qu’UUoa dé-
figne, & qui nous en donneront alors,une description
plus circonftanciée. Ulloa fe borne à
dire que l’écorce de YEfpecia a deux ou trois
lignes d’épaiffeur, quelle eft dure , unie & adhé^-
rénte au tronc, en quoi elle diffère de celle
du Quinecal, autre production de ces fommités :
• la feuille eft,. .épaiffe comme celle du Chêne ,
. &. d’un vert foncé:; le fruit eft petit & la fleur
de couleur obfcure eft petite, & femfelable.à celle
de l’Olivier. ( X. R e y n i e r . )
. ESQUILLE. Saillies qui fe forment lorfqu’on
cafté des branches. Voyc[ CassePv. ( Xi Re y -
v i e r
Agriculture. Tome IV»
ESQUIT^TANGIE. Maladie de bétail, plus con-
nue fouis' le mont à éE tr a n g u illo n . V o y e i E tr an-
g u il l o n . ( T e s s ï e r : ) 1
ESQUÏNE. Mauvaife manière d’écrire le nom
d’une Sm ila .c e , 'connuè- dans les Pharmacies fous
le nom de S q u in e . V o y ë i Smilace. ( L . R e y —
N I E R . )*
ESSAIM. Àffemblage de jeunes abeilles, qui
forcent d’une .ruche, pour aller chercher une
demeure. Voÿe\ A b e il l e s . .( T e s s ie r . )
ESSAIMER.. Quand des abeilles,.par la naiffance
d’uné gràndé quantité de jeunes, font trop
nombreufes dahs une ruche, il en part une Colonie,
qui va chercher une autre.habitation.
C ’eft ce qu’on appelle Ejfaimer, donner un ejfaim,
Voyei Ab e I'LLé s. ( T e s s i e r . )
ESSARTAGE , -Eÿârier, faire def iSah's'. Je ns
puis mieux donner unè' idée de 'cettët opération;
rurale qu’en, copiant un Mémoire, du C. 'Bourgeois
, Cultivateur inftruit. Il ne s’agit pas d’une
pratique, qui n’a l’ièu que1 dé teins en te ms;
m a is d’une pratique qui s’exécute' toés lé s ans
en grand, & qui par!cônféquent mérite attention.
u Dans le Département des Ardennes, aux environs
des villes ‘de Mezières, Rocroi, Marienbourg
.& Givér, i! y a plus de quarante paroilfes, toutes
allez conlidérables, qui n’ont'point, ou qui n’ont
que très-peu de terres'labourables. »
Les villages du Duché de Luxembourg & de
la Principauté de Liège qui font fitués à la rive
droite de la Meufe , depuis Charleville jufqu’à
Givet, ne font pas plus fayorifés de la nature, n
u Sur une furface de quinze à feize lieues en
longueur & de cinq à fix en largeur,-le pays
traverfé par cette rivière, eft couvert.de.rochers,
de montagnes & dé forêts, n
«.Lés .bourgs .& Les villages, .fo'nt fitués au
milieu des bois; 1 leurs' terroirs, plus ou moins
grands, confiftent en bruyères & pâtures, en prés
bas , & en prés hauts, n
et On a donné aux prés hauts,, le, nom dé
.terres , parce qu’on en laboure quelquefois, des
portions. On y sème de l’avoine la première année
la fécondé , du. feigle après y avoir mis du
fumier , &. la troifième année encore de l’avoine,
O n ’ne donné jamais qu’un labour. »
« La récolte en feigle eft ordinairement mau-
vaife où médiocre , & les deux récoltes en avoine .
font ordinairement très-abondantes. 5?
« Ces trois récoltes faites le terrein reprend
la nature d’un pré, fans qu’on y donne aucun
foin. On le fauche chaque:année:, .êk on le laiffe
dans cet état neuf à dix ans, & quelquefois plus
long-tems. ??^ . ' " / . - ‘ é- /
« Les habitans n’ont point de bêtes à laine,1
ils ont quelques chevaux, beaucoup de vaches
& de boeufs d’une petite efpèce.
O o