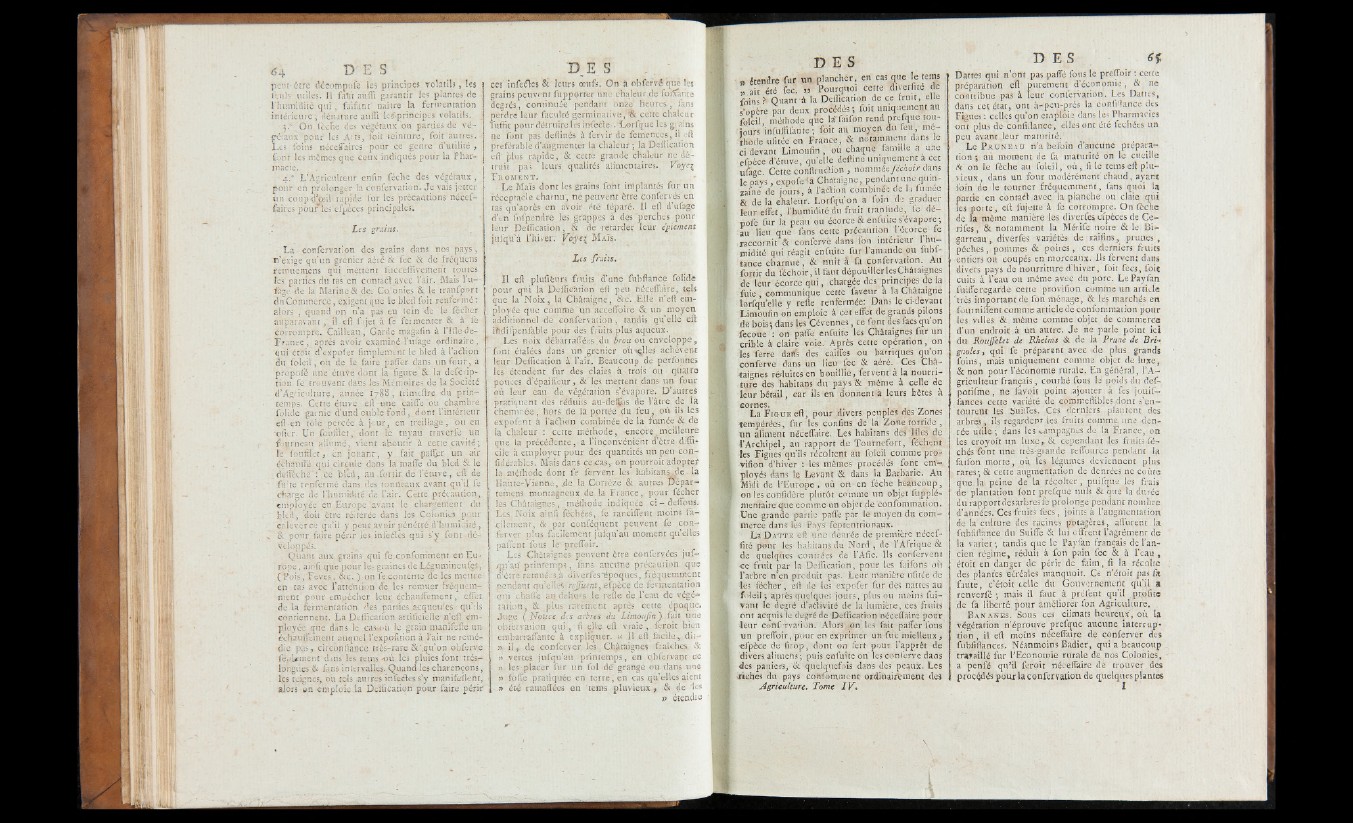
peut-être décotnpofe les principes volatils , les
îcfi 1 s miles. Il fatit'aufti garantir les plantes de
l'humidité qui , faifant naître la fermentation
intérieure', dénature au fil ks-principes volatils. .
• $;* On lecfie des végétaux bu parties de -végétaux'pour
les Arts, foit -teinture, foit autres.
Les foins nécessaires-pour ce genre d’utilité ,
font les mômes que ceux indiqués pour la Pharmacie,
4.0 L ’Agriculteur enfin fèche des végétaux ,
pour en prolonger la confervation. Je vais je-tter
un coup d’oeil rapide fur les précautions nécef-
faircs pour les éfpèces principales;
Les grains.
La - confervation des grains dans nos pays-,
n’exige qu’un grenier aéré & fec & de iréquens
remue mens qui mettent fucceffivemenc toutes
les parties du tas en conta cl avec l’air. Mais l’n——
fage de la Marine & det Coiônies & le tranfport 1
du Commerce, exigent que le bled foit renfermé:
alors , quand on n’a pas eu foin de le fécher
auparavant, il eft fijet à fc fermenter & à' fe
corrompre. Cailleau, Çarde magafin à fille de- •
Franee , après avoir examiné lutage ordinaire, *
qui étôit d’expofer fimplement le bled à faction
dû foleil, ou de le faire paffer dans un four , a
propofë une éuvve dont la- figure & la deférip-
tion fe trouvent dans les Mémoires de la Société
d’Agriculture, année 1788 , trimeftre du printemps.
Cette étuve^.eft une caifle ou chambre;
folide garnie d’und ouble fond,.dont l’intérieur
éften tôle:percée à jour, en treillager b u en
-cher. Un .feuillet, dont lè tuyau traverfe un
fourneau allumé, vient-aboutir à cette,cavité;
le'^fdufflet, en jeuahr-, y fait paftèr un air
échauffé qui circule dans la malfe du. bled & le
deffècheT: ce bled,, a u , for tir de l’étuve., efï- de
fuite renfermé dans des tonnèaux avant qu’il fe
charge de l’humidité de l’air. Celte précaution,
employée en Europe''avant le chargement du
bkd , doit être réirérée dans les Colonies pour
enlever ce qu’il y peut avoir pénétré d’humiuité ,
. &. pour faire périr'les infeéles qui s’y font développés..
■ ^ • ; ’ , • '
Quant aux grains qui fè,confommenr en Europe
, ainfi que pour les graines de Légumineu(g$;
( Pois, Fèves, &c. ) on fe contente de les mett-re-
en tas avec l’attention de les remuer fréquemment
pour empêcher leur échauffement, effet
d e ia fermentation des parties .açqüeufes 'q u ’ ils
contiennent. La Déification artificielle n’eft employée
que dans le çaShOÙ le grain manifpfté un
échauffement auquel l’expofition à l’air ne remédie
pas * circonftance très-rare & ’.qu’on obferve
ië,il*ment dans les teins où. lé's pluies font très-
longues & fans intervalles. Quand les charençons,
les teignes; pu tels autres irifeéles s’y manifellent,
alors on emploie la Déification pour faire périr
ces' infeéles leurs oeufs. On à obfervé que les
grains peuvent fupportfer une chalcurNde foixante
degrés, continuée pendant onzp heures, fans
perdre leur faculté germinative,^ cette chaleur
Tuffit poiir détruire les in-feèle:. Lorfque les grains
ne font pas defiinés à fervir de fetnences, il eft
préférable d’augmenter la chaleur ; la Déification
d f plus rapide ,, &. cettë grande chaleur ne détruit
pas leurs qualités alimentaires. Foyq
Froment.
Le Maïs dont les grains font implantés fur un
réceptacle charnu, ne peuvent être confervés en
tas qu’a près en avoir été léparé. Il eft d’ùfage
d’en fufpendre les grappes à. des'perches pour
leur Déification, & de retarder leur epiement
jiifqli’à fihiverr Vdyei Maïs.
Les fruits.
Il eft plufièurs fruits, d’une fubftance folide
pour qui la Déification eft peu néceffaire, tels
que la Noix* la Châtaigne, &c. Elle n’eft employée
que comme un acçeffoire i& un moyen
additionnel de confervation, tandis quelle eft
ifidifpenfable pour des fruits plus aqueux.
Les noix débàrralfées du brou ou enveloppe,
font étalées dans un grenier oublies- achèvent
leur Déification à l’air. Beaucoup de perfonnes
les. éténdenr fur des claies à'trois ou quatre
pouces d’épaiffeur, & les mettent dans un four
où leur eau de végétation s’évapore. D’autres
pratiquent des réduits au-delfus de l ’âtre de la
cheminée, hors de la portée du fe u ,; ou ils les
expofent à I’aélion combinée de la fumée & de
la chaleur : cette méthode, encore_,.meilleure
que la précédente, a l’inconvénient d’être diffi*
cile à employer pour des quantités un peu con-
fidérables. Mais dans ce-ca% on pourroit adopter
la méthode dont fe fervent les habitans-de-la
Haute-Vienne, .de la Corrèze & autres Depar-
temens montagneux de la France, pour'fécher
. les Châtaignes , ^méthodeindiquée ci - déifions.
Les Noix ainfi féchées,.fê ranciflëm moins fa-
| .çilcménr, & par conféquent peuvent fe conferver
plus facilement jufqu’au moment quelles
p a fient fous le^preffoir.
Les Châtaignes peuvent être conferyées jüf-
: qu’au' printemps, fans aucune précaution que
d^ètre remuéés.à diverfes'époques, fréquemment
: pendant qu’elles-refluent, efpèce de fermentation
uni chalie au dehors le refte de l’eau de végétation,
& plus rarement après cette époque.
Juge ( Notice des arbres du Limoujin ) fait une
\ obîérvaiion q u i, fi elle eft vraie, feroit bien
embarr-aflante à expliquer. « Il eft facile, dit—
i l , de conferver le s . Châtaignes fraîches Si
n vertes jufqu’au printemps, en qbfervant ae
» les placer fur un fol de-grange ou dans un®
. y> fofle pratiquée en terre, en cas qu’elles aient
» été ramaftées en teins pluvieux > & de des
» étendie
» étendre fur un. plancher, en casque le tems
„ ait été (ec. »> Pourquoi cette diverfué de
foins ? Quant à la Déification de ce mut, elle
s’opère par deux procédés ; foit uniquement au
foleil, méthode que laTaifon rend prefque toujours
infulfifarite ; foit au moyen du feu, méthode
ufitée en France, & notamment dans le
ci-devant Limoufin , où chaque famille a une
efpèce d’étuve, qu’elle defline uniquement a cet
ufage. Cette conftruêHon , nommée fechoir dans
le pays, expofeda Châtaigne, pendant une quinzaine
de jours, à l’aéliori combinée de lu fumee
& de la ehaleur. Lorfqu on a loin de graduer
leur effet, l’humidité du fruit tranfude, le dé-
pofe fur la peau ou écorce & en fuite s’évapore;
au lieu que fans cette précaution 1 écorce fe
raccornit & confervé dans îbn intérieur l’humidité
qui réagit ënfuite fur l’amande ou fubf-
tanee charnue, & nuit â fa confervatiôn. Au
fortir du féchoir, il faut dépouiller les Châtaignes
de leur écorce q u i, chargée des’ principes de la
fu ie , communique cette faveur à la Châtaigne
lorfqu’elle y refte renfermée: Dans le ci-dé van t
Limoufin on emploie à cet effet de grands pilons
de bois-; dans les Cévennes, ce font des faesqu on
fecoùe : on paffe enfuite les Châtaignes fur un
crible à claire voie. Après cette opération, on
les ferre darfs des cailles ou barriques qu’on
conferve dans un lieu fec &. aéré. Ces Châtaignes
réduites en bouillie* fervent-à la nourriture
des habitans du pays & même à celle de
leur bétail, car ils en donnent à leurs bêtes à
cornes. :
La Figue eft, pour divers peuplés des Zones
tempérées, fur les confins dé la Zone torride ,
«n aliment néceftaïre. Les habitans des 1 fl es -de
l’Archipel, au rapport de Tournefort, féchent
les Figues qu’ils récoltent au foleil comme pro-
vifion d’hiver : les mêmes procédés font employés
dans le Levant & dans la Barbarie. Au
; Midi de l’Europe , où on en fèche beaucoup,
on les confidère plutôt comme un objet lupplé-
mentaire que comme-un objet ^ie confommation.
Une grande partie paffe par le moyen du commerce
dans lès PayS-feptentrionaux.
La Datte eft une denrée de première r.écef-
ftté pour les habitans du Nord , de l’Afrique &
de quelques contrées/ de l’Afie. Ils confervent
ce fruit par la Déification, pour les faifons où
l’arbre n’en produit pas. Leur manière ufike de
les fécher, eft de les expofer fur dès nattes au
foleil; après quelques jours, plus ou moins fui-
vant le degré tràéuvité de la lumière, ces fruits
ont acquis le degré de Déification nécefïâire pour
leur cotiC rvarion. Alors en les fait pafter fous
un preffoîr, pour en exprimer un. fuc mielleux,
•efpèce de lirop, dont on fert pour l’apprêt de
divers, aîimeris; puis enfuite ôn les conterve dans
des paniers, & quelquefois dans des peaux. Les
»riches fin pays confomment ordinairement des
Agriculture. Tome IV .
Dattes qui n’ont pas paffé fous le preffoir : cette
préparation eft purement d’économie, & ne
contribue pas à leur confervation. Les Dattes,
dans cet état, ont â-peu;près la confiance des
Figues : celles qu’on emploie dans les Pharmacies
ont plus de conftilance, elles ont été fechées un
peu avant leur maturité.
Le P r u n e a u n’a befoin d’aucune préparation
; au moment de fa maturité on le cueille
Si on le fèche au foleil, où, fi le tems eft pluvieux,
dans un four modérément chaud, ayant
loin de le tourner fréquemment, fans quoi la
partie en cbntaél avec la pianclie ou claie qui
les porte, eft fujette à fe corrompre. On fèche
de la même manière les diverfes cfpèces de C e-
rifes, & notamment la Mérife noire & le Bigarreau,
diverfes variétés de raifins, prunes,
pêchés, poihmes & poires, ces derniers fruits
entiers ou coupés en morceaux. Ils fervent dans
divers pays de nourriture d’hiver, foit fecs, foit
cuits à l’eau ou même avec du porc. Le Payfan
luilîeregarde cette provifion comme un article
'très important de fon ménage, & les marchés en
foui niflent comme article de confommation pour
les villes & même comme objet de commerce
d’un endroit à un autre. Je ne parle point ici
du Roufelet de Rheims & de la Prune de B ri-,
gnôlest qui fe préparent avec -de plus grands
foins, mais uniquement comme objet de luxe,
& non pour l’économie rurale. En général, l’A griculteur
français, courbé fous le poids du def-
potifme, ne fayoit point ajouter à fes jouif-
fances cette variété de commeflibles dont s’entourent
les Suilfes. Ces derniers plantent des
arbre,L, iis regardent les fruits comme une denrée
utile ; dans les campagnes de la France, on
les croyoit un luxe* & cependant les fruitsfë-
chés ibnt une très-grande reflource pendant la
faifon morte, où les légumes deviennent plus
rares ; & cette augmentation de denrées ne coûte
que. la peine de la récolter, puifque les frais
de plantation font prefque nuis & que la durée
du rappôrtdesarbresfe prolonge pendant nombre
d’ânnées. Ces fruits fecs , joints à raugmentation
de la'culture des racines potagères, aflurent la
fubfiftance du Suiffe Sl lui offrent l’agrément de
la varier; tandis que le Payfan français de l’ancien
régime, réduit à fon pain fec & à l’eau ,
etdït en danger de périr de faim, fi la récolte
des plantés céréales manquoit. Ce n’étoit pas la
faute, c’étoit celle du Gouvernement qu’il a
renverfé ; mais il faut à prêtent qu’il profite
;de fa liberté pour améliorer fon Agriculture»
Bananes. Sous ces ciimats heureux', où la
végétation n’éprouve prefque aucune interruption
, il eft moins néceffaire de conferver des
fubfiftances. Néanmoins Badier, qui a beaucoup
travaillé fur l’Economie rurale de nos Colonies,
a penfé qu’il feroit néceffaire de trouver des
procédés pour la confervation de quelques plantes