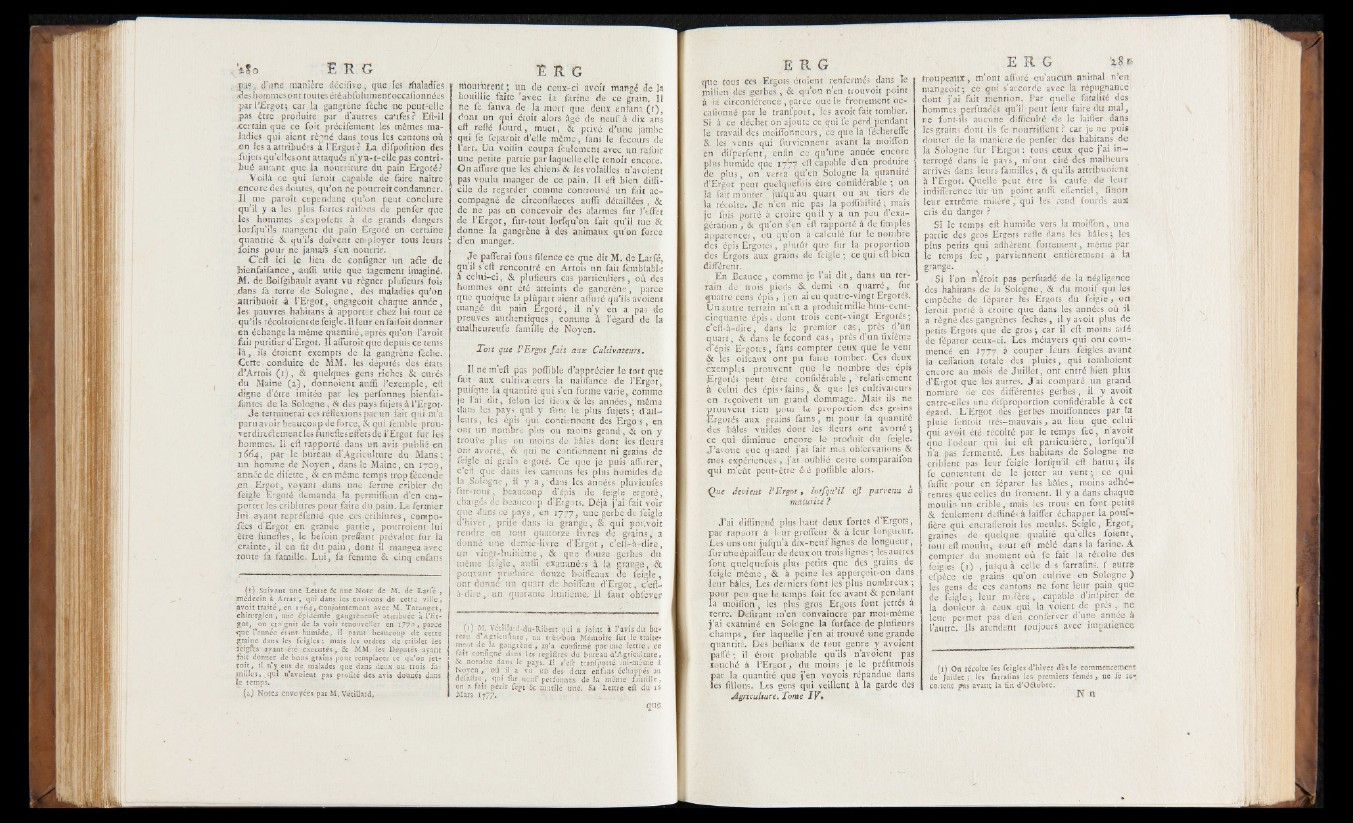
pa? ., d’une manière décifive, que les' iftaladies
ideshommesont toutes étéabfolumenfoccafionnées
par l’Ergot; car la gangrène lèche ne peut-elle
pas être produite, par d’autres caufes? Eft-il
.certain que ce foit précifement Les mêmes maladies
qui aient régné dans tous les cantons où
.on les a attribuées à l’Ergot ? La difpolition des
iujets qu’elles ont attaqués n’y a-t-elle pas contribué
autant que la nourriture du pain Ergoté?
Voilà ce qui feroit capable de faire naître
encore des doutes, qu’on ne pourroit condamner.
Il me paraît cependant qu’on peut conclure
qu’il y a les plus fortes raifons de penfer que
les hommes s’expofem à de grands dangers
lorsqu’ils mangent du pain Ergoté en certaine
quantité •& qu’ils doivent employer tous leurs
Ipins pour ;ne jamais s’en nourrir,
Ç ’eft ici le lieu de copfigner un a£te de
ibienfaifance, aulfi utile que lagement imaginé.
M. de Boifgibault ayant vu régner plufieurs fois
:dans fa terre de Sologne, des maladies qu’on
,attribuoit -à l ’Ergot , engageoit chaque année,
les pauvres habitans à apporter chez lui tout ce
qu’ils récolroient de feigl e. Il leur en faifoit donner
en échange la même quantité, après qu’on l’avoit
fait purifier d’Ergot. Il afiuroit que depuis ce tems
l à , ils étoient exempts .de la gangrène fèche.
Cetteconduite de MM. les députés des états
.d’Artois ( i ) ., & quelques gens riches & curés
du Maine (2 ), ' donnoient aufli l’exemple, eft
digne d’être imitée par les perfonnes bienfaisantes
de la S o lo g n e& des pays fujets à l’Ergot •
Je-terminerai pes réflexions parun fait qui m’a
paru avoir beaucoup de force, & qui Semble prou-
verdireéleme-nt les raneftes effets dé l’Ergot fur les
hommes. Il eft rapporté dans un avis publié en
-î664, par le bureau d’Agriculture du Mans;
un homme de Noyen , dans le Maine, en 1709,
année de difette, & en même temps trop féconde
.en Ergot-, voyant dans une ferme cribler du
Seigle Ergoté demanda la permiffion d’en, emporter
les criblures pour faire du pain. Le fermier
lui ayant repréfenté que ces criblures, composées
d’Ergot en grande partie, pourraient lui
être funefles, le hefoin preffant prévalut fur la
crainte, il en fit du pain, dont il mangea avec
toute fa famille. Lui, fa femme & cinq enfans
( ï ) Suivant «ne Lettre & «ne Note de M. de Larfé ,
médecin à Arras-, qui dans les environs de cette ville,
avoit tra ité , en 1764, conjointement avec M. Taranget,
chirurgien, une épidémie gangrèneufe attribuée à l’Ergot,
on cra:gnit de la voir renouveîler en 1 7 7 0 , parce
que l’année étant humide, il parut beaucoup de cette
graine dans les feigles ; mais les ordres de cribler les
leiglfcs ayant été exécutés., & MM. les D.éputés ayant
fait donner de bons grains pour remplacer ce qu’on jet-
to i t , il n’y eut de malades que dans .deux ou trois familles,
. qui n’avoient pas profité des avis douisés dans
le temps, .
.(z) Notes envoyées par M. Vitillard,
niqufurent ; un de ceux-ci avoit mangé de la
bouillie faite ’ avec la farine de ce grain. Il
ne le fauva de la mort que deux enfans ( 1 ) ,
dont un qui étoit alors âgé de neuf à dix ans
eft refté fourd, muet, & privé d’une jambe
qui fe feparoit d’elle même, fans le fecours de
l’art. U11 voifin coupa feulement avec un rafoir
une petite partie par laquelle elle tenoit encore.
On allure que les chiens & les volailles n’avoient
pas voulu manger de ce pain. Il eft bien difficile
de regarder comme controuvé un fait accompagné
de circonflaeces aufli détaillées, &
de ne pas en concevoir des alarmes fur l’effet
de l’E rgot, fur-tout lorfqu’on fait qu’il tue &
donne la gangrène à des animaux qu’on force
d’en manger.
Je pafferai fous filence ce que dit M. de Larfé,
qu’il s’eft rencontré en Artois un fait femblable
à célui-ci, & plufieurs cas particuliers, ou des
hommes ont été atteints de gangrène, parce
que quoique'la plupart aient alluré qu’ils avoient
mangé du pain Ergoté, il n’y en a pas de
preuves authentiques, comme à l’égard de la
•malheureufe famille de Noyen.
Tort que VErgot fu it aux Cultivateurs.
Il ne m’elî pas poffible d’apprécier le tort que
fait aux cultivateurs la naiiTanee de l’Ergot,
puifque la quantité qui s’en forme varie, comme
je l’ai dit, félon les lieux & les années, même
dans les pays qui y font le plus fujets ; d’ailleurs,
les épis qui contiennent des Ergo:s, en
ont un nombre plus ou moins grand, & on y
trouve plus ou moins de b.âles dont les fleurs
onr avorté, & qui ne contiennent ni grains de
feigle ni grain ergoté. Ce que je puis affurer,
c’eft que dans les cantons les plus humides de
la ^Sologne, il y a,'dans les années pluvieufes
fur-tout, beaucoup d’épis de feigle ergoté,
chargés de beaucoup d’Ergors. Déjà j’ai fait voir
que dans ce pays, en 1777, une gerbe de feigle
d’hiver, prifé dans la g r a n g e & qui pouvoir
rendre en tout quatorze livres de grains, a
donné une demie-livre d’Ergot, _ c’eff-à-dire,
un vingt-huitième, & que douze gerbes du
même feigle, aufli examinées à la grange, &
pouvant produire douze hoiffeaux de feigle,
■ ont donné un quart de boiffeau d’Ergot, c’eft-
à-dire, un quarante huitième. Il faut obfever
(0 M. Vetiilard-du-Ribert qui a joint à l’avis du bu*
reau d’Agriculture, un très-bon Mémoire fur le traite*
ment de la gangrène , m’a confirmé par1 une lettre, ce
fait configne dans les regifires du bureau d’Agriculture,
& notoire dans le pays. I; s’eft tranipotté. Jui-mêmè à
Noyen,- ou il a vu un des- deux enfans échappés- au
défaftre , qui fur neuf petfonnes de la même famille,
en a fait périr fept 6c mutilé une. Sa Lettre eft du
Mars Iy77 ,
I P
que tous ces Ergots étoient renfermés dans le
milieu des gerbes, & qu’on n’en trouvoit point
à là circonférence , parce que le frottement oc-
çafionné par le tranfpoit, les avoit fait tomber.
Si à ce déchet on ajoute ce qui fe perd pendant
le travailles moiflbnneurs, ce que la féchereffe
& les vents qui furviennent avant la moiffon
en difperfenr, enfin ce qu’une année encore
plus humide que 1777 eft capable d en produire
de plus, on verta qu’en. Sologne la quantité
d’Ergot peut quelquefois être confidérable ; on
la fait monter jufqu’au quart ou au tiers de
la récolte. Je n’en nie pas la poffibilité ; mais
je fuis porté à croire qu’il y a un peu d’exagération
, & qu’on s’en eft rapporté à de Amples
apparences, ou qu’on à calculé fur le nombre
des épis Ergotés, plutôt que fur la proportion
des Ergots aux grains de feigle ; ce qui eft bien
différent.
En Beauce , comme, je l’ai, d it, dans un terrain
de: trois pieds & demi tn quarré, f u r ’
quatre cens épis, j en ai eu quatre-vingt Ergotés.
Un autre terrain m’en a produit mille buit-cent- ,
cinquante épis, dont trois cent-vingt Ergotés;
c’eft-à-diie, dans le premier cas, près d’un
quart, & dans le fécond cas, près d’un fïxième
d’ épis Ergotés, fans compter ceux que le vent
& les oifeaux ont pu faire tomber. Ces deux
•exemples prouvent que le nombre des épis
Ergotés peut être confidérable, 'relativement
à 'ce lui des épis * fains, & que les cultivateurs
en reçoivent un grand dommage. Mais ils ne
prouvent rien pour la proportion des grains
-Ergotés aux grains fams, ni pour la quantité
des bâles vuides dont les fleurs ont avorté ;
ce qui diminue encore le produit du feigle.
.J’avoue que quand j’ai fait mes obfervations &
•mes expériences , j’ai oublié cette comparaifon
•qui m’eût peut-être été poffible alors.
Que devient l’Ergot, lorfqu’ i l eft parvenu à
maturité ?
J ’ai diffingué plus haut deux fortes d’Ergots,
par rapport à leur groffeur & à leur longueur.
Les uns ont’jufqu’à dix-neuf lignes de longueur,
fur uneépaiffeur de deux ou trois lignes ; les autres
•font quelquefois plus petits que des grains de
feigle même , & à peine les apperçoit-on dans
•leur bâles, Les derniers font les plus nombreux ;
pour peu que le temps foit fec avant & pendant
la moiffon, les plus gros Ergots font jettés à
terre. Délirant m’en convaincre par moi-même
j ’ai examiné en Sologne la furface de plulicurs
champs, fur laquelle j’en ai trouvé une grande
quantité. Des befiiaux de tout genre y avoient
paffé; il étoit probable qu’ils n’avoient pas
touché à l’E rgot, du moins je le préfumois
par la quantité que j’en voyois répandue dans
les filions. Les gens qui veillent à la garde des
Agriculture. Tome IV »
troupeaux, m’ont affuré qu'aucun animal n’en,
mangeoit; ce qui s’accorde avec la répugnance
dont j’ai fait mention. Par quelle fatalité des
hommes perfuadés qu’il peut leur faire du mal,
ne font-ils aucune difficulté de le laitier, dans
les grains dont ils fe nourriffent ? car je rie puis
douter de la manière de penfer des habitans de
la Sologne fur l’Ergot: tous ceux que j’ai interrogé
dans le pays, m’ont cité des malheurs
arrivés dans leurs familles , £k qu’ils attribuoient
à l’Ergot. Quelle peut être la caufe. de leur
; indifférence fur un point aufli effentiel, fin on
leur extrême mifère", qui les rend fourds aux
! cris du danger ?
Si le temps eft humide vers la moiffon, une
partie des gros Ergots relie dans les bâles ; les
plus petits qui adhèrent fortement, même par
le temps fec , parviennent entièrement à in
grange. v J
. Si l ’on n’étoit pas perfuadé de la négligence
des habitans de la Sologne, & du motif qui les
empêche de féparer l'es Ergots du feigle, on
feroit porté à croire que dans les années où il
a régné des gangrènes fèches, il y avoit plus de
petits Ergots que de gros; car il eft moins ailé
de féparer ceux-ci. Les métayers qui ont commencé
en 1777 è couper leurs feigles avant
la ceffation totale des pluies, qui tomboient
encore an mois de Juillet, ont entré bien plus
d’Ergot que les autres. J ’ai comparé un grand
nombre de- ces différentes gerbes , il y avoit
entre-elles une difproportion confidérable à cet
égard. L ’Ergot des gerbes moiffonnées p a r la
pluie féntoit très-mauvais, au lieu que celui
qui avoit été récolté par le temps fec , n’avoit
que l’odeur qui lui eft particulière, lorfqu’il
n’a pas fermenté. Les habitans de Sologne ne
criblent pas leur feigle lorfqu’il eft battu ; ils
fe contentent de le jetter au vent; ce qui
, fuffit -pour en féparer les bâles, moins adhérentes
que celles du froment. 11 y a dans chaque
moulin un crible, mais Ses trous en fout petits
& feulement defiiné? à laiffer échapper la pouf-
fière qui encrafferoit les meules. Seigle, Ergot,'
graines de quelque qualité quelles foient,
tout eft moulu, tout eft mêlé dans la farine. A
compter du moment où fe fait la récolte des
feigles (1) , jufquà celle « farrafins. ( autre
efpèce de grains qu’on cultive en Sologne )
les gens de ces cantons ne font leur pain que
de feigle; leur mifère, capable d’inlpirer de
la douleur à ceux qui la; voient de près, ne
leur permet pas d’en conlerver d’une année à
l’autre. Us atendent toujours avec impatience
(1) On récolte les feigles d’hiver dès le commencement
de Juillet ;. les farrafins les premiers femés , ne fe ré*
coïtent pas avant la fin d’O&obre,
N n