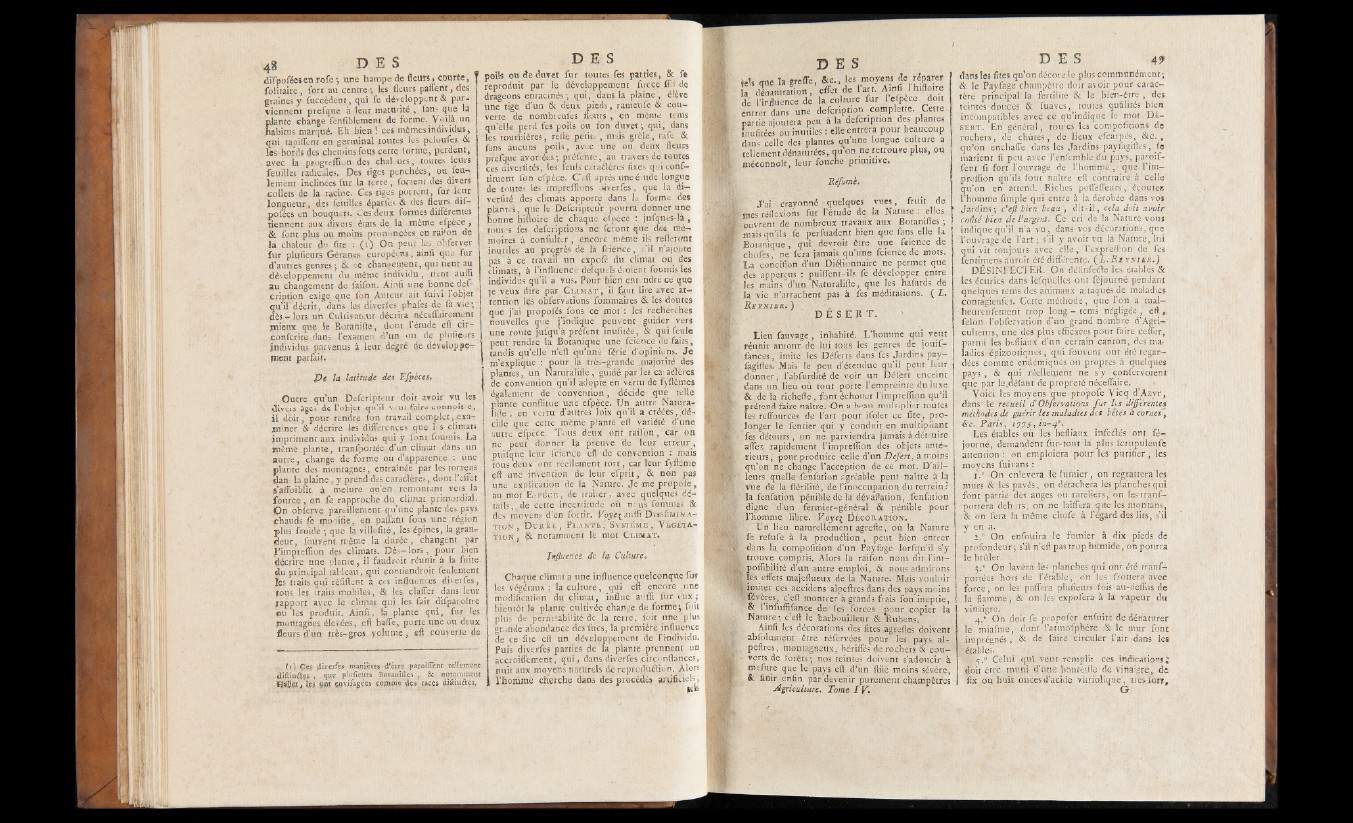
di'fpofées en rofe •, une hampe de fleurs, courte,
folitaire, fort au centre ; les fleurs paflent, des
graines y fuccèdent, qui fe développent & parviennent
piefque à leur maturité , fans que la
plante change fenfiblement de forme. Voilà un
habitus marqué. Eh bien ! ces mêmes individus,
qui tapi fient en germinal toutes les peloufes &
les bords des chemins fous cette forme, perdent,
avec la progreffion des chai- urs, toutes leurs
feuilles radicales, Des tiges penchées, pu feu~
lement inclinées fur la terre, forcent des divers
collets de la racine. Ces tiges portent, fur leur
longueur, des feuilles éparfes & des fleurs dif-
pofées en bouquets. Ces deux formes différentes
tiennent aux divers états de la même efpèce ,
& font plus ou moins prononcées en raifon de
là chaleur fln flte : (1 ) On peur les opferyer
fur plufieurs (Séranes européens, ainfi que fur
d’autres genres’ & ce changement, qui tient au
développement du même individu, tient aufli
au changement de faifon. Ainfi une bonne defeription
exige que fon Auteur ait fuivi l objet
r poils ou de duvet fur toutes fes parties, & fe i
reproduit par le développement fucce fi;f de
drageons enracinés -, qui, dans la plaine , élève
une tige d’un & deux pieds, raméufe & couverte
qu’il décrit, dans les diverfes phafes de fa v ie ; '
dès sr iprs un Cultivateur décrira nécsffairement
jnieux que le Botanifle, dont l’étude efl cir-r
confcrite: .dans l’examen d’un ou de plufieurs
individus parvenus à leur degré de développe-^
pient parfait,
P c la latitude, des Efpeccs,
Outre qu’un Defcripteur doit avoir vu les
divers âges de l’objet qu’il v=m faire connoffe,
il doit, pour rendre fon travail complet ^examiner
& décrire les différences que 1- s climats
impriment apx individus qui y font fournis. La
même plante, tranfportée d’ un climat dans un
autre, change de forme ou d’apparence : une
plante des montagnes, entraînée par les torrens
dan- la plaine, y prend des caractères, dont l’effet
g’affoiblit à mefure qu’en remontant vers la
fource, on fe rapproche du climat primordial.
0 n obferve pareillement qu’une plante des pays
çhauds fe modifie, en panant fous une région
plus froidè * que la villofité, les épines, la grandeur,
fouvent même la durée, changent par
j ’impreflion des climats. D è s -lo r s , pour bien
décrire une plante, il faudroit réunir a la fuite-
du principal tableau , qui pontiendroit feulement
les traits qui réfiftent à ces influences diverfes,
foqs les traits mobiles, & les. claffer dans leur
yapport ayee le climat qui les fait jifparoltre
©u les produir. Ainfi, la plante qui, fur tes
montagnes élevées, efl baffe, porte une ou deux
fleurs d’uq très-gros yolume, efl pouyerte d®
(t) Çes diverfes manières d'ètre paroiffent tellement
, que plufieurs Botaniftes , & ■ notamment
les ont çnYifàgées çojnme $es. tapes diftiaftes.
de nombreufes fleurs , en même tems
quelle perd fes poils pu fon duvet ; qui, dans
les tourbières, relie petite , niais grêle, rafe & |
fans aucuns poils, avec une ou deux fleurs
prèfque avortées; préfente, Nau travers de toutes
ces diverfités, les l’euls cara&êres fixes quiconf-
tituent fon efpèce. Ç’tfl après une étude longue
de toutes les impreffions ûverfes, que la di-
verfité des climats apporte dans la forme des
plantes, que le Defcripteur pourra donner une
bonne hiftoire de chaque efpèce : jufques-là,
tout $ fes defcriptiôns ne feront que des mémoires
à çonfulter, encore même ils relieront
inutiles au progrès de la fcience, s’il n'ajoute
pas à ce travail un expofé du climat ou des
climats, à l’influence deïquels éfoient fournis les
individus qu’il a vus. Pour bien entendre ce que
je veux dire par C limat , il faut lire avec attention
les obfervations fommaires & les doutes
que j’ai propofés fous, ce mot : les recherches
nouvelles que j’indique peuvent guider vers
une route jufqu’à préfent inulitée, & qui feule
peut rendre la Botanique une fcience de faits ,
tandis quelle n’efl qu’une férié d’opinions. Je
m’explique : pour la très-grande majorité des
plantes, un Namralifte, guidé par les caraélères
de convention qu’il adopte en vertu de fyflêmes
également de convention, décide que relie
plante confirme' une efpèce. Un autre Natura-
lifiç , en vertu d’autres ioix qu’il a créées, décide
que cette même plante efl variété d’une
autre èfpèce Tous deux ont raifqn, car on
pë' peut donner la preuve de leur .erreur ,
puifque leur fcience eft de convention : mais
tous deux ont réellement tort , car leur fyfléme
çft une invention de leur efprit, & non pas
une explication de la Nature. Je me propôfè,
au mot Espece , de fraiser, avec quelques détails,
de cette incertitude où nous fommes &
des moyens d’en fortir. auffi Dissémination
, D uré è. , Plante. ' Sys tèm e , V égétation
, & notamment le mot Climat.
Influence de la Çifltwre.
Chaque climat 3 une influence quelconque fur
les végétaux : la culture, qui efl encore une
modification du climat, influe aufli fur eux ;
bientôt la plante cultivée change de forme; foit
plus de perméabilité dé la terre, foit une plus
grande abondance des fucs, la première influence
de ce fite efl un développement de l’individu.
Puis diverfes parties de la plante prennent un
accroiffement, q ui, dans diverfes circonftances,
nuit aux moyens naturels de reproduction. ^lors
rhomme cherche dans des procédés artificiels,
H •;
tel, une la greffe, & c ., les moyens de réparer
h t o r a f i o n , effet de l'art. Ainfi l'h.flo.re
de l’influence de la culture fur 1 efpèce don
entrer dans une defeription complette. Cette-
partie ajoutera peu à la defeription des plantes
inufitées ou inutiles : elle entrera pour beaucoup
dans celle des plantes qu’une longue eu rure a
tellement.dénaturéçs, qu’on ne retrouve plus, ou
méconnoît, leur fouche primitive»
J’ai crayonné quelques vues, fruit de
mes réflexions fur l’étude de la Nature : elles
.ouvrent de nombreux travaux aux Botaniftes ;
mais qu’ils fe perfuadent bien que fans elle la
Botanique , qui devroit être une fffience de
chofes, ne fera jamais qu’uhe fcience de mots.
La concifion d’un Dî#ionnairé ne permet que
des apperçus 1 puiffent-ils fe développer entre
les mains d’un Naturalifte, que les hafards de
la vie n’arrachent pas à fes méditations. ( L.
R e ynie r * )
D E S E R T .
Lieu fauvage , inhabité. L’homme qui veut
réunir autour de lui tous les genres de jouif-
fances, imité les Défères dans fes Jardins pay-
fagiftes. Mais le peu d étendue qu’il peut leur 1
donner, l’abfurdité de voir un Déferr enceint
dans un lieu où fout porte l’empreinte du luxe
& de la richefle , font échouer l’impreffion qu’il
prétendfaire naître. On a beau multiplier toutes
les refl’ouyees de l’art pour i foie r ce fite, prolonger
le fenticr qui y conduit en multipliant
fes détours, on ne. parviendra jamais à détruire
aflez rapidement l’impreffion des objets antérieurs,
pour produire celle d’un Defert, à moins
qu’on ne change l’acception de ce mot. D’ailleurs
quelle «fenfation agréable peut naître à la
vue de la ftérilité, de l’inoccupation du terrein ?
la fenfation pénible'de la dévaluation, fenfation
digne d’un ; fermier-général & pénible pour
l’homme libre. Voye[ Décoration.
Un lieu naturellement agrefle, où la Nature
: fe refufe à la production , peut bien entrer
dans la, compofition d’un Payfage lorfqu’il s’y
"trouve compris. Alors la raifon nous dit l’im-
poffibilité d’un autre emploi, & nous admirons
| les effets majeftueux de la Nature. Mais vouloir
Limiter ces accidens alpeftres dans des pays moins
- fèvères, c’eft montrer à grands frais fon ineptie,
& l’infuffifance de fes forces i pourv copier la
Nature; ceft le barbouilleur & Rubens.
Ainfi les décorations des fîtes agrefles doivent
abfolumént être réfervées pour les pays al-
pefires| montagneux, bériffés de rochers & couverts,
de forêts ; nos teintes doivent s’adoucir à
mefure que le pays efl d’un flilé moins sévère,
& finir enfin par devenir purement champêtres
Agriculture. Tome IV .
clans les fîtes qu’on décore le plus communément;
& le Payfage champêtre doit avoir pour caractère
principal la fertilité & le bien-être , des
teintes douces & fuaves, toutes qualités bien
incômpafibles avec ce qu’indique le mot Dése
r t. En général, rou es les compofitions de
rochers, de chûtes, de lieux efearpés, &c. ,
qu’on enchaffe dans les Jardins payfagiftes, fe
marient fi peu avec l’enfemble du pays, paroiffent
fi fort l’ouvrage de l’homme , que- fini—
preffion qu’ils fout naître eft contraire à celle
qu’on en attend. Riches poffeffeurs, ëcoutex
l’homme fimple qui entre à la dérobée dans vos
Jardins ; c’eft bien beau , dit-il, cela, doit avoir
coûté bien de Vargent. Ce cri de la Nature vous
indique qu’il n’a vu , dans vos décorations, que
l’ouvrage de l’art ; s’il y avoir vu la Nature, lui
qui vit toujours avec elle, l’expreffon de fes
fentimens auroit été différente. (L . R e y n i e r . )
DÉSINFECTER. On définfeéle les érables 8c
les écuries dans lefguelles ont féjourné pendant
quelques tems des animaux attaqués de maladies
contagieufes. Cette méthode, que l ’on a mai—
héuréufement trop long - tems négligée , eft ,
félon l’obfervation d’an grand nombre d’Agriculteurs,
une des plus efficaces pour faire ceffer,
parmi les btfiiaux d’un certain canton, des maladies
:épizo0fiq u e s q u i fouvent ont été regardées
comme 'endémiques ou propres h quelques
pays , & qui réellement ne s’y confervoient
que par ^défaut de propreté néceffaire.
Voici lés moyens que propofe Vicq d’A zyr,
dans le recueil d'Obfervations fur Us differentes
méthodes de guérir les maladies des bêtes à cornes\
&c. Paris, Z775, in-4P.
Les étables où les beftiaux infeélés ont féjourné,
demandent fur-tout la plus fcrupuleufc
attention : on emploiera pour les purifier, les
moyens fuivans :
i.° On enlevera le fumier, on regrattëra les
murs & les pavés, on détachera les planches qui
font partie des auges ou râteliers, on les tranf-
portera dehors, on ne laifïèra que les inontans,
& on fera la même cliofe à l’égard des lits, s’il
y en a.
2.0 On enfouira le fumier à dix pieds de
profondeur; s’il n’efl pas trop humide, on pourra
le brûler.
3.0 On lavera lés planches qui ont été rranf-
portées hors de l’étable, on les frottera avec
force, on les paflèra plufieurs /fois aù-deffus de
_ la flamme, & on les expofera à la vapeur du
vinaigre. " -
4.0 On doit fe propofer enfuite de dénaturer
le. miafme, .dont l’atmoCphère le mur font
i imprégnés, & de faire circuler l’air-dans les
étables.' ' . . _ . "-*% * #
r ° Celui' qui veut remplit ces indications 3
doit être muni d’une bnufeille de vinaigre, de
fix ou huit onces d’acide vitriolique , très-fort.