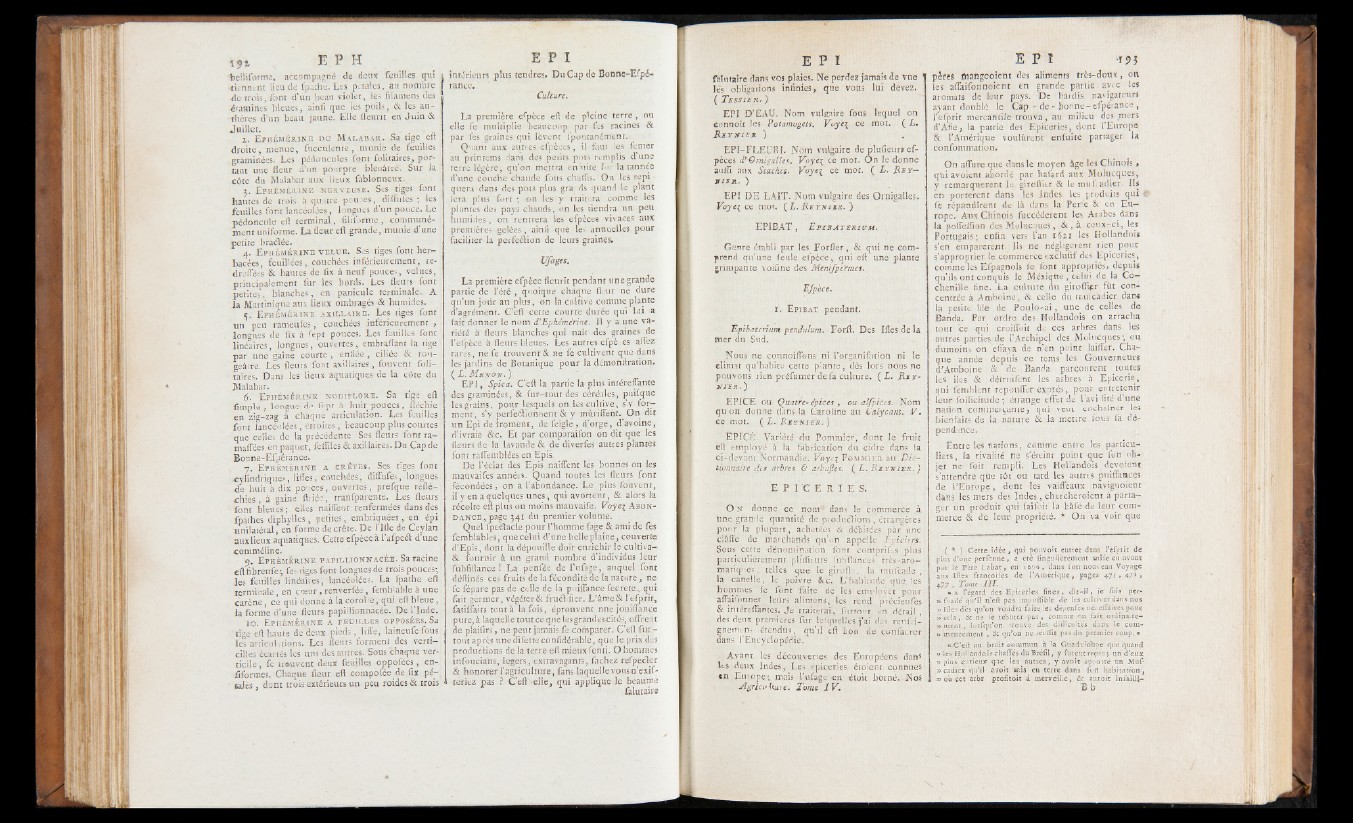
■ belliforme, accompagné de deux feuilles qui
•»tiennent lieu de fpathe. Les pétales, au nombre
de trois, font d’un beau violet, lès filamens des |
-é*amines bleues, ainli que les poils, & les anthères
d’un beau jaune. Elle fleurit en Juin &
Juillet. ...
z. Ephémérine du M a la b ar . Sa tige eft
droite, menue, fucculente, munie de feuilles
graminées. Les pédoncules lont folitaires, portant
une fleur d’un pourpre bleuâtre. Sur la
•côte du Malabar aux lieux fablonneux..
2. Ephémérine nerveuse. Ses tiges font
hautes de trois à quatre pou :es, ^ diffufes ; les
feuilles font lancéolées, longues d’un pouce. Le
pédoncule efl terminal, filiforme, communément
uniforme. La fleur eft grande, munie d’une
petite bractée.
4. Ephémérine v elue. Ses tiges font herbacées,
feuillées, couchées inférieurement, retire
liées & hautes de fix à neuf pouces, velues,
principalement fur les bords. Les fleurs font
petites , blanches, en panicule terminale. À
la Mar/inique aux lieux ombragés & humides.
5. Ephémérine a x il la ir e . Les tiges font
un peu rameufes, couchées inférieurement ,
longues de fix à fept pouces. Les feuilles font
linéaires, longues, ouvertes, embraffant la tige
par une gaine courte, enflée, ciliée & rougeâtre.
Les fleurs font axillaires, fouvent folitaires.
Dans les lieux aquatiques de la côte du
Malabar.
6. Ephémérine nodiflore. Sa tige efl
fimple , longue-de fept à huit ponces, fléchie -
en zi^-zag à chaque articulation. Les feuilles
font lancéolées, étroites, beaucoup plus courtes
que celles de la précédente Ses fleurs font ra-
maffées en paquet, fefilles & axillaires. Du Cap de
Bonne-Efpéran.ce.
7. Ephémérine a crêtes. Ses tiges font
•cylindriques, liftes, couchées, diffufes, longues
de huit à dix pouces,, ouvertes, prefqué réfléchies
, à gaine ftriée, tranfparente. Les fleurs
font bleues ; elles naiflent renfermées dans des
fpathes diphylles , petites, embriquées , en épi
unilatéral, en forme de crête. De rifle de Ceylan
aux lieux aquatiques. Cette efpèce à l’afpeét d’une
•comméline.
9. E phémérine papillïonnacé e. Sa racine
eflfibreufe-, fes tiges font longues de trois pouces;
les fouilles linéaires, lancéolées. La fpathe eft
terminale, en coeur, renverfée , femblable à une
carène, ce qui donne à la corolle, qui eft bleue,
la forme d’une fleurs papillionnâcée. De l’Inde.
10. Ephémérine a feuilles opposées. Sa
tige eft haute de deux pieds, lifte, laineufe fous
les articulations. Les fleurs forment des verti-
cilles écartés les uns des autres. Sous chaque ver-
ticile, fe trouvent deux feuilles cppofées, en-
fiformes, Chaque fleur eft .c.ompofée de fix pé-
jaies, dont trois extérieurs un peu roides & trois
intérieurs plus tendres* Du Gap de Bonne-Efpé-
rance. '
Culture.
La première eCpèce eft de pleine terre, ou
elle fe multiplie beaucoup par fes racines &
par fes graines qui lèvent fpontanément.
Quant aux aunes efpèces, il faut les fomer
au primems dans des petite pots remplis d’une
terre légère, qu’on mettra en uire fur la tannée
d’une couche chaude fous chaftis. On les repi ■
quera dans des pots plus grads quand le plant
fera plus fort ; on le s 'y traitera comme les
plantes des pays chauds, on les tiendra un peu
humides, on rentrera les efpèces vivaces aux
premières gelées, ainli que les annuelles pour
faciliter la perfection de leurs graines.
Ufages.
La première efpèce fleurit pendant une grande
partie de l’été , quoique chaque ffour ne dure
qu’un jour au plus, on la cultive comme plante
d’agrément. C’eft cette courte durée qui lui a
fait donner le nom d? E p h ém é r in e . 11 y a une variété
à fleurs blanches qui naît des graines de
l’efpèce à fleurs bleues. Les autres efpè es aftez
rares, ne fe trouvent & ne fe cultivent que dans
les jardins de Botanique pour la démonftration.
( X. Menoe. ) ,
E PI, S p ic a . C’eft la partie la plus inréreflante
des graminées, & fur-tout des céréales; puifque
les grains, pour lesquels on les cultive, s’y forment,
s’y, perfectionnent & y mûriffent. On dit
un Epi çle froment, de feigle, d’orge, d’avoine,
d’ivraie &c. Et par comparaifon on dit que les
fleurs de la lavande & de diverfes autres plantes
font raffembléès en Epis.
De l’éclat des Epis naiflent les bonnes ou les
mauvàifes" années. Quand toutes les fleurs font
fécondées , on à l’abondance. Le plus fouvent,
il y en a quelques unes, qui avortent, & alors la
récolte eft plus ou moins mauvaife. Voyez Abondance,
page 341 du premier volume.
Quel fpeCtacle pour l’homme fage & ami de fes
femblables, que celui d’une belle plaine, couverte.
d’Epis, dont la dépouille doit enrichir le cultivà-
& fournir à un grand nombre d’individus leur
fubfiftanee ! La penfée de l’ufa^e, auquel font
déftinés ces fruits de la fécondité de la nature, ne
fe fépare pas de celle de la puiffance fecrete, qui
fait germer, végéter & fructifier. L ’âme & l ’efprit,
fatiffairs tout à la fois, éprouvent nne jouiffance
pure, à laquelle tout ce que les grandes cités, offrent
de plaifirs , né peut jamais fe comparer. C’eft fur-
tout après unedifette confidérable, que le prix des
productions de la Terre eft mieux fenti. O hommes
infouciahs, légers, extravagants, fâchez refpeCter
& honorer l’agriculture, fans laquelle vous n’exif-
îeriez pas ? C ’eft »elle, qui applique le heaume
falutaire
faîufaire dans vos plaies. Ne perdez jamais de vue f
les obligaiions infinies, que vous lui devez. ( T essier. )
EPI D’EAU. Nom vulgaire fous lequel on
connoît les Potamogets. Voyez ce mot. ( X.
R e y v i e r )
EPI-FLEURI. Nom vulgaire de plu (leurs efpèces
d’ -Ornigalles. Voyez ce mot. On le donne
aufli aux Stackis. Voyez ce mot. ( X. R e Yt-
B IER. )
EPI DE LAIT. Nom vulgaire des Ornigaîles.
Voyez ce mot. (X . R e ÿ v ie r . )
E P IB A T , E f - ib a t z r i v m .
Genre établi par les Forfter, & qui ne comprend
qu’une feule elpèce, qui eft une plante
grimpante voifine des Menifpermes.
EJpece.
I. EpibaT pendant.
Epibaterium pendulum. Forft. Des Ifles de la
Hier du Sud.
Nous ne connoiffons ni l’organifation ni le
climat qu’habite cette plante, dès lors nous ne
pouvons rien préfumer de fa culture. (X . Ræy-
tti'e r . )
EPICE ou Quatre-épices , ou alfpices. Nom
qu’on donne dans la Caroline au Calycant. V .
ce mot. ( X. Re y n ie r .)
EPICK. Variété du Pommier, dont le fruit
.eft employé à la fabrication du cidre dans la
ci-devant Normandie. V o y e z Pommier au D ic tionnaire
des arbres & arbuftes. f X. R e y e i e r . )
E P I C E R I E S .
O n donne ce nom‘ dans le commerce à
line grande quantité de productions, étrangères
pour la plupart, achetées & débitées par une
clâfle de marchands qu’on appelle Epiciers.
Sous cette dénomination font coihprifos plus
particuliérement plüfiturs fubftances très-aro-
matiqre;, telles, que le girofl :, la mulcade ,
là canelle, ,1e .poivre &c. L’habitude quelles
hommes fe font faite de les employét pour
aflaifonner leurs ali mens , les rend précieufës
& intéreftantes. Je traiterai, furrov-r en .détail ,
des deux premières fur lesquelles j’ai des renfei-
gnemenq étendus, qu’ il eft bon de confacrer
dans l’Encyclopédie.
Avant les découvertes des Européens dans
les deux Indes, Les épiceries étoient connues
«n Europe’ mais 1’11 fage en étoit borné. Nos
Agrici‘ {iuie. Tome IV .
pèfes mangeoient des aliments très-doux, on
les affaifonnoient en grande partie ayte les
aromats de leur pays. De hardis navigateurs
ayant doublé le Cap - de - bonne-efpérance ,
l’efprit mercantile trouva, au milieu des mers
d’Afie, la patrie des Epiceries, dont l’Europe
& l’Amérique voulurent enfuite partager la
-confommation.
On affure que dans le moyen âge les Chinois >
qui avoient abordé par hafard aux Molucques,
y remarquèrent le. giroflitr & le mufladier. Ils
en portèrent dans les Indes les produits qui £
fe répandirent de là dans la Pene & en Europe.
Aux Chinois fuecéderent les Arabes dâns
la poffeffton des Molucques, & , à ceux-ci, les
Portugais; enfin vers l’an i 6 z i les Hollandois
s’en emparerez t. Ils ne négligèrent rien pour
s’approprier le commerce exclufif des Epiceries,
comme les Efpagnols fe font appropriés, depuis
qu’ils ont conquis le Méxiqtte, celui de la Cochenille
fine. La culture du giroflier fût concentrée
à Amboine, & celle du miifcàdier dans
la petite îtle de Poiflo-a i, une de celles de
Banda. Par ordre des Hollandois on arracha
. tout ce qui croiflbit de ces arbres dans les
autres parties de l’Archipel des Molucques ; ou
dumoim on effaya de n’en point laiffer. Chaque
année depuis ce rems les Gouverneurs
d’Amboine & de Banda parcourent toutes
les iles & détruifent les arbres à Epicerie,
qui femblenr repouffer exprès, pour entretenir
leur follicitude ; étrange effet de l ’avi liré d’une
nation commerçante, qui. veut enchaîner les
bienfaits de la nature & la mettre fous fa dépendance.
Entre les nations, comme entre les particuliers,
la rivalité ne s’éteint point que fo'n objet
ne foit rempli. Les Hollandois dévoient
s’attendre que tôt ou tard les autrts puiffaaces
de l’Europe, dont les vâiffeaux naviguoient
dans les mers des Indes , chercher oient à partager
un produit qui faifoif la bâte de leur commerce
& de leur propriété. * On va voir que
M * ) Cette idée, qui pouvoit entrer dans l’èfprit de
plus d’une perfonne , a été finguljèremcnt snife en avant
par le Père Laba t, en 16 96, dans i on nouveau Voyage
aux Ifles françoifes de l’Amérique, pages 47J , 476 ,
477 , Tome I II.
a a l’égard des Épiceries fines, d i t - i l , je fuis per-
» fuadé qu’il n’eft pas impolfible de les cultiver dans nos
»Ifles dès qu’on voudra faire les dépenfes ncceflairespoui:
» c e la , & ne-fe rebuter-pas, comme on fait ordinaire-
» m en t, lorfqu’on trouve des difficultés dans le com-
» mencement , & qu’on ne léuflit pas du premier coup.»
«C ’eft un bruit commun à la Guadeloupe que quand
» les Huliandoi? chaffés dUBréfil, y furent reçus ; un d’eux
» plus curieux q ie les autres, y avoir appoiré ton Mùf-
» cadier qu’il a/o it sr.is en terre dans Ion habita t ie n ,
» où cet arbï »rofitoit d merveille, & auroit infailli-
B b