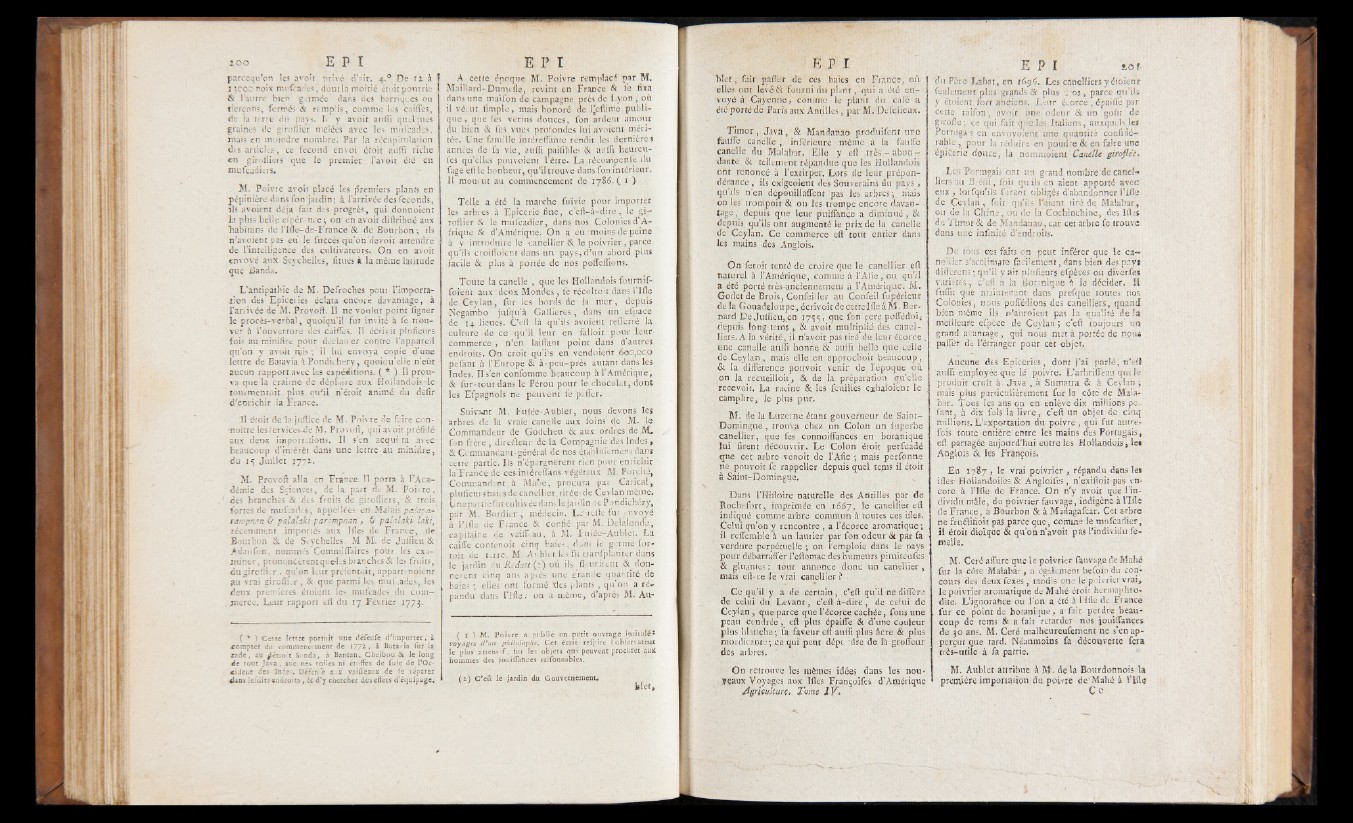
parceqtften les avoït privé d’air. 4.0 De n à
I $cco noix mufeades, dont la moitié érôic pourrie
& l’autre bien germée clans des barriques ou
tierçons, fermés & remplis, comme les caiffes,
de la terre du pays, li y avoit aufli quelques
graines de giroflier melées avec les mufeades,
mais en moindre nombre. Par la récapitulation
des articles, ce fécond envoi étoit aufli riche
en girofliers que le premier i’avoit été en
mufeadiers.
M. Poivre avoit placé les premiers plants en
pépinière dans fon jardin; à l’arrivée des féconds,
ils avoient déjà fait des progrès, qui donnoient
la plus belle efpér-.nce; on en avoit diflribuë aux
habitans de li fk—d?-France & de Bourbon ; ils
n'avoient pas eu le fuccès qu’on'de voit attendre
de rinrelligence des cultivateurs. On en avoit
envoyé aux Seychelles, fi tués à la même latitude
que Banda.
L ’antipathie de M. Defroches pour l’importation
des Epiceties éclata encore davantage, à
l’anivée de M. Provoft. Il ne voulut point ligner
le procès-verbal, quoiqu’il fut invité à fe trouver
à l’ouverture des caiffes. Il écrivit plufieurs
fois au miniiire pour déclamer contre l’appareil
qu’on y avoit npis ; il lui envoya copie d’une
lettre de Batavia à Pondichéry, quoiqu’elle n’eût
aucun rapport avec les expéditions. ( * ) Il prouva
que la crairne de déplaire aux Hollandois-le
tourmentoit plus qu'il n’étoit animé du defir
d'enrichir la France.
Il étoit de la juflice de M. Poivre de faire Con-
-îioitre les fervicesde M. Provoft, qui avoir préfidé
aux deux importations. Il s’en acquûra avec
beaucoup d’inrérêt dans une lettre au miniilre,
du 15 Jiullet 1771.
M. Provoft alla en France. 11 porta à f Académie
des Sciences, de la part de M. Poivre,
des branchés & des fruits de girofliers, & trois
fortes de mufeades, appelléesj en Malais palapa-
ra.rp.pnan & palalakï parampnan , & palalaki laki,
récemment importés aux 1 fies de France, de
Bourbon & de Seychelles M M. de Juflieu &
Àdaï5fon, nommés CommifTaires pour les examiner,
prononcèrentqnelcs branches & les fruits,
du giroflier , qu’on leur préfentuit, apparrî-noienr
au vrai gircfii.r, & que parmi les, muf.ades,. J es
deux premières étoietlt les mufeades du commerce.
Leur rapport eft du 17 Février 1773.
( * ) Cette lettre portoit une défenfe d’importer, à
■ compter du commencement de 1771, à Batavia fur la
tzde, au ^é tro it S.nda, à Bantan, Cheibou & le long
jde tout Java, aucunes toiles ni étoffes de foie de l’Pc-
«ideiit des Indes. Défen e aux vailïëaux de fe réparer
dans feiftits endroits, U d’y chercher des effets d’équipage.
A cetfe époque M. Poivre remplacé par M.
Maillard-Dumtfie, revint en France & le fixa
dans une mavfon de campagne près de Lyon , où
il vécut limple, mais honoré de l'eftifne publique
> que les vertus douces, fon ardent amour
du bien & fes vues profondes lui avoient méritée.
Une famille intéreffame rendit les dernières
années de fa vie, aufli paifibles & aufli heureu-
fes qu’elles pou voient l’être. La récotàipenfe du
fage eft le bonheur, qu’il trouve dans fon intérieur.
Il mouiut au commencement de 17 8 6 .(1 )
Tell,e a été la marche fume pour importer
les arbres à Epicerie fine, c’eft-à-dire, le giroflier
& le mufeadier, dans nos Colonies d’Afrique
& d’Amérique. On a eu moins de peine
à y introduire le canellier & le poivrier, parce
qu’ils croiffoient dans un pays,d'un abord plus
facile & plus à portée de nos pofîeflions.
Toute la canelle , que les Hollandois fournif-
foient aux deux Mondes , fe récoltoit dans l’Ifle
de Ceylan, fur les bords de la mer, depuis
Negambo jufqu’à Gallieres, dans un efpace
de 14 lieues. C’eft là qu’ils avoient refierré la
culture de ce qu’il leur en falloir pour leur-
commerce , n’en laifiant point dans d’autres
endroits. On croit qu’ils en vendoient 600,000
pelant à l’Europe & à-peu-près autant dans les
Indes. Il s’èn confomrne beaucoup à l’Amérique,
& fur-tour dans le Pérou pour le chocolat^ dont
les Espagnols ne peuvent fe pafler.
Suivant M. Fufée-Aublet, nous devons les
arbres de la vraie canelle aux Foins' de M. le
Commandeur de Godehen & aux ordres de M.
fon frère , directeur de la Compagnie des Indes,
& Commandant-général de nos éiabliliemens dans
cette partie. Ils n’épargnèrent rien pour enrichir
la France de ces in t ère (Ta ns végétaux M. Porche,
Commandant à Ma ne, procura par Caricai,
plufieurs baies de canellier, tirée<de Ceylan même.
Ü n e parti e fu t eu It i v ée d a n sle jardin de Pondichéry,
par M. Bordier , médecin. Le^refle fur ; nvoyé
à l’jfle de Fiance & confié par M. Delalonde,
capitaine de vaifT..aii, à M. f uféé-^Aublét. La
caiffe contenoit cinq baies, dont le germe for-
toit de n.rre. M. Aubier les fit tranfplamer dans
le jardin du Réduit J 2) ou ils fleurirent & donnèrent
cinq ans après une grande quantité de
baies ; elles ont formé 'des plants, qu’on a répandu
dans rifle : on a même, d’après M. À11-
( ï ) M. Poivre a publié un petit ouvrage intituléî
voyages d’un philofoplie. Cet écrit refpire l'obfervatctu:
le plus attentif; iur les objets qui peuvent procurer aux
hommes des jouilfalices raifonnables.
(.2) C’eft le jardin du Gouvernement.
blet,
blet, fait paffer de ces baies en France, où
elles ont levé & fourni du plant, qui a été envoyé
à Cayenne/ comme le plant du café a
été porté de Paris aux Antilles, par M. Defclieux.
Timor, Java, & Mandanâo produifent une
faitfle canelle, inférieure même à la faufie
canelle du Malabar. Elle y efl -très. - aboli -
liante^ & tellement répandue que les Hollandois
ont renoncé à l’extirper. Lors de leur prépondérance
, ils exigeoient des Souverains du pays,
qu’ils n'en dépouillaflent pas les arbres*,, mais
on les trompoit & on les trompe encore davantage,
depuis que leur puiffance a dirninué’, &
depuis qu’ils ont augmenté'le prix de la canelle
de Ceylan. Ce commerce efl; tout entier dans
les mains des Anglois.
On fer oit tenté de croire que le canellier efl
naturel à l’Amérique, comme à l’Afie, ou qu’il
a été porté très-anciennement à l’Amérique; M.
Godet de B rois, Confeiller au Confeil fupérieur
de la Gouadeloupe, écrivoit decettelfle à M . Bernard
Dé Juliieu, en 1755 » que fon pere polfédoij
depuis long tems > & avoir multiplié dès canel-
ljers. A la vérité, il n’avoit pas tiré de leur écorce .
une candie aufli bonne & aufli belle que celle
de. Ceylan, mais elle ,en ap prochoir beaucoup,
& la différence pouvoir venir de, l’époque où
on la rècueilloit, & de la préparation qu’elle
recevoir. La racine & les feuilles exhaloient le .
camphre, le plus pur,
M. de la Luzerne étant gouverneur de Saint-
Domingue , trouva chez un Colon un fuperbe
canellier, que fes connoiffances en botanique
lui firent découvrir. Le Colon étoit perfuadé
que cet arbre venoit de l’Afie ; mais perfonne
ne pouvoir Fe rappeller depuis quel tems il étoit
à Saint-Domingue.
Dans l’Hifloire naturelle des Antilles par de
Rochèfort, imprimée en 1667, Il canellier efl
indiqué comme arbre commun à toutes ces ifles.
Celui qu’on y rencontre , a l’écorce aromatique;
il reflemhle à un laurier par ion odeur & par fa
verdure perpétuelle ; on l’emploie dans le pays
pour débarraffer l’eflomac des humeurs pituiteufes'
& gluantes : tout annonce donc un canellier,
mais eft-ce le vrai canellier ?
Ce qu’il y a de certain, c’eft qu’il ne diffère
de celui du Levant, c’eft à-dire , de celui de
Ceylan , que parce que l’écorce cachée, fous une
peau cendrée, efl plus épaiffe & d’une couleur
plus blanche; fa faveur efl aufli plus âcre & plus
mordicante; ce qui peut dépc 'dre de là groffeur
des arbres, J
On retrouve les mêmes idées dans les nouveaux
Voyages aux Ifles Françoifçs d’Amérique
Agriculture. Tome IV .
du Père Labat, en r696. Les cànelliers y étoienf
feulement plus grands & plus -os, parce qu’ils
y étoient fort anciens. Leur écorce , épaiffe par
cette raifon, avoit une odeur & un goût de
girofle; ce qui fait que les Italiens, auxqucU les
Portugais en envoyoient une quantité confidé-
rabie , pour la réduire en poudre & en faire une
épicerie douce, la hommoient Canelle giroflée.
Les Portugais ont un grand nombre de canel-
liers au Biéfil, foie qu ils en aient apporté avec
eux lorfqu’ils furent obligés d’abandonner l’ifle
de Ceylan, foit qu’ils l’aient tiré de Malabar,
on de.la Chine, ou de la Cochinchine, des Ifl-S
de Timor & de Mandanao, car cet arbre fe trouve
dans une infinité d’endroits.
De tous ces faits on peut inférer que le ca—
nellier s’acclimate facilement, dans bien des pays
diffère iis qu'il y air plufieurs efpèces ou diverfes
variétés, c’eft à la Botanique à le décider. H
fuffit que maintenant dans prefque toutes nos
Colonies, nous pofléchons des canelliérs, quand
bien même ils rdauroient pas la qualité de la
meilleure efp.èce de Ceylan ; c’eft toujours un
grand avantage, qu-i nous met à portée de nous
paflér de l’étranger pour cet objet.
Aucune des Epiceries, dont j’ai parlé, n’efl
aufli employée que le poivre. L ’arbriffeau qui le
produit croît à Java ,Ji Sumatra & à. Ceylan ;
mais plus particulièrement fur la côte de Malabar.
Tous les ans on en enlève dix millions pe-
Tant, à dix fols la livre, c’eft un objet de cinq
millions. L’exportation du poivre , qui fut autrefois
toute entière entre les mains des Portugais,
efl partagée aujourd’hui entre les Hollandois, le»
Anglois & les François.
En 1787 » le vrai poivrier , répandu dans les
ifles- Hoilandoifes & Angloifes, n’exiftoit pas encore
à l’Ifle de France. On n’y avoit que l’individu
mâle, du poivrier fauvage, indigène à l’Ifle
de France, à Bourbon & àMadagafcar. Cet arbre
ne fruélifioir pas parce que, comme le mufeadier,
il étoit dioïque & qu’on n’avoit pas l'individu femelle,
M. Ceré affure que le poivrier fauvage de Mahé
fur la côte Malabar, a égalemènt be foin du concours
des deux fexes , tandis que le poivrier vrai,
le poivrier aromatique de Mahé étoit hermaphrodite.
L ’ignoratice ou l’on a été à l’Ifle de-France
. fur ce point de botanique, a fait perdre beaucoup
de tems & a fait retarder nos jouilfances
de 30 ans. M. Ceré malheureufement ne s’en ap-
perçut que tard. Néanmoins fa découverte fera
très-utile à fa patrie.
M. Aublet attribue à M . de la Bourdonnois la
i preufière importation du poivre de'Mahé à VIÛ3
C c