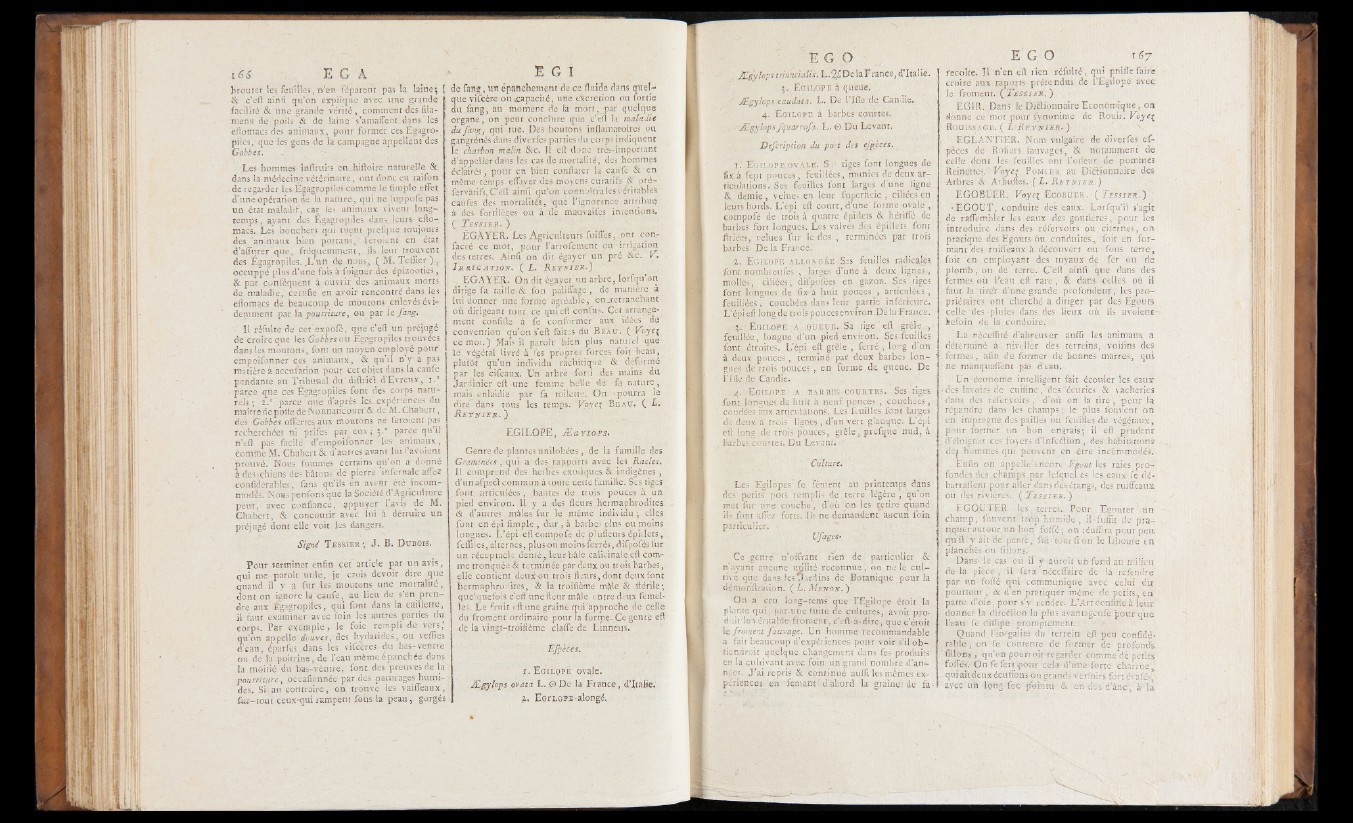
1.66' E G A
brouter les feuilles., n’en féparent pas la laine $
& c’eft ainfi qu’on explique avec une grande
facilité & une grande vérité, comment des filament
s de poils & de laine s’amaffent dans‘ les
eftomacs des animaux, -pour former ces Egagro-
piles, que les gens de la campagne appellent des
Gobbes.
Les hommes inftruifs enJiiftoire naturelle &
dans la médecine vétérinaire, ont donc eu raifon
de regarder les EgagropiLes comme Le fimple effet
d’une opération de la nature , qui ne (uppofepas
un état maladif, car les animaux vivent longtemps,
ayant des Egagropiles dans, leurs efto-
raacs. Les bouchers qui tuent prefque toujours
des. animaux bien pôrtans, feroient en état
d’a(Tarer que, fréquemment, ils leur trouvent
des Égagropiles. .L’un de nous, ( M. Tefiier ) K
occuppé plus d’une fois à Coiguér des épizooties,
& par conféqnent à ouvrir des animaux morts
de maladie, certifie en avoir rencontré dans les
effomacs de beaucoup de moutons enlevés évidemment
par la pourriture, ou par 1 e fans,.
Il réfulte de cet’expofé, que c’éft un préjugé
de croire que les Gobbes ou Egagropiles trouvées
dans les moutons , font un moyen employé pour
empoifonner ces animaux, & qu’il n’y a pas
matière à accufation pour cet objet dans la caùfe
pendante au Tribunal du diftrici d’Evreux, i.°
- parce que ces Egagropiles font des corps naturels
; i.° parce' que d’après-ieslexpérienees du
maître déporté de NonnancQUrc & de M. Chabert,
des Gobbes offertes aux moutons ne feroient pas
recherchées ni prifes par eux ; 3.0 parce qui!
n’efl pas facile d’empoifonrier les animaux,
comme M. Chabert & d’autres avant lui 1 avoient
prouvé. Nous Tommes certains qu on a donné
à des}chiens dés bâtons de pierre infernale affez
conrtdérabîes, fans qu’ils en a vent été incommodés.
Nous penfons que la Société d’Agriculture
peut, avec confiance, appuyer l’avis de M.
Chabert, & concourir avec lui à détruire un
préjugé dont elle voit les dangers.
Signé T essier' J . B. D ubois,
Pour terminer enfin cet article par un avis,
qui me paroît utile, je crois devoir dire que
quand il y a fur les,moutons une mortalité,
dont on ignore la caufe, au lieu de s’en pren-^
dre aux Egagropiles, qui font dans la caillette,
il faut examiner avec foin les autres parties du
corps. Par exemple, le foie rempli de vers*
qu’on appelle douves, des hydatides, ou vefiies
d’eau, éparfes^dahs les vilcères du bas-ventre
ou de la poitrine, de l’eau même épanchée dans
la moitié du bas-véntre, font des preuves de la"
pourriture , occafionnée par des pâturages humides.
Si:au contraire, on trouve les yaiffeaux,
for-tout ceux-qui rampent fous la peau, gorgés
I G I
de fan g , un épanchement de ce fluide dans quelque
vifcère ou capacité, une excrétion ou fortie
du fang, au moment de la mort, -par quelque
organe, on peut conclure que c’eft la maladie
du fang, qui tue. Des boutons inflamaeoires ou
gangrénés dans diverfes parties du corps indiquent
le charbon malin &c. Il ert donc très-important
d’appeller dans les cas dé mortalité, des hommes
éclair és, pour en bien confiater la caufe & en
même-temps effayer des moyens curatifs & pré-
Tervàtifs, Ç’eft ainfi qu’on connoîtra les véritables
caufes des mortalités, que l’ignorance attribue
à des fortilègeà' ou à de manivaifes intention s.
( T essier. )
ËGÂYER. Les Agriculteurs fuiffes, .ont con-
facré ce mot, pour Tarrofement ou irrigation
des terres. Ainfi on dit égayer un pré &c. V,
I r r ig a t io n . ( L. R eynier.)
EG AYER, On dit égayer un arbre, lorsqu'on
dirige fa taille & fon paliffage , de manière à
lui donner une forme agréable , enjrerranchant
où dirigeant tout ce qui ert confus. Cet arrangement
confifte à fe conformer aux idées de
convention qu’on s’eft faites du Bea u . ( Voye\
ce mot. ) Mais il paroît bien plus naturel que
le végétal livré à fes propres forces foit beau,
plutôt qu’un individu rachitique & déformé
par les cifeaux. Un arbrè foni des mains du
Jardinier ert urne femme belle dé fa nature,
mais enlaidie par fa toilette. On 'pourra le
dire" dans -tous les temps. Voye^ Bea u , (, X.
R e y n i e r . )
EGILOPE, Æ gyeops.
Genre de plantes unilobées, de la famille des
Graminées , qui a'des rapports avec les Racles.
Il comprend des herbes exotiques & indigènes,
d’un afpeclcommun à toute cette famille. Ses tiges
font articulées , hantes de. trois pouc.es à un
pied environ. 11 y a des fleurs hermaphrodites.
& d’autres mâles fur le même individu -, elles
font en épi fimple , dur., à barbe? plus ou moins
longues. L ’épi ert compofé de plufieurs épUiers,
fefliies, alternes, plus ou moins ferrés, difpofés fur
un réceptacle denté, leurbâle.calicinale.eft comme
tronquée & terminée par deux ou trois barbes,
elle contient deux-ou trois fleurs, dont deux font
hermaphrodites, & la troifième mâle & ftérile;
quelquefois c’eft une fleur mâle entre deux femelles.
Le fruit tft une graine qui approche de celle
du froment ordinaire pour la forme^ Ce genre ert
de la vjngt-troifième claffe de Linnens.
Efpetès.
1. Ê gilqpe ovale.
JEgyîops pvata L. 0 De la France, dTtafie.
2. E.GriiOPE-aîongé,
E G O
JE'gylops triuncialis: L.^iDe la France, d'Italie.
3. E gilôpe à queue.
Ægylops taudata. L. De Tille de Candie.
4. E gilope à barbes-courtes.
Ægylops fquarrofa. L. © Du Levant.
Defcription du port des efpeces.
t. Egilope ovale. S tiges font longues de
lix à fept pouces, feuillées, munies de deux articulations.
Ses feuilles font larges d’une ligne
& demie, velues en leur fuperfleie , ciliées en
leurs bords. L ’épi ert court, d’une forme ovale ,
eompofé de trois à quatre épiilets & hériffé de
barbes fort longues. Les valves .flés épiilets font
ftrièes, velues fur le dos , terminées par trois
barbes. De la France.
2. Egilope allongée S?s feuilles radicales
font nombreufes , larges d’une à deux lignes«,
molles, ciliées, difpol’ées en gazon. Ses'.tiges
font longues de fix- à huit pouces , articulées ,
feuillées, couchées dans leur partie inférieure.
L ’épi ert long de trois poucesenviron.De la France.
3. Egilope a . queue. Sa tige ert grêle ,
feuillée, longue'd’un pied environ. Ses feuilles
font étroites. L’épi eft grêle , ferré , long d’un
à deux pouces, terminé par deux barbes longues
dé .trois pouces | en forme de. queue, De
rifle.de Candie.
. 4. E gilope a barbes courtes. Ses tiges
font longues de huit à neuf poucès , couchées j
coudées aux articulations. Les feuilles font larges
de deux à trois lignes , d’un vert glauque. L’épi
eft long .de trois pouces, grêle, prefque riud, à
barbes comtes. Du Levant.
Culture.
Les Egilopes' fe lèmént au printemps dans
des petits pots remplis de terre légère y'qu’on
met fur une couche, d’ôù 'on les retire quand''
ils font affez forts. Ils ne demandent aucun foin
particulier.
Ufagen-
Ce genre n’offrant rien de particulier &
n'ayant aucune utilité reconnue, on ne le cultive
que dans les Jardins de Botanique pour la
démotiftration. ( L. Menon. )
On a cru long-tems que l’Egilope étoit la
plante qui, par une foire de cultures, avoir pro-
di.it le véritable;.froment, c’eft-à-dire, que c’éroit
le froment faùvâge. Un homme recommandable
a fait beaucoup d'expériences pour voir s’il ob-
fien.droit quelque changement dans fes produits
en la cultivant avec foin un grand nombre d’années.
J ’ai repris & continué auffi les mêmes expériences
en femant' d’abord la graine t de fa
E G O
fecolfe. Il n’en eft tien réfulté, qui pniffe faire
croire aux rapofts prétendus de i’Egilopè avec
le froment. ( T e s s i e r . )
EGIR. Dans ,1e Dictionnaire Economique, on
donne ce mot pour fynonime de Rouir. Voye%
Rouissage. ( L R é y n ïe r . )
EGLANTIER. Nom vulgaire de diverfes ef-
pèc.es de Rofiers fauvages, & notamment de
celle d'onr les feuilles ont T odeur, de pommes
Reinettes.1 Voye{ P omier au Diélionnaire des
Arbres & Arburtes. ( X. R e y n i e r . )
EGOBUER. Veye{ Ecobuer. ( Tessier. )
•EGOUT, conduite des eaux. Lorfquil s’agit
de .raffembler les eaux des goutières, pour les
introduire dans des réfervoirs ou citernes, on
pratique des Egouts ôu conduites, foit en formant
des rniffeaux à découvert ou fous terre,
foit en employant des tuyaux' de fer ou de
plomb, ou de terre. C’efl ainfi que dans des
fermes où l’eâu eft rare , & dans celles où il
faut la tireV d’une grande profondeur, les propriétaires
ont cherché a diriger par des Egouts
celle des pluies dans des lieux où ils avoient
feefoin de la conduire;
La néceffité d’abreuver auffi les animaux, a
déterminé à nivdler des terreins, voifins des
fermes, afin de former de bonnes marres, qui
ne manquaient pas d’eau.
Un économe inrelligént fait écouler les eaux
des lavoirs de cuifine, des "'écuries & vacheries
dans des réfervoirs , d’où on la tire , pour la
répandre dans les champs/, le plus fou vent on
en imprégné des pailles ou feuilles de végétaux,
pour former un bon engrais-, il efl prudent
d’éloigner ces foyers d’infeétion , des hâbifàtions
des hommes qui peuvent eh êrre incommodés.
Enfin on appelle encore Egout l'es raies profondes,
des ..champs par lefquel es les eaux fe dé-
barraflent pour aller dans dés étangs,, des ruiffeaux
ou des rivières. ( T e s s i e r . ) ,
EGO.UTER les, terres. Pour Egouter un
champ, fou vent Trop humide , , il ' fuffit de pratiquer
autour un bon foffé -, on réuffira pour peu
qu’il' y ait dé pente, fuir-tout fi on le laboure tn
planches ou filions.
Dans lé cas' où il y auroit un fond an milieu
de là pièce , il fera nëeeflaire de la refendre
par un foffé-qui communique . avec celui du
pourtour, & d’en pratiquer même d'e petits, en
patte d’oie, pour s’y rendre. L ’Art confiffe à leur
donner la direction la plus avantageufe pour que
Te au fe diffàpe promptement.
Quand.l’inégalité du terrein efl peu confidé*
râblé, on fe contente de former de profonds,
filions , qu’on pourroit regarder comme de petits
foffés. On fe fert pour cela' d’une-forte charrue *
qui ait deux écufibns ou grands vérfoirs fort ëvafés
ayec un Ipng foc p o b uv & en dos d’â n e à la