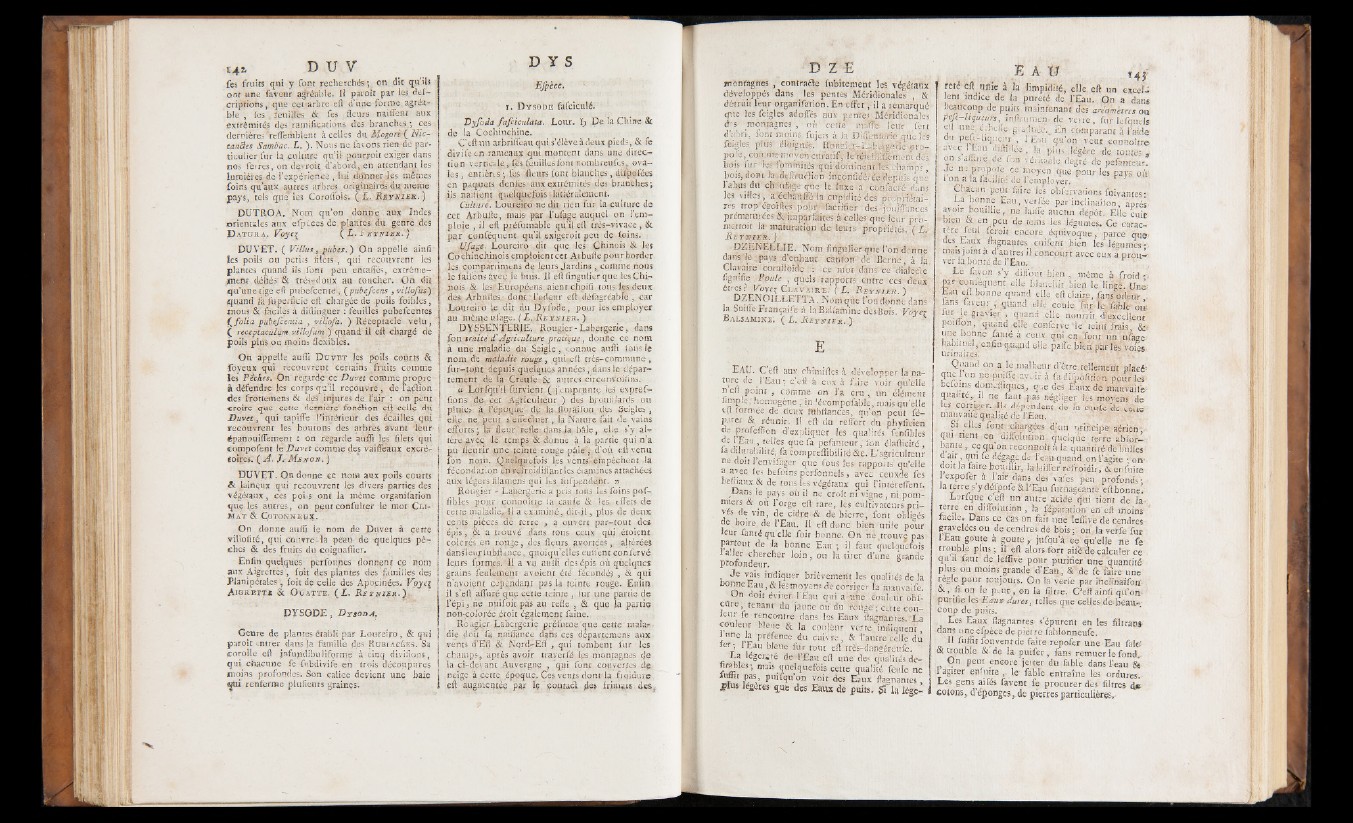
t 4 a D U V
fes fruits qui y font recherchés ; on dit qu’ils
ont une faveur agréable. Il paroît par les def-
cripfions, que cet-arbre eft d’une forme, agréable
, fes r feuilfès & fes fleurs n aillent au x,
extrémités des ramifications des branches,; ces
dernières Teffeihblent à ceLles du Mogori Q Nic-
tanctes Samb'ac. L. ). Nous ne favons riendè particulier
fur la, culture qu’it pourroit exiger dans
nos ferres, on détroit d’abord,:en attendant les
lumières de l'expérience, lui donner flps mêmes
foins qu’aux autres arbres originaire-s du même
pays, tels qjie les Corofl'ols. ( X. R e y n i e r . ) j
DUTROA. ;Nqm qu’on donne aux Indes
orientales aux efpèees de plantes du genre des
P a tu r a . V o y e i ( L / i - è r n i e * .
DUVET. ( Villus, pubes.) On appelle ainfi
les poils ou petits filées § qui recouvrent les
plantes quand ils font peu entaffés, extrême-
.nient déliés'& trèsTdoiix au toucher. . On dit
qu’une tige eft pubefeenté, {pubefeens , villofüs)
quand fa fuperficie eft chargée de poils foibles,
mous & faciles à diftinguer : feuilles pubefeentes
( folia pubefcer.tia , villofa. ) Réceptaclé./ve lu ,
( receptaculum villofutn ) quand il eft chargé de
poils plus ou moins flexibles.
On appelle auffi D uvet les poils courts &
foyeux qui recouvrent certains fruits comme
les Pêches. On regarde ce Duvet comme propre; ;
à défendre les corps qu’il recouvré , de l’action
des frottemens & des injures de l’air : on peut
croire que cette dernière- fonction eft celle du
Duvet, qui tapifle 1 Antérieur des écailles, qui !
recouvrent les boutons" des arbres avant fleur (
épanouiflement : on regarde anifi les. filets qui ;
compofent le Duvet comme des vaiffeaux e^cré^ j
toiles. ( A . J. Menqn. )
DUVET- On donne ce nom aux poils courts
Sl laineux qui recouvrent les divers parties des
végétaux, ces poii.s ont la même organifarion
que les autres , on peurçonfuker le mot Climat
& ÇOTONNEUX.
On donne auffi le nom de Duvet à cette
villofiré, qui couvre- la pé&ù- de quelques pêches
& des fruits du coignaflier.
Enfin quelques perfonnes donnent cp nom
aux Aigrettes , foit des plantes des familles des
Plànipétales, foit de celle des Apocinées> Vpyei
AlGRETTJt & O p ATTE. ( L. Rp Y NIER. )
D Y SO D E , D y s o d a .
Genre de plantes établi par Loureiro, & qui
paroît entrer dans la famille des Rubïacées. -Sa
corolle eft pfundibu liforitie à Cinq diyifions,
qui chacune fe fubdivife en trois découpures |
moins profondes. Son calice deyiçnt une baie j
qui renferme piufieurs graines. 1
D y s
Efpèce.
i . Dysode fàfciculé.
Dyfoda fafciculata. Lotir. De la Chine Sc
de la Cochinçhine.
Ç ’ e f t un arbrjfleau qui s’élève à deux pieds, & fe
divil'e en rameaux qui montent dans une direction
verticale, fes feuilles font nombreufes,,. ovale
s, entières ; lès fleurs font blanches , dilpofées
en paquets denfes aux extrémités des branches;
ils naiftent quelquefois latîéralement.
Culture. Loureiro ne dit rien fur la culture de
cet Arbufte, mais par l’ufgge auquel on l’emploie
, il eft ppéfumable qu’il eft très-vivace , &
par epnféquent qu’il exigeroit peu de foins.
UJage. Loureiro dit qup les Chinois & les
Cochinchinois emploient ce.t Arbufle pour border
les compàriiniens de leurs Jardins v comme nous
le faifons avegfle buis. 11 eft fingulier que les Chinois
4- lesf.EuropJens aient chpifi tous les,;,deux
des Ar b liftes,- dont fljedeur eft défagréabfe , car
Loureiro le dit du Dyfode, pour les employer
au même ulage. f L.-Re yn ir r . )
DYSSENTERJE. Rougipr- Labergerie, dans
ion^traité d'Agriculture pratique, donne ce nom
à unp maladie, dit ;$eigle ,vponnue auffi 1bus le
nom de maladie rouge, qui efl très-commune,
fur-tout depuis.quelques années, dans le-département
de là Creufe & autres circouvoiïins.
ù Lorfqu’il furvient, ^ j’emprunte.les expref-
fi.ons 'de cet Agriculteur ) des brouillards ou
pluies à. l'époque'. de la Jlorâifon, des Seigles a
elle ne^peiit .s’eiFeCluer , la Nature fait de vains
efforts ; la fleur refte dans,la M ie , elle s’y al-
tère.,aye.ç le-temps & donne à la partie qui n’a
p.u fleurir pnè tpinte rouge pâle ^ d’ofi eft venu
fon nom. Quelquefois les vents -émpèchent la
fécondation en -riirrqfdiflàn t les étamines attachées
aux légers fiiamçns qui ics .fufpendenr. n
Rougier - Labergerie a pris,tous les foins pof-
fihles popr çonn.ôîtrp la caufe & les. effets de
cette inaladie^fli a examiné, dit-il, plus de deux
cefits. pièces, dé terrée , a ouvert par-tout des.
épis , §l a trouvé tfans rous ceux qui ;étoient
cplcr^s en rouge j des, fleurs avortées,, altèré.es
dansflèurfubftançe, quoiqu’elles euflént confervé
leurs formes. Il a vu auifi des épis où quelques
grains feulement a voient été fécondé?.,. & qui
n’avoient cependant pas la teinte rouge. Enfin
il s’.eft affuré qup cette.teinte , lùr une partie de
l’épi, ne npifoit pas au r e f i e , & que la partie
non-cplbréè droit égalenjent faine.,
Rougier . Labergerie préfurpe que cette malar-
die çloîr fa naiftance dans ces département aux
vents d’Eft ^ Nord-Eft , qui tombent fur les
champs-j après avoir traverfé ips monjtagnes du
la ci-flpyant Auvergne ? qui font couvertes de
neige à cette, époque. Ces vents dontfla fipidr.re
efi augmentée par l’f pontaél fies frimais des.,
D t :E
nroBfagnes , eontrade fubitement les végétaux
développés dans les pentes Méridionales" , &
détruit leur organifarion. En e ffe t, il a ,remarqué
que les feigles adoffés aux pentes Méridionales
d:s .monjàgnes , ■ où ’cétïe’ mit?® leur fei.t
d'abri, font moins.fnjérs à la Dbfùnté'nè que leb
feigles. plus' éloignés. lions’ U.:f;p'ic\pro-'
pofe, conrmc moyen curatif, le réiabnifemcm des
bois iur 'Ie.< fommités qui'.dominent les champs
bois, dont la deffruélion incônltdéréé'^ëpuis que
J abus dit ch uifage que le luxe - a eonfabre d'ins
lé3. villes, -atécha'uilé.la cupidité des proprietaires
trop é'goîttes polir;, faertfier . des jôuiffarices
prématurées Sttimparfaitéssà celles qué'letir pro-
mettoit la maturation de leurs propriétés. ( L.
R e y n ie r . )/ • A'- ^ ‘‘ '
DZENELLÏE. Nom fifiguîier que l’on dcnne
dans le pays d’enhaut canton de Berne, à la
Clavaire corailoicle : ce mot dans ce diale de
fignifie Poule , quels rapports entre ces' deux
êtres . Voyei Cl a v à ir 'e * ( L, Reynier. )
DZENOILLETTA. Notri que l’on donne dan-s
la Suifle Françaife à laBalfamine dès Bois. Voyez
Balsamine; ( L. R eynier.. ) '
E
EAU. C eft aux ebimiftes à développer la nature
cïe l’Eau ; c’eft à eux à Lire voir qu’elle
n eft point , comme on l’a cru , tin élément
fimp.e; homogène , inlécompofable, mais qu elle
eft formée de deux fùbftances, qu’on peut fé-
parer & réunir. Il eft du reftbrt du phylicien
oe profeftîon d’expliquer les qualités fenfibles
de J Eau., telles que fa pefanteur, Ion élafticifé ,
fa cliiurabiliré, fa compreftibilité &e. L'agriculteur
Ue doit 1 envifager que fous les? rapports qu’elle
v, ^es befoins perfonnels, avec ceuxde fes
beftiaux & de tous les végétaux qui l’intéreffent.
^Dans le pays ou il ne croît ni vigne , ni pommiers
& où l’orge eft rare,, les cultivateurs pri-
vés de vin, de cidre & de bierre, font obligés
de boire, de l’Eau. Il eft donc bien utile pour
leur famé qu elle foit bonne. On rie prouve pas
partout de la benne Eau ; il faut quelquefois-
la, 1er chercher loin I ou la tirer d’une grande
profondeur.
Je vais indiquer brièvement les qualités de la
bonne Eau, & les moyens de corriger la mauvaife.
On doit éviter.l’Eau qui a une éoüîeur obf-
edre, tenant du jaune*Ou d’u fôùgé'; Cette cou-
leur fe rencontre dans les Eaux fiagnaritès.'La
couleur bleue & la coulèur verre indiquent
lune la préfence du Cuivre, & t’autrecelle du
*e r‘> * Eau bleue fur tout eft tfès-dangéreufè.
La légèreté de •l?Êau eft une des qualités de-
hr^res ; mais quelquefois cette qualité feule ne
r P v o i t des Eaux ftagnantes,
^lus légères que des Eaux de puits, $1 la lége- i
E À XJ
reté eft unie à la limpidité, elle eft un excellent
indice de la pureté de l ’Eau. On a dans
beaucoup de puirs maintenant des aréomètres ou
pefe-hqueurs, infiniment de verre, fur lefqutls
efl une, c:hc 1 lp graduéê.^. En comparant â l’aide
l’Çaji qu’on veut çonnoître-
avec 1 Eau ( ifhlié^ la plus .légère, -dg toures ^
on s aÇure de ion véruafile degré die pefanteur.
Je ne propofe^ ce moyen que pour les pays oui 1 on a la facilité de l’employer.
Chacun peut faire les obfer.varions fuivantes:-
La bonne Eau, vérfëe par inciinaifon après-
avoir bouillie,, ne Iaiffe aucun dépôt. Elle cuit
bien &. en ,peu de rems les légumes. Ce carac-
ryre_leul fèroit encore équivoque, parce que
des La.ux ftagnantes cuifent bien les légumes -•
mais joint à d’autres il concourt avec eux à prouver
là, bonté de l’Eau.
' . H l 1!-11 s y 'flifiom bien , môme à- froid •'*
par ooniéquem elle blanchit bien le lifigê. U n i
Lau eft bonne quand elle eft claire, fans odeur
lans laveur ; quand elle coule ‘fùr ïèvfeble 0iÿ
K j f B i ’ cluand tJif: nourrit d’ejccdlent
poiiion, quand elle „conférve 'le1' teint frais -&»
une bonne famé à ceux.-. <jp..-ei?*,yfoni: un u/àge
habituel, enfin qùajid elle paffe Kîen par lès voies-
Quand on à le malheur d’étre.tellement placé-
que 1 on ne-pij|ffqavoir | fa diqfofirion ppür les-
beioms domeftiqm, que des Eaux dé mauvaife
qualité,, il ne faut-pas négliger lés. îmoyèn s de
les,-corriger. Us dépendent de fa caufe dé cétte
mauvaife qualité de l’Eau.
Si elles font chargées d’un nfiffcipè aérien
qui tient en^ diffolution quelque ferre abfof-v
bante,, ce qu’on reeonnoir- à la quantité de bulles:
d air qiri fe dégage de l’eau quand, en l’agite ; otï-
doit la faire bouillir, la biffer refroidir, & enfui te 1 expoler à Pair dans des vafes peu profonds*-
la terre s y défpofe &.l’Eau furnageante eft bonne!
Lorfque c’eft un autre acide qui tient de la-
terre en diffolution, là féparation eti eft moins
facile«- Dans ce cas-on fait une lefîive de cendres-
gravelées ou de cendres de bois-; ori la vefife fur
l’Eau goûte à goûte ,- jufqu’à ' Ce’ qu’elle ne fe
trouble plus; i f eft alors fort aifé;de calculer ce
q uii faut de leflîve pour purifier une quantité
plus ou moins grande d’Eau , & 'de fe faire une
règle pour toujours. Gn la verfe par incMnaifon-
& , fi. on le peut-, on la filtre. C'eft ainfi qu’on
purifie l e s - dure-stelles que celles-de-beaucoup
de puits.
Les Eaux ftagnantes- s’épurent en les filtrani
-flans une efpèce de pierre fablonnèufe.
II fuffit fouvenrde faire repofer une Eau falé
& trouble &• de la p u ife r fa n s remuer le fond.
Gn peut encore jeiter du fable dans l’eau & 1 agiter enfuite ,, le fable entraîne lès ordures.
Les gens aifés lavent fe procurer dés filtres de
cotons,, d’éponges, de pierres particulières,-