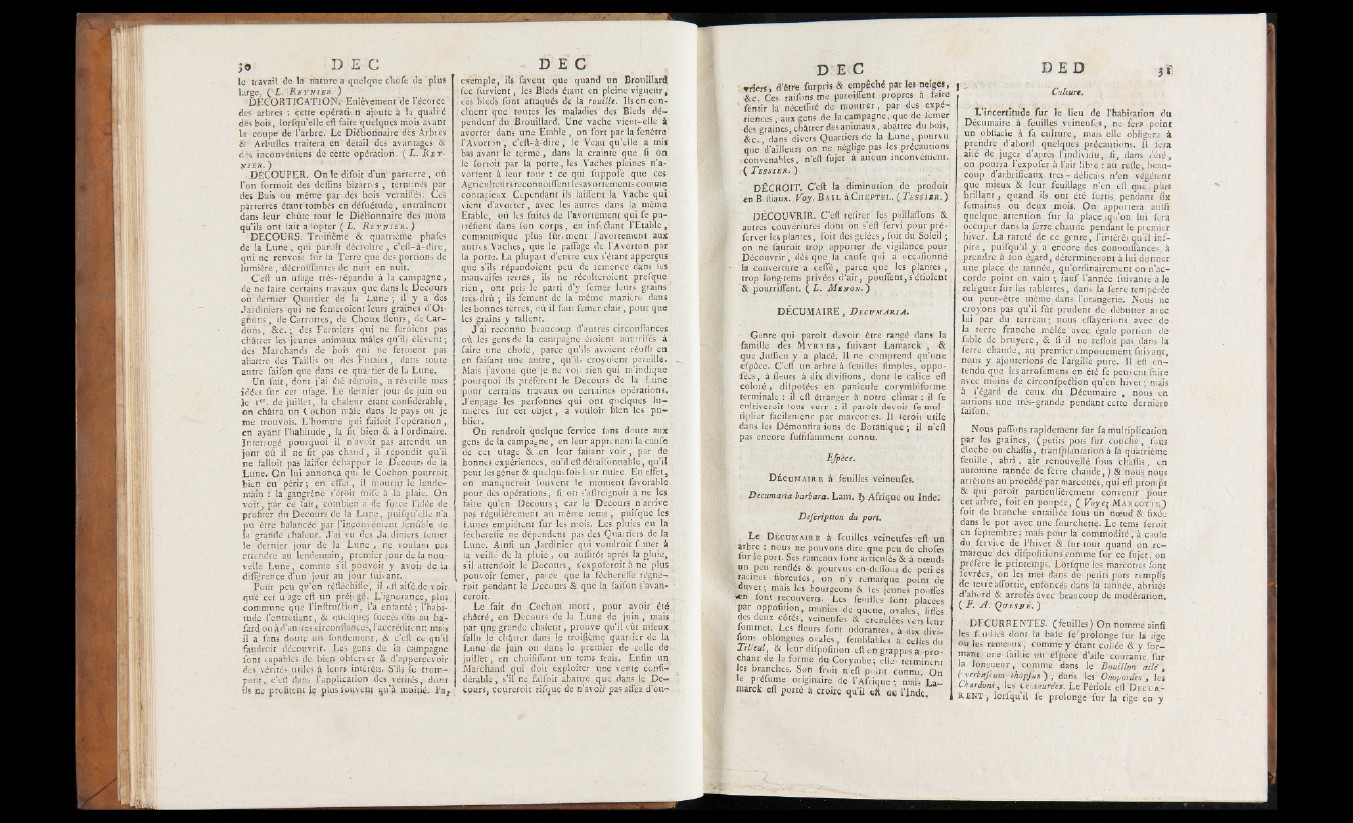
le travail de la nature a quelque çliofe de plus
large. ( X. Re ynier . )
DÉCORTICATION." Enlèvement de 1’écorCe'
des arbres ; èette opétatk n ajoute à la qualité
dfes bois, lorfqu’elle eft farte quelques mois avant
la coupe de i’àrbre. Le Diélioiinaire des Àfbtes
& Arbuftes traitera en détail dés avantages &
dés inconvéniens de cette opération. (X . R e y nier.
)
DÉCOUPER. On le difoit d’un parterre , où
l’on formoit des delïins bizarres , terminés par
des Buis ou même par des bois vetniffés.; Ce»
parterres étant tombés endéfuétude, entraînent
dans leur chûte tout le Diélionnaire des mots
qu’ils ont fait adopter ( X. Re y n ie r . )
DECOURS. Troilièmé & quatrième phafes
de la L u n e , qni paroît décroître , C’eft-à-dire,
qui ne renvoie fur la Terre que des portions de
lumière, -décroiffantes de nuit en nuit.
C ’eft un ufage très-répandu à la campagne,
de ne faire certains travaux que dans le Decours
on dernier Quartier de la Lune ; il y a des
Jardiniers qui ne femèroient leurs graines d’Oi-
gùôns, de Garrottes , de Choux fleurs, dé Cardons,
&c. ; dès Fermiers qui ne feroient pas
châtrer les jeunes animaux mâles quils élèvent ;
des Marchands de bois qui ne feroient pas
abattre des Taillis ou des Futaies, dans toute
autre faifon que dans ce quartier de la Lune.
Un fait, dont j’ai été témoin, a réveillé mes
idées fur cet iifageY Le' dernier jour de juin ou
]e Ier. de juillet, la chaleur étantçonfidérable,
on châtra un Cochon mâle dans le pays ou je
me trouvois. L ’homme qui faifoit l’opération ,
en ayant l’habitude, la fit bien & à l’ordinaire.
Interrogé pourquoi il n’a voit pas attendu un
ionr où il ne fit pas chaud, il .répondit qu’il
ne falloir pas laifter échapper le Decours de la
Lune. On lui annonça qû<- le.Çochon pourroif
bien eu périr 5 en- effet, il mourut le lendemain
: là gangrène s’étoit mile, à là plaie. On
vo it, par ce fait, "combien a de force l’idée de
profiter du Decours de la Lune, puifgu’eÜe n’a
pu être balancée, par l’inconvénient fenfible de
la grande chaleur. J ’ai vu des Jardiniers lemer
le dernier jour dè: la Lune , ne voulant pas
attendre au lendemain, premier jpur de la nouvelle
Lune, comme s’il pouvoir y avoir de la
différence d’un jour au jour fuivanr.
Pour peu qu’on rjefiéclriffe, il efl aifé.de voir
que' cet u'âge eft un préjugé- L’ignorance, plus
commune que l’inftruéHon, l’a enfanté ; l’habitude
l’entre tien ç , & quelque? fuccès.dûs au ha-
fard ou a cl1 au: res circonfiances, l’accréditent: mais
il a fans doutp un fondement, & c’elî ce qa’il
faudroit découvrir. Les gens de la campagne
font capables de bien obfèrver & d’apperçevoir
des vérités.utiles £ leurs intérêts. S’ils fe trompent,
c’eft dans l’application des vérités, dont
ils ne profitent je plusfpuyeut qu’à mpitié. Pa^
exemple, ils favent que quand un Brouillard
fec furvient, les Bleds étant en pleine vigueur,
ce? BiedS font attaqués de la rouille. Us en conc
lu ent que toutes les maladies des Bleds dépendent
du Brouillard. Une vache vient-elle à
avorter dans une Etable , on fort par la fenêtre
l’Avorton, c’eft-â-dire, le Veau qu’elle a mis
bas, avant le terme , dans la crainte que fi on
. le fortoit par la porte, les Vaches pleines n’avortent
à leur tour : ce qui fuppofe que, ces
Agriculteurs reconnoifient les avortements comme
contagieux Cependant ils lai fient la Vache qui
vient d’avorter, avec les autres dans ia même
Etable, où lés fuites de l’avortement qui fe pti-
iréfient dans fon corps, en infeélant l’Etable,
communique plus fûrement l’avortement aux
autres Vaches, que le paffage de l’Avorton par
la porte. La plupart d’entre eux s’étant apperçus
que s’ils répandoient peu de femence dans les’
mauvaifes terres, ils ne récolteroient prefque
rièn , ont pris le parti d’y feuler leurs grains
très-dru -, il? fement de la même manière dans
les bonnes terres, où il faut femer clair, pour que
les grains y tallent.
J ’ai reconnu beaucoup d’autres circonflances
où les gens de la campagne étoient autorifés à
faire une chofe, parce qu’ils avoient réufti en
en faifant une autre, qu’ils croyoient pareille.
1 Mais j’avoue que'je ne vois rien qui m’indique
' pourquoi ils préfèrent le Decours de la Lune
pour certains travaux ou certaines opérations.
J ’engage les perfonnes qui ont quelques lumières
fur cet objet, à vouloir bien les publier.
On rendroit quelque fervice fans doute aux
gens de la campagne, en leur apprenant la caufe_
de cet ulage & -en leur faifant voir, par de
bonnes expériences, ou’ileftdéraifonnable, qu’il
peut les gêner & quelquefois l .ur nuire. En effet,
on manquerait fouvent le moment favorable
pour des opérations, fi on s’aftreignoit à ne les
faire qu’tn Decours -, Car le Decours n’arrive
pas régulièrement au même teins y puifque les
Lunes empiètent fur les mois. Les-pluies ou la
féchereffe ne dépendent pas des Q liai tiers de la
Lune. Ainfi un Jardinier qui voudrait faner à
la veillé de la pluie, ou au fil rôt après la pluie,
s’il attendoit le Decours.,. s’expoferoit à ne plus
pouvoir fçmer, parce que la féchereffe régné-,
rpit pendant le Decours & que la, faifon s’avan*
ceroit.
Le fait du Cochon mort, pour avoir été
phâtré, en Decours de la Lune de juin, mais
par qnç grande chaleur, prouve qu’il eût mieux
fallu je châtrer dans le troifième quartier dé la
Lune de juin ou dans le premier de -celle de
juillet, en choififlant un teins frais. Enfin un.
Marchand qni doit exploiter une vente con.fi-
dérable,. s’il ne faifoit abattre que, dans le Dey
çpurs, çoureroit rifque de n’avpir pas afféz d’ou-
D E D
Culture.
' Tricrs, d’être furpris & empêché par les neiges,
&c. Ces raifons me paroiflent propres à . fowe
‘ femir la nécefliré de montrer, par-dos expériences
, aux gens de la campagne,,que de tenter
des. graines, châtrer des animaux, abattre dubois,
&ç. ,-dans divers Quartiers de ia faune,, pourvu
que .^’ailleurs on ne néglige pas les précautions
convenables, n’efi fujet a aucun inconvénient.
( T essier. )
DÉCROÎT. C’eft la -diminution de produit
en B ftiaux. Voy. Ba il à,C heptel. ( T essier. )
DÉCOUVRIR. C ’efl retirer les parafions &
autres couvertures dont on à’éft Tervi pour pré-:
ferver les plantes, foit des gelées, foit du Soleil ;
on ne fauroit trop apporter de vigilance pour
Découvrir, dès que la'caufe qui a ocçafionhé
la couverture a -ceffé, parce que les plantes ,
trop long-tems privées d’air, pouffent,s’étiolent
& pourriffent. ( X. M enon. )
DÉCUMAIRE, D e c v m a r i a .
Genre qui paroît devoir être rangé dans la
famille des My r t e s , fuivant L-amarck , & .
que Juffieu y a placé. H ne comprend qu’une
efpèce. C’eft un arbre à feuilles fimples, oppo-
fées,t à fleurs à dix divifions, dont 4e calice eft
coloré, difpofées en paniculè corymbiforme
terminale : il eft étranger à notre climat : il fe ■
cultiverait tous verr : il paroît devoir'fe multiplier
facilement par marcottes. Il ferait utile
dans les Démonfira ions de Botanique ; il n’eft
pas encore fuffifamment connu.
Efpèce.
Décumaire à feuilles veineufes.
Decumaria barbara. Lam. ï> Afrique ou Indei
Defcription du port.
, Le Décumaire à feuilles veineufes'eft ufi *
arbre : nous ne pouvons dire que peu de chofes :
fur le port. Ses rameaux font articulés & à noeuds !
un peu renflés & pourvus en-deflçius de petites i
racines | fibreufes, on n’y remarque point de i
tduvet; mais les bourgeons & les jeunes pouffe? 3
i*n font recouverts. Les feuilles font placées :
par oppofition, munies de queue, ovales, liffes
des deux côtés; veineufes & crénelées vers leur
l.ommet; Les fleurs font odorantes, à dix divD
fions oblongues ovales-, femblabies à; celles du
Tilleul, & leur difpofition eft en grappes a prêchant
de la forme du Corymbe; elle- terminent
les branches. Son fruit n’efl point connu. On
le préfume originaire de l’Afrique ; mah L a -
marck efl porté à croire qu’il efl ae l’Inde.
Culture,
L’incertitude fur le lieu de l'habitation du
Décumaire à feuilles veineufes, ne fera point
un obflacle à fa culture, mais elle obligera à
prendre d'abord , quelques précautions. 11 fera
ailé de juger d’après l’individu, li, dans i’éré,
pn pourra l’expofer .à l’air libre : au refie, beaucoup
d’arbrifleaux très - délicats n^n végètent
que mieux & leur feuillage n’en efl que,plus
brillant, quand :ils ont été fonis^ pendant fix
femaines ou deux mois. On apportera aulfi
quelque, attention fur .la placejqu’on lui fera
occuper dans la ferre chaude pendant le premier
hiver. La rareté de ce genre, l’intérêt qu’il inf-
p ire, puifqu’il y a encore des connoiiîances. à
prendre à fon égard, détermineront à lui donner
une place de tannée, qiyordinairement on n’ac-
. corde point en vain | fauf l ’annép fuivante à le
.reléguer.furies tablettes, dans..la ferre tempérée
ou peut-être même dâns' forangerie. Nous 11e
croyons pas qu’il fût prudent de débutter avec
lui par du terreau; nous effayerions avec de
la terre franche mêlée 'avec; égale portion de
fable de bruyère , & fi il ne reftoit pas dans la
ferre chaude , au premier t'mpotiement fuivant,
np,us y ajQiiterions de l’argilie pure. Il eft entendu
que les arrofemens en été fe peuvent faire
avec moins de circonfpeélion qu’en hiver; mais
à l’égard de ceux du Décumaire , nous en
aurions une très-grande pendant cette dernière
faifon..
Nous paflons rapidement fur fa mulripjication
par les graines', (petits” pots fur couche, fous
éloche ou chaflis, tfanfplântation à la quatrième
■ feuille, abri, air renoûvèilé fous chaftîs, en
automne tannée'de ferre chaüdê, ) & nous nous
arrêtons au procëdé par marcottes, qui eft prompt
& qui paroît particulièrement convenir pour
cet arbre, foit en poupée, ( Voye% Mar co tt e)
foit dé branché entaillée 'fous un noeud & fixée
dans le pot avec une fourchette. Le tems feroit
en feptembre: mais pour la commodité Va caufe
du, fer vive de l’hiver &.fur-tour quand on remarque
des difpofitions1,comme fur ce fujet, on
préfère le printemps. Lorfque lesjmafcônes font
lèvrées, on les met d'ans de petits.pots remplis
de teueaflbrtie, enfoncés dans là tannée, abrités
d’abord & arrofés avec beaucoup de modération.
( F. A . Qu ESN é. )
, DECURRENTES. (feuilles) On nomme ainfi
les fcuilleà dont la bafe fe’ prôlongé lur la ti^e
c»u les rameaux , comme y' étant coîiée & y formant
une faillie ou efpèce d’aile courante fur
la longueur , comme dans Iç Bouillon a ilé ,
( verbajeum thàpjus ) , dans les Onopordes , les
Chardons;*les’ Centaurées. Le Pétiole eft D ecur-
RENT , lorfquil fe prolonge fur la tige en y