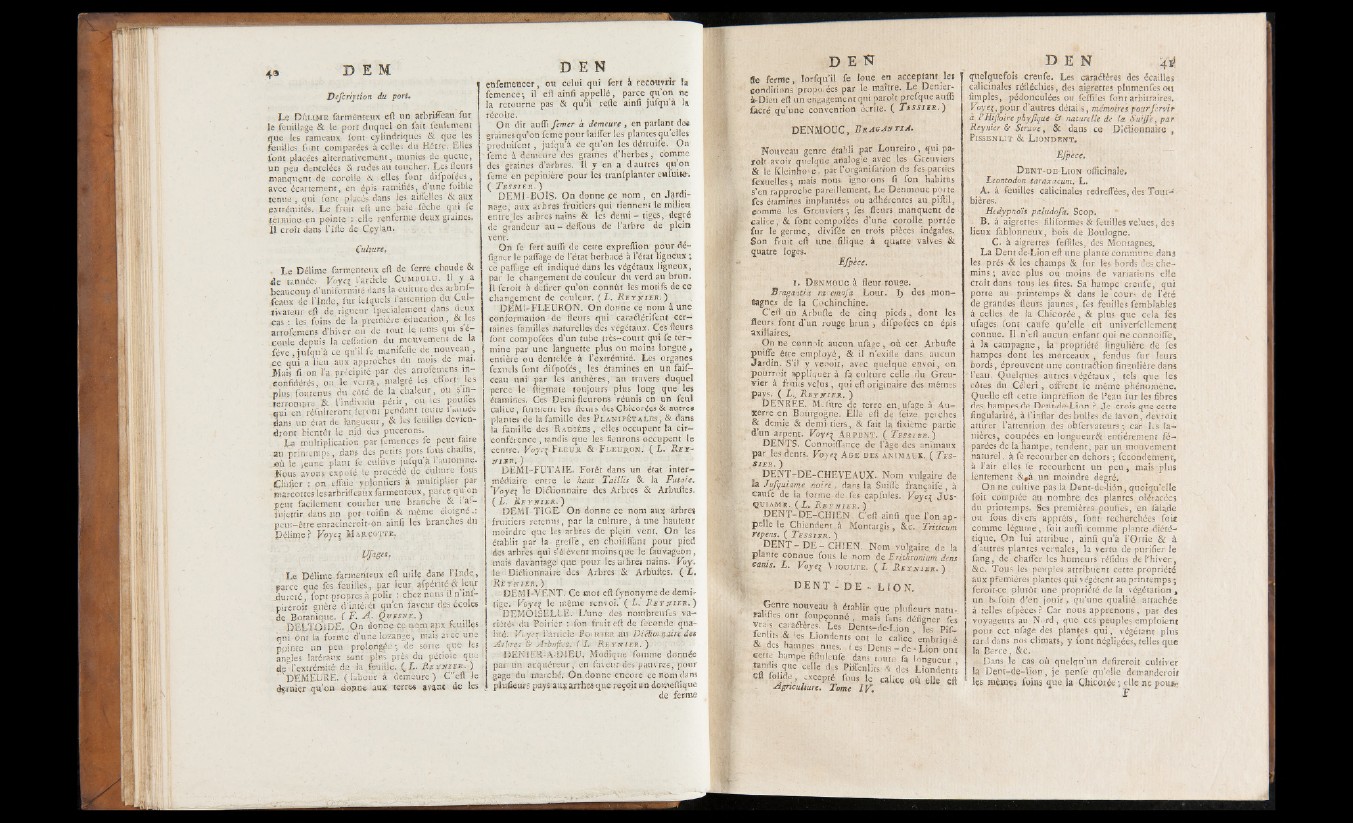
.4®
D E M
JDefcription du port•
Le Délime farmdtrtejtx eft un arbriffeau fur
le feuillage & le porc duquel on fait feulement
que les rameaux font cylindriques & que les
feuilles font comparées à, celles du Hêtre. Elles
font placées .alternativement, munies de queue,
un peu dentelées & rudes au toucher. Les Heurs
manquent de corolle & -elles font difpofées,
avec écartement, en épis ramifiés, d’une foible
tenue , qui font placés dans les aifîelles & aux
extrémités. Le fruit eft une Laie fèche qui fe
fér,mine>en pointe : elle renferme deux graines.
Il croît dan? i’ifte de Cçylan.
Culture,
, L e Délime farmçnteux eft de ferre chaude &
«le tannée. Voyez l’article C umbdlu. 11 y a
beaucoup d’uniformité dans la culture des arbril-
feaux de l’Inde, fur iefquels l’attention du Cultivateur
eft de, rigueur fpécialement dans deux
cas : les foins de la première éducation, & les
arrofemens d’hiver ou de tout le cents qui s é - .
coule depuis la cefiation du mouvement de la
fève , jufqu’à ce qu’il fe manifefte de nouveau ,
ce qui a lieu aux approches du mois de mai.
Mais fi on l'a précipité par des arrofemens în-
confidérés, on le verra., nialgré les efioiT,les
plus fourenus du côté de la chaleur , ou- J interrompre
& l’individu périr, ou-les poulies '
qui en réfulreronr feront pendant toute 1 année
dans un état de langueur , & les feuilles deviendront
bientôt le nid des pucerons. .
La multiplication par femences fe peut faire
au printemps, dans des petits pots fous chaiüs,
joù le jeun,e plam fe cultive jufqu à 1 automne*
Nous avons, expofé, le procédé eje-, cplture lotis
(Eluder ; on eflaie volontiers à multiplier par
marcottes les arbrifteaux farmenteux, parce qu; on
peut facilement courber une branche & ia>-
fujettir daus un pot voifin & même éloigné
peut-être enracirieroit-on ainfi les branches du
P élfi'qe f V?ycl M a r ç o t t e .
Le Délime-farmenteux eft utile dans l’Inde,
parce que (es feuilles’, par leur afpérké^feur
.dureté, font propres à polir : chez nous il n inf-
pireroit guère' d’imétét qu’en faveur dps écoles
de Botanique. ( F. A . Q vesné. ) _
DELTOÏ DE. On donne çç mrn aux feuilles
qui ont la forme d’une lozangë, mais avec une
ppinte un peu prolongée -, de sorte qlJe 1&S
angles latéraux sont pins près du pétiole que
àç l’extrémité- de la feuille. £X- R e y n ie r . )
DEMEURE, (labour à demeure ) C” eft le
dernier qu’on douane aux terres avant de les
D E N
enfemencer, ou celui qui fept à recouvrir la
femence-, il eft ainfi ajppellé, parce qu’on ne
la retourne pas & qu’il refte ainfi jufqu à U
récolté.
On dit auift fewer a demeure, en parlant de«
graines qu’on feine pour laifler les plantes <ju elles
produifent, jufqu’à ce qu’on les détruife. On
feme à demeure des graines d’herbes, cbmine
des graines d’arbres. Il y en a d'autres qu’on
feme en pépinière pour les tranfplanter eufuiie-.
( T essier. )
DEMI-BOIS. On donne jçe nom, en Jardinage,
aux arbres fruitiers qui tiennent le milieu
entrejes arbres nains & les demi - tige's, degré
de grandeur au - deffous de l’arbre de plein
vèm.
On fe fert auflî de cette exprefiion pour dé-
figner le partage de l’état herbacé à l’état Kgnéux ;
ce partage eft indiqué dans les végétaux ligneux,
par le changement de couleur du verd au brun.
Il feroit à defirer qu’on connût les motifs de ce
changement de couleur. ( L. R e y n ie r .)
DEM1-FLEURQN. On donne ce nom à une
conformation de fleurs qui câraélçrifent certaines
familles naturelles des végétaux. Ces fleurs
font compofées d’un tube .très-court qui fe termine
par une languette plus ou moins longue,
entière ou dentelée à l’extrémité. Les organes
fexuels font difpofés, les étamines en un faif-
| ceau iiai par les anthères , au travers duquel
perce Le ftigmate toujours pins long qiie les
étamines. Ces Demi-fleurons réunis en un feul
calice, forment les fleurs des Chicorées & autre«
plantes de la famille des Planipétales, & dans
la famille des Radiées./ elles occupent la circonférence
, tandis que les fleurons occupent le
centre. Voyc^Fleur & F leuron. (X . Re y n
ie r » ) v .
DEMI-FUTAIE. Forêt dans un état intermédiaire
entre le haut Taillis & la Futaie.
9Voyez îè Dictionnaire des Arbres & Arbuftes.
( i . Re y n ie r .)
DÉMÏ-TIGÊ On donne ce nom aux arbres
fruitiers retenus, par la culture, à une hauteur
moindre que les arbres de plein venr. On les
établit par la greffe, en choififfant pour pied
des arbres qui s’élèvent moins que le fauvageon,
mais davantage; que pour les arbres nains. Voy.
le ' Dictionnaire des Arbres & Arbuftes. (X .
R e y n ie r .')]
DEMI-VENT. Ce mot eft fynonyme de demi-
tige. Voyez le même renvoi; (X . R e y n ie r .)
^DEMOISELLE. L’une des nombreufes variétés!
du Poirier ; Ton fruit' eft de féconde qua-
• lité: ' Fiÿè%> Rarticle Poi RiÈR au D iâiouiaire des
A,ilires'& Arbuftes.~ (‘-L R eyw 1er. )
DENI ER-A-DIEU. Modique fomme donnée
par' un acquéreur:/ en •faveur des pauvres, pour
gage du .'marché; On donne encore ce nom dans
plufkurs pays aux arrhes qiie reçoit un domeflique
de ferme
D E M
fîe ferme, lorfqu’il fe loue en acceptant les
conditions propo/ées par le maître. Le Denier-
à-Dieu eft un engagement qui paroît prelque auili
Ûcré qu’une convention écrite. ( T e s s ier .)
DENMOUC, B ragJn t iA.
Nouveau genre établi par Loureiro, qui pa-
ffblt avoir quelque analogue avec les Greuviers
& le Kleinhove. par l’qrganifawon ds fes parties
fexuelles ^ mais nous ignor ons fi fon habitas
s’en rapproche pareillement, Le Denmouc porte
fes étamines implantées, ou adhérentes au piftil,
comme les Greuviers ; fes fleurs manquent de
calice/ & fqnt compofées d’une corolle portée
fur Le germe, divifée en trois pièces inégales.
Son fruit eft une fiiique à quatre valves &
quatre loges.
EJpèce.
i . Denmouc à fleur rouge.
Bragantia raremofa Lour. ï> des mon-
Éagne.j de la Cochinchine.
C’efl un Arbufte de cinq pieds | dont les
%urs font d’un rouge brun, difpofées en épis
axillaires.
On ne connaît aucun ufage, où cet Arbufte
puifle être employé, & il n’exifte dans aucun
Jardin. S’il y veooit, avec quelque envoi, on
poùrroir appliquer à fa culture celle du Greu-
vier à fruits velus , qui eft originaire des mêmes
pays. ( L.r Re y n ie r . )
DENREE. Me (cire de terre en_ ufage à Auxerre
en Bourgogne. Elle eft de ïeize peiches
& demie & demi-tiers,. & fait la fixième partie
d’un arpent. Voye'CA r pen t . ( Tessier.)
DENTS. ConnoifTarce de l’âge des animaux
par les dents. Voyez A ge des animaux. ( Tess
ie r . )
DENT-DE-CHEVEAUX. Nom vulgaire de
la Jufquiame noire , dans la Suiflè francàifë, à
caufe de la forme de. fes capfules. Voye[ Jus-
QUiam e. ( L. R e y n ie r . )
DENT-DE-CHIEN. C’eft ainfi que l’on appelle
le Chiendent à Montargis, &c. [Trkieum
repens. ( T essier. )
DENT - DE - CHIEN, Nom vulgaire de la
plante connue fous le nom de Erithromüm dais
cams. X. Voyei Vioulte. ( L Re y n ie r . )
Genre nouveau à établir que plnfieurs nati
ratifies ont foupçonné , mais fans défigner f
vra-s caraflères. Les DemsT<de-Lion , les Pit
I , f , ies Ltondents ont le calice embria.
& des hampes nues. /-es Den ts-d e -L ion 01
sette hampe fifiuleufe dans toute fa longueur
’ « " rV T 16 Cele dts fiffenlits .S; des Lionden
™ Ip“ de. t fous le calice où elle e
Agriculture. Tome IV»
D E N
quelquefois creufe. Les caractères des écailles
calicinales réfléchies, des aigrettes plumeufes ou
Amples, pédonculées ou fefîües font arbitraires.
Voye\} pour d’autres détails, mémoires pourfervir
à l’Hiftoire phyfîque & naturelle de la S u f f i, par
Reynier & Struvc, & dans ce Dlélionnaire ,
Pissenlit & L iondent.
Efpèce.
Den t-de-Lion officinale.
Leontodon taraxacum. L.
# A. à feuilles calicinales redreffées, des Tourbières.
Hedypnois paludofa. Scop.
B. â aigrettes filiformes & feuilles velues, des
lieux fablonneux, bois de Boulogne.
C. à aigrettes fertiles, des Montagnes.
La Dent de-Lion ert une plante commune dans
les prés & les champs & fur les bords des chemins
; avec plus ou moins de variations elle
croît dans tous les fîtes. Sa hampe creufe, qui
porte au printemps & dans le cours de l’été
de grandes fleurs jaunes, fes feuilles femblables
à celles de la Chicorée, & plus que cela fes
ufagës font caufe qu’elle eft univerfellement
connue. Il n’eft aucun enfant qui ne connoifle,
à la campagne, la propriété finguliére de fes
hampes dont les morceaux , fendus fur leurs
bords, éprouvent une contraction finguliére dans
T’eau. Quelques autres végétaux, tels que les
côtes du Céleri , offrent le même phénomène.
Quelle eft cette impreffion de l’eau fur les fibres
des. hampes de Dent-de-Lion ? Je crois que cette
Angularité, à l’inftar des bulles de favon, devroit
attirer l’attention des obfervateurs ; car JcS lanières,
coupées en longueur& entièrement fé -
parées de la hampe, tendent, par un mouvement
naturel, à fe recourber en dehors ; fecondemenr,
à l’air elles fe recourbent un peu, mais plus
. lentement &#à un moindre degré.
On ne cultive pas la Dent-de-liôn, quoiqu’elle
foit comprée au nombre des plantes oléracées
du printemps. Ses premières poulies, en fala.de
ou fous divers apprêts, font recherchées fok
comme légume, foit aurti tomme plante diététique.
On lui attribue , ainfi qu’à l’Ortie & à
d’autres plantes vernales, la vertu de purifier le
fang, de chafier les humeurs' réfidus de T’hiver,
&c. Tous,les peuples attribuent cette propriété
aux premières plantes qui végètent au printemps ;
feroit-ce plutôt une propriété de la végétation ,
un byfoiïi d’en jouir, qu’une qualité attachée
à telles efpèces ? Car nous apprenons, par des
voyageurs au N.»rd, que ces peuples emploient
pour- cet ufage des plantes q u i, végétant plus
tard dans nos çlimats, y font négligées, telles que
la Bercç, &c.
^Dans le cas où quelqu’un defireroit cultiver
la Dent-de-lion, je penfe qu’elle demanderoit
les mêmes foins que. la Cfiicoiée *, elle ne poujfe