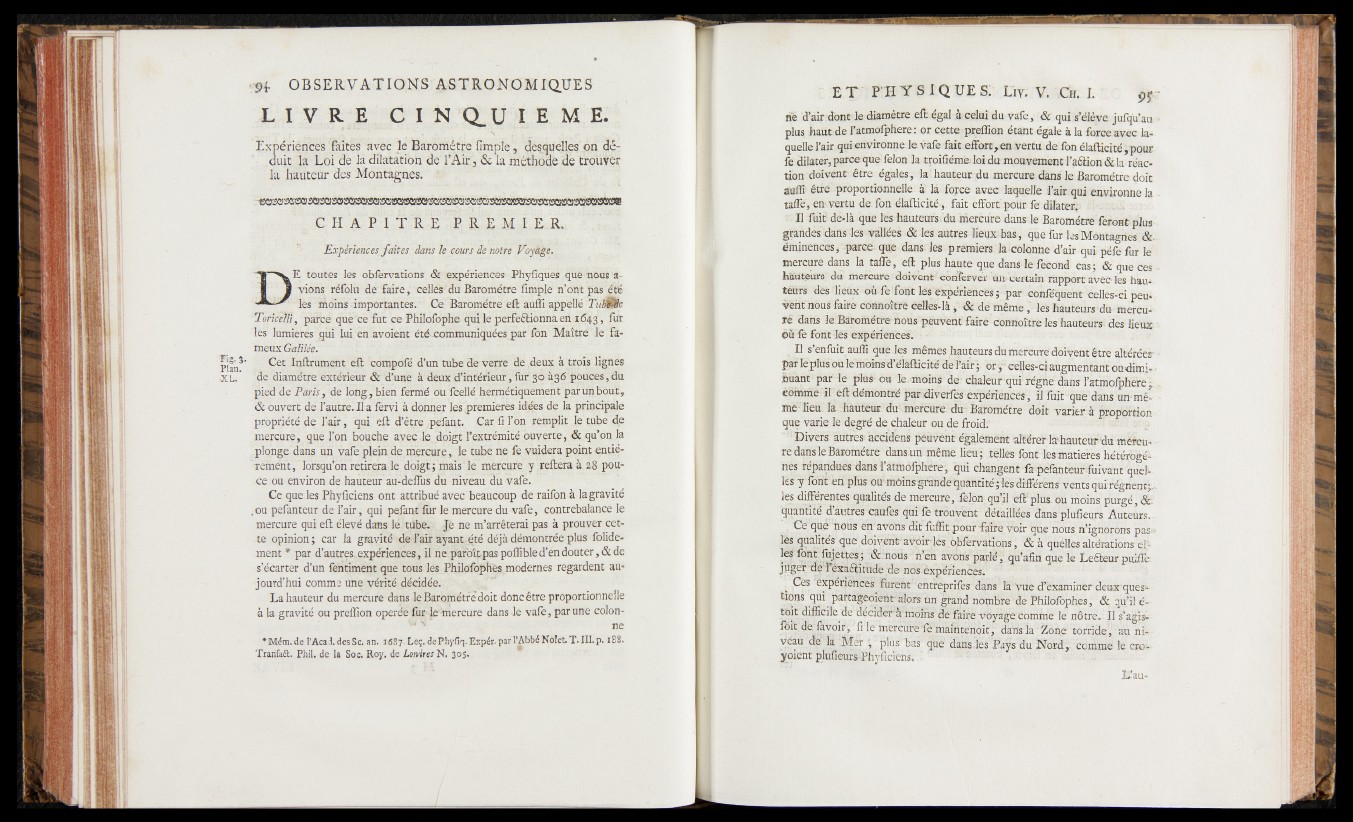
m O B S E R V A T I O N S A S T R O N O H IQ.ÜES
L I V R E C I N Q_ U I E M E.
Expériénèès'Mtês kviêè le BarôniéCrefîmple, desquelles pii çlë-
' . duit la Loi de la dilatation déTÂir jj & la métîiodè 'de trouver
la Ifluteûr ‘des Montagnes. *
G H A P 1 t R E JP; R | M I . i , R»
lïspêrtencQfiâtes dans le jours Je notre Voyage.
DE toutes les obfèrvations; & eag>ériençes Phyfiqùes qifé îious a"
vidhV réfblu de faire, celles- du Baromètre fimplé'n’on't pas !éiié
dès ïnoinsimportantes. Ce Barométré, eft aûfli appehé Taille
V o f ^ ë j t , palpé' que'ce fût ce Philofophe qui le peidfe&ôîinaeni.d4!53 |Ur
lès lumïêres qui lui en avoient été communiquées .par fon Maître le fa-
vaexsxGalilée. ■'
Cet Infiniment d l compofé d’un tube de Vérre derdeu$ à trois lignes
dè^iaiiï&ffemtàîeur & d'une à deux d’inténeuf;, füf 36 à^poùcés ,du
pied de ^ m , de long , bien fermé -
& ôuVertffe.Tautrelll a fërvi à donner lesprëmieres idées delà principale
propriété de Tair, qui eft S’êtte pef^nt. Car fi Ton remplit le tube~de
mercure, que Ton bouche ayéç ,le.doigt l’extrëmité opyerte, & qu’on la
plonge dan? un vafe plein de mercure , le tube ne fe vuidera point
’-reméht, lorsqu on reçireja le doigt; mais1!© mercure y reliera à,ü8 -pouce
ou environ de hauteur au-deiîus du niveau duvale. :
. Ce que les Phyficiens ont attribué avec beaucoup de taifon à la gravité
;ou pefànteur de l’air, qui pefanTfur le mercure du-vafe, contrebalance le
mercure qui eft élevé dass lé. tübe. ne m’arrêterai pas à prouver cette
opinion ; car la gB^y/të* défait ayantj^té déjà démontrée plus folide-
ment * par d’autres.expériencès, il heipâroîppas poflible d’en douter, & de
s’écarter d’un fehtimënt que tous les Philofuph^^modèrnes regardent aujourd’hui
comme Une vérité décidée.
La hauteur du mercure dans JeBarqmétredoit donc être proportionnelle
à la gravité ou prefllon operéfèiùr-iéraercure dans 4e vafe, parunê .cèfdh*
ne
de i’Acad. desSc. an. i<587-Leç, dePhyfiq. Expér. par l’Abbé Nolet. T. III. p. 188.
Tranfaft. Phil. de la Soc. Roy. de Londres N. 305.
E T F H Y S XQ UE f f L it. V . C h . I. p y
hé dWrdantde diamètre eft-égaHucélui du Ÿ*fe, & qui s’élèye..jufqu’ait
plus haut: de l’atmofpKere: or cette preflion étant égale à la force avec laquelle
l’air .qui environne la vafe; fait effort, en vertu de Ton élafticité i pour
fë dilater, parcequé félon la troiâémbMdu'mouveiiientfgéèion Si-h réaction
doivent- être. égalps, la! liauteurdu.mercure: dans le Baromètre doit
suffi être--proportionnelle, a la force avec laquelle l’air qui environne la
talTé, en'vertu dqffôi''elafficitéi. fait effort potirfg dilate# 1
*8 II lîü&dàlà que lés hauteufsvffu-metêufe dans le Baromètre feront plus
gfandêsdansildfe ivàllées -&4es: aütres liéux:bas, q§e ïuf- les Môntagùes &,
eminences, -parce- que dans- les premiers la^colonne d’air quipéfe hir le
mercure dans la tafle,' eft plus haute’que dans leTeéond cas; & que Ces-
hlüteûrs du- mefcum .àoivènè'' cén&rvér hiv certain l'apport àvèéM haut
e s des -ffiëux où fe font ]èS?fâ£péÉèhcës ; par confëquettt celles-éi peu*
veht heuS'faire conabîtrê déHes-là f
éù fe FéhtrK's 'êMljëffenÈ^ ; : -
Il s’enfuit auffi que les mêmes hauteurs du mercurë doivent être altérées*
par rëp^séu îëmÉânad?2ïàfficitë de l’air br^ caiès-cj augiUentantoUdimb -
éuànt par1 le plus- à» îe..<moins dé? chateuf ;qùrrégtië- dans l’atmolphere ^
eëmme: il ! éft démontre par Siverïes■ e'Xpéüènce's, il Tuff -que dans ummê»
më-’Iîeu. la hàufeur.. du-*ïer cure, dm ! Biifométre doit varier à proportion
que varie lé’degré de chaleur ou Se froid-f
" •* divers autres*- accident pèuvént ëgâlémëht altérerdaehauteurdu niéifcu-
ré dans le Baromètre dans-Uh même KëÛ1;' JteHes font -lesmatieres hëtér?%él
nés répandues dansTatmdfphere, qui changentTa-pefanteurfuivanti queb
lés’y'fdm'èii pfus oir moins ^ndetpiahfiGéj'lès dffférksfJverits qurr<%né^
les différentes qualités de mercure, ièlpn qifi'l eft plus,où moins purgé, &;
quantité âéXïtres ca'ufes'qür'îfe'twuyént' dëtaiii&s dâns plufîeurs Àùteûfs.-
"SSS^iit’rgÈSrSïte pSà»
3^|^l&'?PiaBtlonrei
à’ëli ™ ' ^ ? |Ü ’aÈn que le Lëfîfeur-puSîe:
Jde nof:ëxp'l^enoesl~ f
1 'Xhrent^éhtrèprhès7âaiîfei làiYttè d’êxamirrerdeaExTquesi--
tïops qui partàgeiïèht^êlprs ’ùrf ^'nd'hômbŸé Së PhilBfëpHesSc qu’il é--
lé* iiStrè-'-IÎ S^agisî--
cK{jlvfP^r ’ ^ l^p1®|l^®^fëiihàfritén(^it'f dàlîs la ZoU.e' côrride*, ' aU ni- -
H ' * HâLàiféâ du îtfofJ^'Cbnîfeé luesaL
.ÿdient plnfieurs'Phyficiëns.. • '
Mau