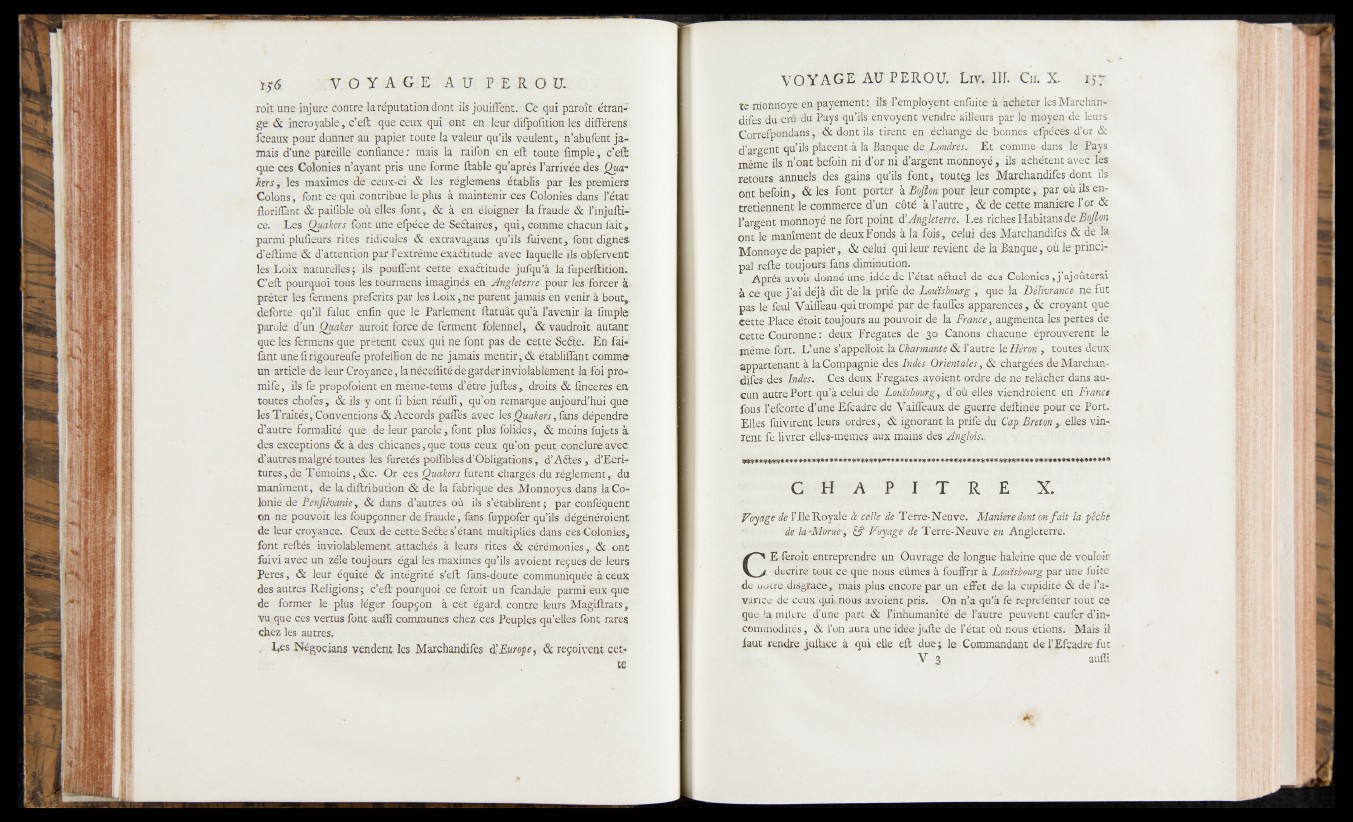
Ï$6 V. O y A G E A ü; P E l O XJ.
roit une injure contre la réputation dont,ils joUiffçht.rGè qui par'oît étrange
& incroyable, c’qft que ceux qui ont.eïuleur-dHpofition-fâ différens-
fceaux pour donner au papier toute la valeur qu’ils veulent; tfabufent jamais
d’une pareille confiance : mais la raifon en eflf toute fimple.; c’efli
que ces.Colonies n’ayant pris une forme ftablp qu’àjûès 1’amvée des Quakers
t les maximes de ceux-ci & les réglemens établis par les premiers
Colons, font cequLcontribueleplus à maintenir ces Colonies dans: 1’,état
flofiflànt & paifibje ou elles font, & à en éloigner la .fraude '& l’injufti-
ce. Les Quakers font une efpéce de Seftaires'; qui* comme chacun faitjÿ
parmi plufieiirs rites ridicules & extravagans qu’ils fui vent, font dignes,
d’eftime & d’attention par l’extrême exa&itude avec laquelle ils obfervept
les.Loix naturelles; ils pouffent.cette, exaéhitude jufqù’à la fuperftition.
C’eft pourquoi tous les-tourmens imaginés cn> Angleterre pour les .fofcer â.'
prêter les fermens prefcrits par les Loix^në purent jamais en' venir: à bout*.,
delorte qu’il falut enfin que lé Parlement ftatuât jp’à Javeair la fitnjfé
parole d’un Quaker auroit force de ferment folennel, &--vaudroit autant
que les fermens que prêtent ceux qui ne font pas de cotte 'Se®e. -pn fai-'
fant une fi rigoureufe prof effion donc jamais mentir, & é.tab,lifl|nt comme
un articferde leur Croyance, la né.ceffité de garder inviplabiement fa*fei:pro-
mife, ils fe propofoient en même-tems; d’être' juftes , droits. & finger.es en
toutes chofesÿ .& ils y ont fi bien réujBi, qu’on remarque aujourd’hui que
les Traités,.Conventions & Aceords pafles ;&ÿe.c; les;Quakçm ,fânsJdépendre;
d’autre formalité, que de leur parole , font plus fofides, & moins: fùjgts, à
des exceptions .& à des| chicanes, que tous ceux qu’on peut conclureavec
d’autresmalgré toutes les furetés poffibles d’Obligations',' d’Aêtes, d’Ecri-
tures , de Témoins, &c. Or. ces. Quakers furent chargés du réglement, du
manîment, de la diftribution & d£ lu fabrique des. Monnoÿes dans la Cé-
famé de P.enjîlvanie, & dans d’autres où: ils s'établirent; pat conféqueht
©une pouvoit lesfoupçonnerde fraude, fans, fuppofer qu’ils dégénjsrqient
de leur croyance.. Ceux de cette Seéte s’étant multipliés dans cés-Colonies,
font reftés inviolahlement attachés à-leurs rites & cérémonies,. & ont
fuivi avec un zélé toujours égal les maximes qu’ils avoient reçues de leurs
Peres, & leur équité & intégrité s’eft fans-doute communiquée à ceux
des.autres Religions; c’efe pourquoi ce feroit un fcandale parmvfeux-que
de former le plus léger foupçon à'cet égard; contre leurs Magiffcrats;
vu que ces vertus font aufiî communes chez, ces Peuples qu’elles-font rares
chez les autres
. Tes Négocians vendent les Maxchàndifes d’Europe, & reçoivent cet?
te
VO.YAGiE AIT PEROU;: Liv,:. Ilî. Ciï. X. 157
te nfoâs’sp i^ l^ y S S 1^ 5 SflSfj :r^mp^gfaÉi aifUitehàï'achéte» les-Marchan^
difeVdi&CP^i$ Bays envoyent-vendre ailleurs par le dfoyen de leurs'
Correfpondansj.i i&. 'd^t-jls .tirent ,en,iéçhange de ^bonnes efpécds.d’orjSt.
d’argent .qu’ils placent à"la Banqiie às^JUrndr-es*. Et comme-dans {le,'Pays
même ils n’o*t befoiii ni d’or ni d’.argènt monnoyé , ils., achètent avec lés
retours annuels dgs -gains. qu’fis fqpt; toutej les Marchandifes dpnt ils ,
ont befoin, & Ips font^porter à 'jBojion pour leur compte , par où ils en-
®êtienieniï’le»cçprnmerce; d’un iCÔté, à l’autrp, & dé cette maniéré l’or &
l’açgAp! ^ mwtinyfi ne fort point à’Angleterm. Les. riches HabitansdO^f^?
ontfiê^manjment de, deux Fonds àja, fois, celui des Marchandifes & de la
Monnoye de papier „> & celui quiïleuf.revieht de la Banque, où le princi-,
pal refteefSÙjoursfens dimjndtipnb'in»* a , -v. \\ i-
„ 'Après avoi^d^nnéune .iqégde- rétat^êfaieLde ces .Colonies, j ’ajoûterai,
k ce-que, jj.ai'déjà djt de k prjfe d^Louisbouxg \ que ,1a, Délivrance, ne. fut
pas le f^jjYaiffqau qui3trpmgé-par de fauflès^appargncds, & croyant qué;
eette,Place,mfoit toujours ;au pouvoir^de,- la, France, augmenta les pertes dé-
^ife.,.3? .Canons chacune épronveren^de
mêmefortTiCù^&kj^lloit,la Charmante &.T|ptre;lé^ff^R>: d e ^
appartenant à laCompagnip des l^ÉJ .Orie^feij:;&■ chargées de Marchan-
^ifes desY«^.; ^{Ces^ux .Ifreg^tés -ayoîent. Oi'drc de, ne relâcher, dans au-,
cun autrePo^qu’Tceln^ékii^jÀow^;, d’oùfglles viendroient en France,
fai^^^rtt^|ùngÆ|^e|,4 ^yaiffeaoX(de guerre deftinée pour^ce. Port,
piles, fui'yirent leurs^0Edre&.«& ignorant la prife dp Cap Breton y elles vinrent
fitfiyxer .elles-mqmgi aux mains^des^g/sf^.
»^»»ÿ*^«»«»»»»»******»*»»^»«-»»»*«**»*************»****»******** ****♦ *-► »*♦ ♦ ****♦ •
C H A P I T R E X.
Voyage de -FIlè R‘6yâle'd: celle dé TêfrB-'NeuVe. Maniéré dont mfait la pêché
de la^MortÈe^ ^ i^agé' dÿ'Tefre-Neuve en Angleterre.:
CE feroit- entreprendre un Ouvrage de longue haleine que de vouloir:
. décrire tout ce que nous eûmes à fouffrir à Louïshourg par une fuite
de,no'tr%disgfac.e>> mais plusnncorepar un effet delà cupidité & de l’a-
ip^içe de; .ceux qpinous asv.oient. pris. On n’a qü’à fe reprefenter tout ce
que la mifere'.d’PnC ;pact: & l’inhumanité de faütre peuvent caufer d’in-
. commodités, & l’on aura une idée jufte de l’état où nous étions.- Mais il
faut rendre jufficé à qui elle eft due; le Commandant de l’Efeadre fut
V | auffi.