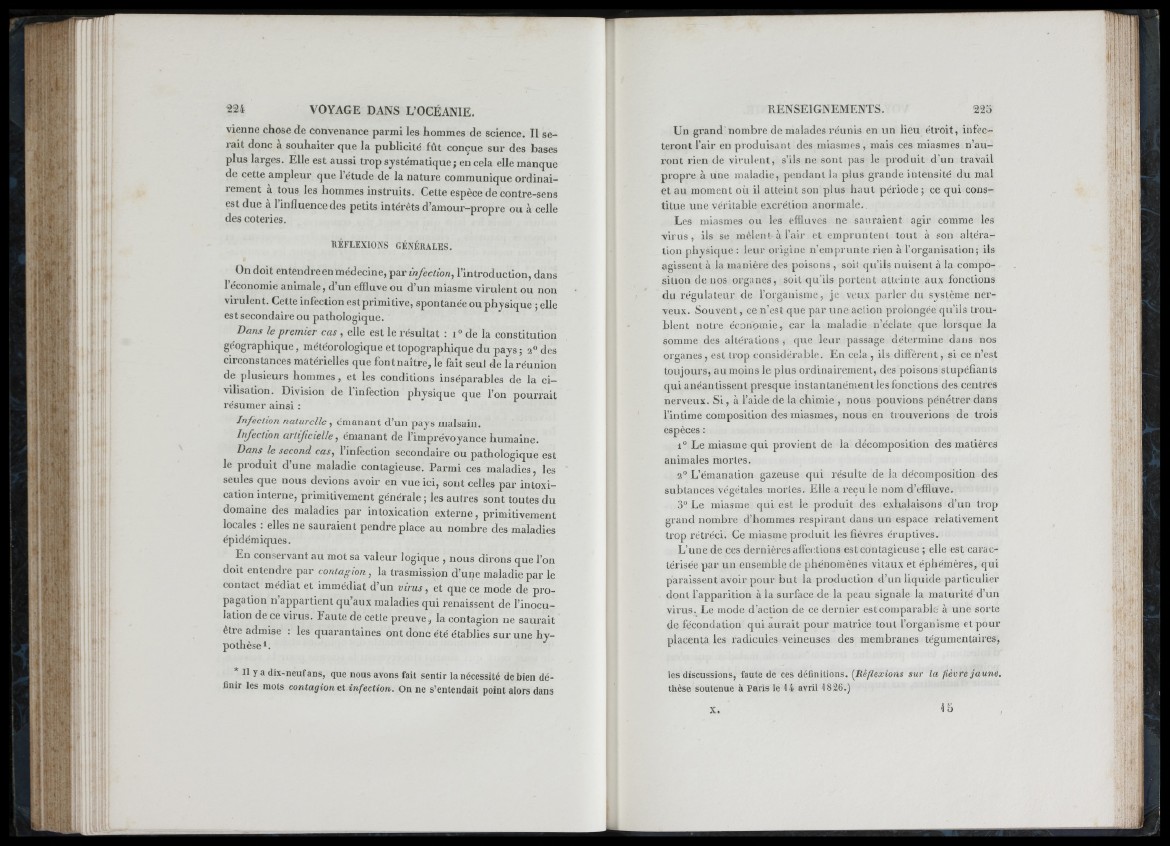
P.
vienne chose de convenance parmi les hommes de science. Il serait
donc à souhaiter que la publicité fût conçue sur des bases
plus larges. Elle est aussi trop systématique ; en cela elle manque
de cette ampleur que l’étude de la nature communique ordinairement
à tous les hommes instruits. Cette espèce de contre-sens
est due à l’influence des petits intérêts d’amour-propre ou à celle
des coteries.
RÉFLEXIONS GÉNÉRALES.
On doit entendreen médecine, par infection, l’introduction, dans
l’économie animale, d’un effluve ou d’un miasme virulent ou non
virulent. Cette infection estprimitive, spontanée ou physique ; elle
est secondaire ou pathologique.
Dans le premier cas , elle est le résultat : i ° de la constitution
géographique, météorologique et topographique du pays ; 2° des
circonstances matérielles que font naître, le fait seul de la réunion
de plusieurs hommes, et les conditions inséparables de la civilisation.
Division de l’infection physique que l’on pourrait
résumer ainsi :
Infection naturelle , émanant d’un pays malsain.
Injection artificielle, émanant de l’imprévoyance humaine.
Dans le second cas, l’infection secondaire ou pathologique est
le produit d’une maladie contagieuse. Parmi ces maladies, les
seules que nous devions avoir en vue ici, sont celles par intoxication
interne, primitivement générale ; les autres sont toutes du
domaine des maladies par intoxication externe, primitivement
locales : elles ne sauraient pendre place au nombre des maladies
épidémiques.
En conservant au mot sa valeur logique , nous dirons que l’on
doit entendre par contagion, la trasmission d’une maladie par le
contact médiat et immédiat d’un virus, et que ce mode de propagation
n’appartient qu’aux maladies qui renaissent de l’inoculation
de ce virus. la u t e de cette preuve, la contagion ne saurait
être admise : les quarantaines ont donc été établies sur une hypothèse*.
* Il y a dix-neuf ans, que nous avons fait sentir la nécessité de bien définir
les mots contagion et infection. On ne s’entendait point alors dans
Un grand nombre de malades réunis en un lieu étroit, infecteront
l’air en produ’isant des miasmes , mais ces miasmes n’auront
rien de virulent, s’ils ne sont pas le produit d’un travail
propre à une malad'ic, pendant la plus grande intensité du mal
et au moment oh il atteint son plus haut période ; ce qui constitue
une véritable excrétion anormale.
Les miasmes ou les effluves ne sauraient agir comme les
virus, ils se mêlent à l’air et empruntent tout à son altéra-
ûoii physique : leur oilgiue n’emprunte rien à l’organisation; ils
agissent à la manière des poisons , soil qu’ils nuisent à la composition
de nos organes, soit qu’ils portent atteinte aux fonctions
du régulateur de l’organisme, je veux parler du système nerveux.
Souvent, ce n’est que par une action prolongée qu’ils troublent
notre économie, car la maladie n’éclate que lorsque la
somme des altérations , que leur passage détermine dans nos
organes, est trop considérable. En cela , ils diffèrent, si ce n’est
toujours, aumoins le plus ordinairement, des poisons stupéfiants
qui anéantissent presque i.ustantanémenl les fonctions des centres
nerveux. S i , à l’aide de la chimie , nous pouvions pénétrer dans
l’intime composition des miasmes, nous en trouverions de trois
espèces :
1® Le miasme qui provient de la décomposition des matières
animales mortes.
2" L’émanation gazeuse qui résulte de ia décomposition des
subtances végétales mortes. Elle a reçu le nom d’effluve.
3® Le miasme qui est le produit des exhalaisons d’un ti op
grand nombre d’hommes respirant dans un espace relativement
trop rétréci. Ce m'iasme produit les fièvres éruptives.
L’une de ces dernières affections estcontagieuse ; elle est caractérisée
par un ensemble de phénomènes vitaux et éphémères, qui
paraissent avoir pour but la production d’un liquide particulier
dont fapparition à la surface de la peau signale la maturité d’un
virus. Le mode d’action de ce dernier est comparable à une sorte
de fécondation qui aurait pour matrice tout l’organisme et pour
placenta les radicules veineuses des membranes tégumentaires,
les discussions, faute de ces définitions. {Réflexions sur la fièvre ja u n e .
thèse soutenue à Paris le 14 avril 1826.)
X. 15