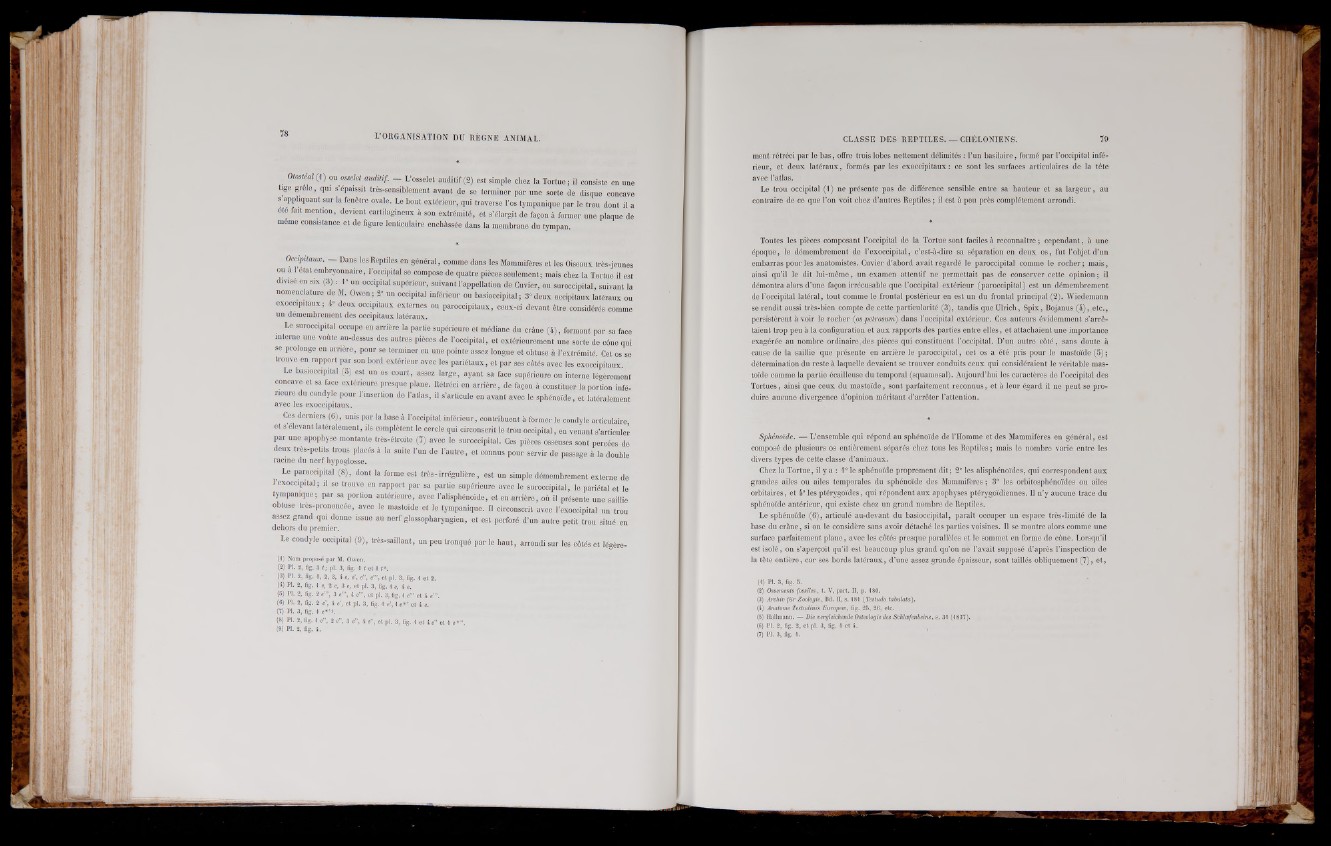
Otastéal (1) ou osselet auditif. - L’osselet auditif (2) est simple chez la Tortue ; il consiste en une
tige g rêle , qui s'épaissit très-sensiblement avant de se terminer par une sorte de disque concave
s appliquant sur la fenêtre ovale. Le bout extérieur, qui traverse l’os tympanique par le trou dont il a
été fait mention, devient cartilagineux à son extrémité, et s’élargit de façon à former une plaque dé
même consistance et de figure lenticulaire enchâssée dans la membrane du tympan.
Occipitaux. — Dans les Reptiles en général, comme dans les Mammifères et les Oiseaux très-jeunes
ou a l’état embryonnaire, Tocdpital se compose de quatre pièces seulement; mais chez la Tortue il est
divisé en six (3) : 4" un occipital supérieur, suivant l’appellation de Cuvier, ou suroccipital, suivant la
nomenclature de M. Owen; 2" un occipital inférieur ou basioccipital; 3* d eux occipitaux latéraux ou
exoccipitaux; 4 ' deux occipitaux externes ou paroccipitaux, ceux-ci devant être, considérés comme
un démembrement des occipitaux latéraux.
Le suroccipital occupe en arrière la partie supérieure et médiane du crâne (4 ), formant par sa face
interne une voûte au-dessus des autres pièces de l’occipital, et extérieurement une sorte de cône qui
se prolonge en arrière, pour se terminer en une pointe assez longue et obtuse à l’extrémité. Cet os se
trouve en rapport par son bord extérieur avec les pariétaux, e t par ses côtés avec les exoccipitaux.
Le basioccipital (S) est un os court, assez large, ayant sa face supérieure ou interne légèrement
concave et sa face extérieure presque plane. Rétréci en arrière, de façon à constituer la portion inférieure
du condyle pour l’insertion de l’atlas, il s’articule en avant avec le sphénoïde, et latéralement
avec les exoccipitaux.
Ces derniers (6), unis par la base à l'occipital inférieur, contribuent à former le condyle articulaire
et s élevant latéralement, ils complètent le cercle qui circonscrit le trou occipital, en venant s’articuler
p a r une apophyse montante très-étroite (7) avec le suroccipital. Ces pièces osseuses sont percées de
deux très-petits trous placés à la suite l'un de l’au tre , et connus pour servir de passage à la double
racine du n erf hypoglosse.
Le paroccipital (8), dont la forme est très-irrégulière, est un simple.démembrement externe de
exoccipital ; il se trouve en rapport par sa partie supérieure avec le süroccipital(,:;le pariétal et le
tympanique ; par sa portion antérieure, avec Talisphénoïde, et en arrière, où il présente une saillie
obtuse très-prononcée, avec le mastoïde et le tympanique. Il circonscrit.avec l’exoccipital un trou
assez grand qui donne issue au nerf glossopharyngien, et est perforé d’nn autre petit’ trou situé en
dehors du premier.
Le condyle occipital (9), très-saillant, un peu tronqué par le h au t, arrondi sur les côtés et légère-
C'1) Nom proposé par M. Owen.
î l l PI- 2, fig. 3 t; pl. 3, fig. | | e t 4 t*.
(3) Pl. 2, fig. 4, 2, 3, 4 e, e’, e”, e”’, et pl. 3, fig. 4 e t 2.
(4) Pl. 2, fig. 4 e, 2 e, 3 e, e t pl. 3, fig. 4 e, 4 e.
(5) Pl. 2, fig. 2 e’”, 3 e’”, 4 e”’, e t pl. 3, fig. 4 e’” et 4 e’” .
(6) Pl. 2, fig. 2 e', 4 e', e t pl. 3, fig. 4 e’, 4 e * ’ e t 4 e.
(7) Pl. 3, fig. 4 e*’1.
(8) Pl. 2, fig. 4 e”, 2 e”, 3 e”, 4 e”, et pl. 3, fig. 4 e t 4 e” e t 4 e*”
(9) Pl. 2, fig. 4.
ment rétréci p ar le bas, offre trois lobes nettement délimités : l’un basilaire, formé par l’occipital inférieur,
et deux latéraux, formés par les exoccipitaux: ce sont les surfaces articulaires de la tête
avec l’atlas.
Le trou occipital (1) ne présente pas de différence sensible entre sa hauteur et sa larg eu r, au
contraire de ce que l’on voit chez d’autres Reptiles ; il est à peu près complètement arrondi.
Toutes les pièces composant l’occipital de la Tortue sont faciles à reconnaître; cependant, à une
époque, le démembrement de l’exoccipital,- c’est-à-dire sa séparation en deux os, fut l’objet d ’un
embarras pour les anatomistes. Cuvier d’abord avait regardé le paroccipital comme le rocher; mais,
ainsi qu’il le dit lui-même, un examen attentif ne permettait pas de conserver cette opinion ; il
démontra alors d’une façon irrécusable que l’occipital extérieur (paroccipital) est un démembrement
de l’occipital latéral, tout comme le frontal postérieur en est un du frontal principal (2). Wiedemann
se rendit aussi très-bien compte de cette particularité (3), tandis que Ulrich, Spix, Bojanus (4 ),.etc.,
persistèrent à voir le rocher (os petrosum) dans l’occipital extérieur. Ces auteurs évidemment s’arrêtaient
trop peu à la configuration et aux rapports des parties entre elles, et attachaient une importance
exagérée au nombre ordinaire,des pièces qui constituent l’occipital. D’un autre côté, sans doute à
cause de la saillie que présente en arrière le paroccipital, cet os a été pris pour le mastoïde (5);
détermination du reste à laquelle devaient se trouver conduits ceux qui considéraient le véritable mastoïde
comme la partie écailleuse du temporal (squamosal). Aujourd’hui les caractères de l’occipital des
Tortues, ainsi que ceux du mastoïde, sont parfaitement reconnus, et à leur égard il ne peut se produire
aucune divergence d’opinion méritant d’arrêter l’attention.
Sphénoïde. — L’ensemble qui répond au sphénoïde de l’Homme et des Mammifères en général, est
composé de plusieurs os entièrement séparés chez tous les Reptiles ; mais le nombre varie entre les
divers types de cette classe d’animaux.
Chez la Tortue, il y a : 1° le sphénoïde proprement dit ; 2° les alisphénoïdes, qui correspondent aux
grandes ailes ou ailes temporales du sphénoïde des Mammifères ; 3° les orbitosphénoïdes ou ailés
orbitaires, et 4° les ptérygoïdes, qui répondent aux apophyses ptérygoïdiennes. II n ’y aucune trace du
sphénoïde antérieur, qui existe chez un grand nombre de Reptiles.
Le sphénoïde (6), articulé au-devant du basioccipital, paraît occuper un espace très-limité de la
base du crâne, si on le considère sans avoir détaché les parties voisines. Il se montre alors comme une
surface parfaitement p lane, avec les côtés presque parallèles et le sommet en forme de cône. Lorsqu’il
est isolé, on s’aperçoit qu’il est beaucoup plus grand qu’on ne l’avait supposé d’après l’inspection de
la tête entière, car ses bords latéraux, d ’une assez grande épaisseur, sont taillés obliquement (7), e t,
|1 | | 3, fig. 5.
(2) Ossements fossiles, t. V, part, n , p. 4 80.
(3) Archiv für Zoologie, Bd. n , s. 484 (Testudo tabulata).
(4) Anatome Testudinis Europea, fig. 25, 26, etc.
(5) Hallmann. — Die vergleichende Osteologie des Schloefenbeins, s. 34 (4837).
p i Pl. 2, fig. 2, e t pl. 3, fig. 4 é t 4.
(7) Pl. 3, fig. 4.