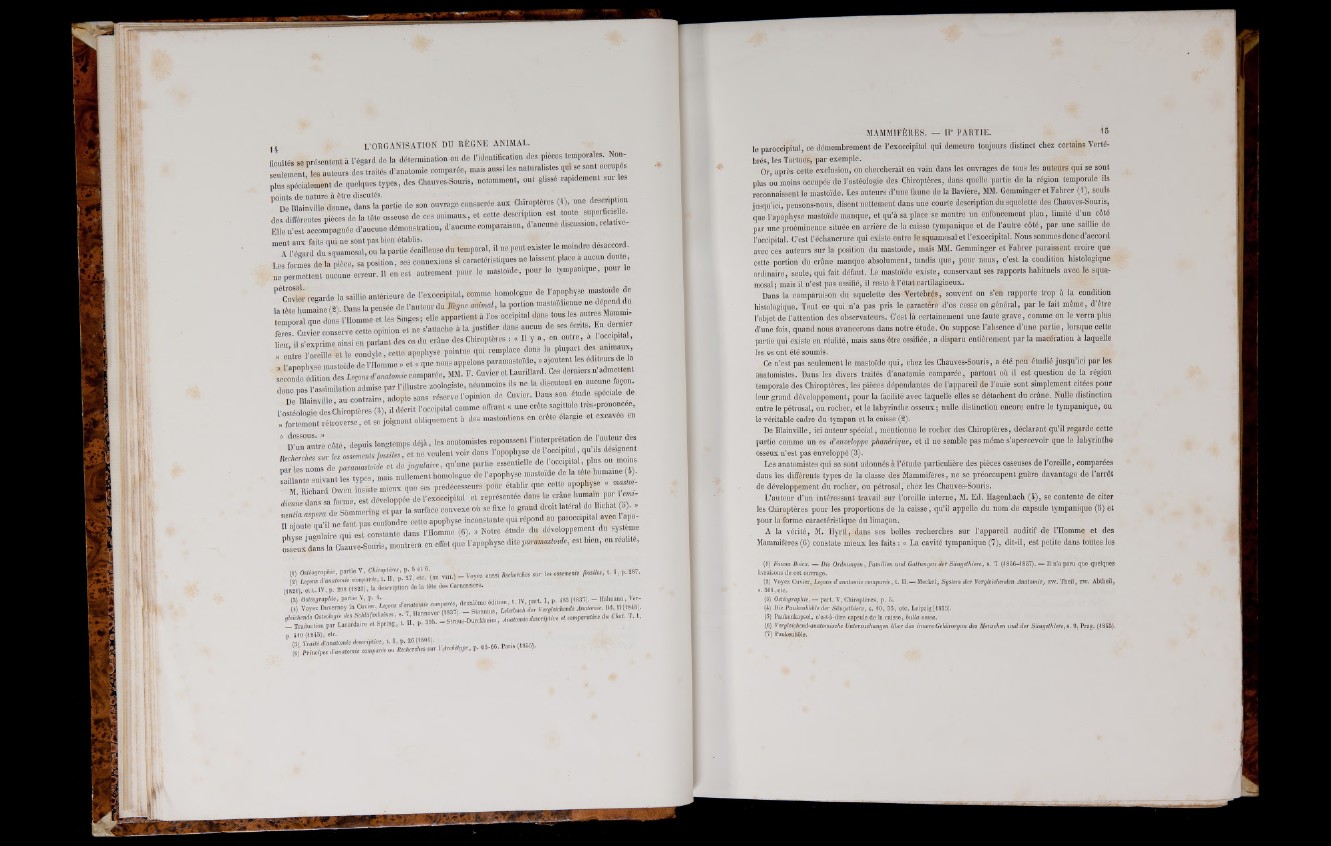
L’ORGANISATION DU RÈGNE ANIMAL,
ficultés se présentent à l’égard de la détermination on de l’identification des pièces temporales, g g g
seulement, les auteurs.des traités d’anatomie comparée, mais anssi les naturalistes qm se sont occupés
plus spécialement de quelques types, des Chauve-Souris, notamment, ont glissé rapidement
I M P — 1 ■ 1 pièces ta la tête osseuse de ces animaux, et cette description est oute s u p e ro eU .
Elle n’est accompagnée d’aucune démonstration, d'aucune comparaison, d aucune discussion, relative
B B 8 1 Riparfie^écaillense du temporal, il ne peut exister le moindre désaccord.
Les formes de la pièce, sa position, ses connexions si caractéristiques ne laissent place à aucun doute,
t e p e r l t e n l aucune erreur. Il eu est autrement pour le mastoïde, pour le tympanique, pour le
^C u v ie r regarde la saillie antérieure de l’exoccipital, comme homologue de l'apophys» mastoMe de
la tète humaine (2). Dans la pensée de l’auteur du l i é s * urtfmu!, la portion m astoïdienne ne
temporaHlue dans l'Homme e t les Singes; elle appartient à Dos occipital dans tons les autres Mamm r
fères Cuvier conserve cette opinion et ne s’attache à la justifier dans aucun de ses écrits. En derme
lien il ^expidme ainsi en p arlant des os du crâne des Chiroptères = .. Il y a , en outre, a l occ,pilai,
entre l’oreille e t le condyle, cette apophyse pointue qui remplace dans la plupart des animaux,
l’apophvse mastoïde de l’Homme » e t « que nous appelons paramastoïde, » ajoutent les éditeurs de la
seconde édition des Leçom <Tanatomie comparée, MM. F. Cuvier et Uurillard. Ces derniers n admettent
W Ê ^ & B lÈ È B È Ê B Ê È m M H asnera de Semmering et p a r la surface convexe où se fixe le grand droit latéral de Biehat (S). »
- e faut pas confondre cette apophyse inconstante qui répond au paroccipital avec 1 apophyse
jugulaire qui est constante dans l’Homme (6). » Notre étude d u développement du système
oséeux dans la Chauve-Souris, montrera en effet que l’apophyse d ite p n r â te to id e , est bien, en réalité,
: 2 B B B I m M H M ™ . , - V o y e z aussi « s w tes — I t a t a . «. I , p. • » ■
(4824) e t t . IV, p . 208 (4823) , la description d e la tète d e s Carnassiers.
SI!:
H , r - Straus-Durcltheim, A— * * ■ * < * “ W « - » * « * * ’ ’
p . 440 (4845), e tc .
(5) Traité d’anatomie descriptive, 1.1, p . 26 (4804).
g ’ principes d’anatomie comparée ou Recherches sur l Archétype, p . 6 5 -6 6 . Paris (4855).
le parocoipital, ce démembrement de l’exoccipital qui demeure toujours distinct chez certains Vertébrés,
lés Tortues, par exemple.
Or, après cette exclusion; on chercherait en vain dans les ouvrages de tous les auteurs qui se sont
plus ou moins occupés de l’ostéologi'e des Chiroptères, dans quelle partie de la région temporale ils
reconnaissent le mastoïde. Les auteurs d’une faune de la Bavière, MM. Gemminger et Fahrer (1), seuls
jusqu’ici, pensons-nous, disent nettement dans une courie description du squelette des Chauves-Souris,
que l’apophyse mastoïde m anque, e t qu’à sa place se montre un enfoncement p lan , limité d’un côté
par une proéminence située en arrière de la caisse tympanique et de l’autre côté, par uue saillie de
l’occipital. C’est l’échancrure qui existe entre le squamosal et l’exoccipital. Nous sommes donc d’accord
avec ces auteurs sur la position du mastoïde, mais MM. Gemminger e t Fahrer paraissent croire que
cette portion du crâne manque absolument, tandis que, pour nous, c’est la condition histologique
ordinaire, seule, qui fait défaut. Le mastoïde existe, conservant ses rapports habituels aveç.le squamosal;
mais il n’est pas ossifié, il resté à l ’étatcartilagineux.
Dans la comparaison du squelette des'Vertébrés, souvent on s’en rapporte trop’ à la condition
histologique. Tout ce qui n’a pas pris le paractèré d’os cesse en général, par le fait même, d ’être
l’objet de l’attention des observateurs. C’e s tlà certainement nne faute g rave, comme on le verra plus
d’une fois, quand nous avancerons dans notre étude. On suppose l’absence d'une p a rtie , lorsque cette
partie qui existe en réalité, mais sans être ossifiée, a disparu entièrement p a r la macération à laquelle
les os ont été soumis.
Ce n’est pas seulement le mastoïde qu i, chez les Chauves-Souris, a été peii étudié jusqu’ici par lès
anatomistes. Dans les divers traités d’anatomie comparée, partout où il est question de la région
temporale des Chiroptères, .les pièces dépendantes de l’appareil de l’ouïe sont simplement citées pour
leur grand développement; pour la facilité avec laquelle elles se détachent du crâne. Nulle distinction
entre le pétrosal, ou rocher, et le labyrinthe osseux; nulle distinction encore entre le tympanique, ou
lé véritable cadre du tympan e t la caisse (2).
De Blainville, ici âuteur spécial, mentionne le rocher des Chiroptères, déclarant qu’il regarde cette
partie comme un o s d ’e n v e lo p p e p h a n é r iq u e , e t il ne semble pas même s’apercevoir que le labyrinthe
osseux n’est pas enveloppé (3).
Les anatomistes qui se sont adonnés à l’étude particulière des pièces osseuses de l ’oreille, comparées
dans les différents types de la classe des Mammifères, ne se préoccupent guère davantage de l’arrêt
de développement du rocher, ou pétrosal, chez les Chauves-Souris.
L’auteur d’un intéressant travail sur l’oreille interne, M. Ed. Hagenbach (4), se contente de citer
les Chiroptères pour les proportions de la caisse, qu’il appelle du nom de capsule tympanique (5) et
pour la forme caractéristique du limaçon.
A la vérité, M. Hyrtl, dans ses belles recherches sur l’appareil auditif de l’Homme et des
Mammifères (6) constate mieux les faits : « La cavité tympanique (7), dit-il, est petite dans toutes les
(4) Fauna Boica. — Die Ordnungen, Familien und Gattungen d e r Säugethiere, s . 7 (4856-4857). — Il n’a paru que quelques
livraisons de cet ouvrage.
(2) Voyez Cuvier, Leçons d’anatomie comparée, t. II.— Meckel, S y stem der Vergleichenden Anatomie, zw . Th eil, zw . Abtheil,
s . 504, etc.
(3) Ostéographie. — part. Y, Chiroptères, p . 5.
(4) Die Paukenhöhle der Säugethiere, s . 4 0 , 3 5 , etc. Leipzig (4835).
(5) Paukenkapsel, c’est-à-dire capsule d e la c a isse , bulla ossea.
(6) Vergleichend-anatomische Untersuchungen über das innere Gehörorgan des Menschen und d e r Säugethiere, s . 9 , Prag. (4845).
(7) Paukenhöle.