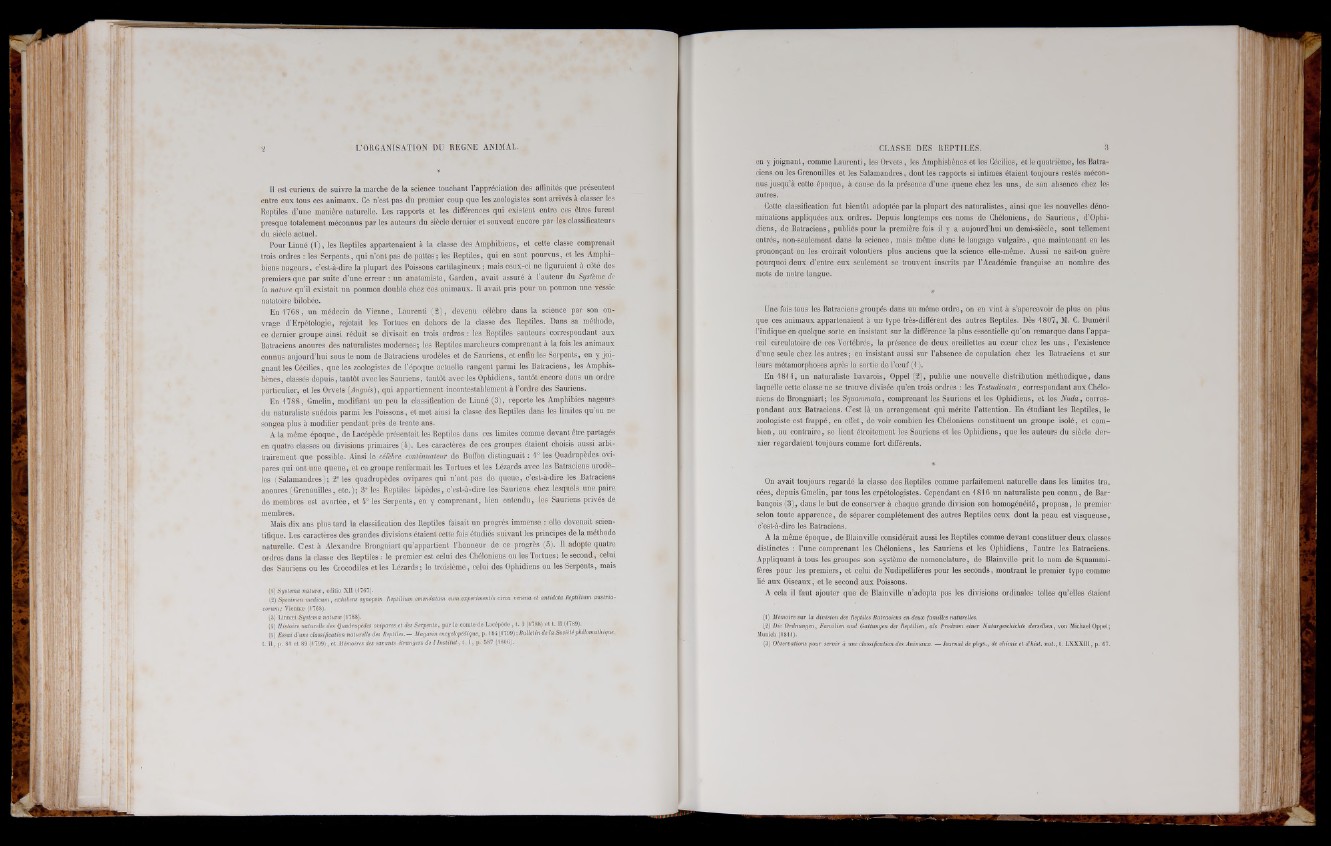
Il est curieux de suivre la marche de la science touchant l’appréciation des affinités que présentent
entre eux tous ces animaux. Ce n’est pas du premier coup que les zoologistes sont arrivés à classer les
Reptiles d’une manière naturelle. Les rapports et les différences qui existent entre ces êtres furent
presque totalement méconnus par les auteurs du siècle dernier et souvent encore par les classificateurs
du siècle.actuel.
Pour Linné (1), les Reptiles appartenaient à la classe des Amphibiens, et cette classe comprenait
trois ordres : les Serpents, qui n’ont pas de p attes; les Reptiles, qui en sont pourvus, et les Amphibiens
nageurs, c’est-à-dire la plupart des Poissons cartilagineux ; mais ceux-ci ne figuraient à côté des
premiers que par suite d’une erreur : un anatomiste, Garden, avait assuré à l’auteur du Système de
la nature qu’il existait un poumon double chez ces animaux. Il avait pris pour un poumon une vessie
natatoire bilobée.
En 1768, un médecin de Vienne, Laurenti ( 2 ) , devenu célèbre dans la science par son ouvrage
d’Erpétologie, rejetait les Tortues en dehors de la classe des Reptiles. Dans sa méthode,
ce dernier groupe ainsi réduit se divisait en trois ordres : les Reptiles sauteurs correspondant aux
Batraciens anoures des naturalistes modernes; les Reptiles marcheurs comprenant à la fois les animaux
connus aujourd’hui sous le nom de Batraciens urodèles et de Sauriens, et enfin les Serpents, en y joignant
les Cécilies, que les zoologistes de l’époque actuelle rangent parmi les Batraciens, les Amphis-
bènes, classés d epuis, tantôt avec les Sauriens, tantôt avec les Ophidiens, tantôt encore dans un ordre
particulier, et les Orvets (Anguis) , qui appartiennent incontestablement à l’ordre des Sauriens.
En 1788, Gmelin, modifiant un peu la classification de Linné (3), reporte les Amphibies nageurs
du naturaliste suédois parmi les Poissons, et m et ainsi la classe des Reptiles dans les limites qu’on ne
songea plus à modifier pendant près de trente ans.
A la même époque, de Lacépède présentait les Reptiles dans ces limites comme devant être partagés
en quatre classes ou divisions primaires (4). Les caractères de ces groupes étaient choisis aussi arbi-
trairement que possible. Ainsi le célèbre continuateur de Buffon distinguait : 10 les Quadrupèdes ovipares
qui ont une queue, et ce groupe renfermait les Tortues et les Lézards avec les Batraciens urodèles
(Salamandres); 2° les quadrupèdes ovipares qui n’ont pas de queue, c’est-à-dire les Batraciens
anoures (Grenouilles, etc.); 3° les Reptiles bipèdes, c’est-à-dire les Sauriens, chez lesquels une paire
de membres est avortée, et 4° les Serpents, en y comprenant, bien entendu, les Sauriens privés de
membres.
Mais dix ans plus tard la classification des Reptiles faisait un progrès immense : elle devenait scientifique.
Les caractères des grandes divisions étaient cette fois étudiés suivant les principes de la méthode
naturelle. Cest à Alexandre Brongniart qu’appartient l’honneur de ce progrès (5). Il adopte quatre
ordres dans la classe des Reptiles : le premier est celui des Chéloniens ou les Tortues; le second, celui
des Sauriens ou les Crocodiles et les Lézards; le troisième, celui des Ophidiens ou les Serpents, mais
(4) Sy stema naturte, editio XII (4767).
(2) Specimen medicum, exhibais synopsin Reptilium emendatam cum experimentis circa venena et antidota Reptilium austria-
corum; Viennæ (4768).
(3) Linhæi Systema naturoe (4788).
(4) Histoire naturelle des Quadrupèdes ovipares e t des Serpents, par le comte de Lacépède, 1. 1 (4788) et t. Il (4789).
(3) Essai d’une classification naturelle des Reptiles. — Magasin encyclopédique, p. 4 84 (4799) ; Bulletin de la Société philomathique,
t. II, p. 84 et 89 (4799), e t Mémoires des savants étrangers de l’In stitu t, t. I , p. 587 (4806).
en y joignant, comme Laurenti, les O rvets, les Amphisbènes et les Cécilies, et le quatrième, les Batraciens
ou les Grenouilles et les Salamandres, dont les rapports si intimes étaient toujours restés méconnus,
jusqu’à cette époque, à cause de la présence d’une queue chez les uns, de son absence chez les
autres.
Cette classification fut bientôt adoptée p ar la plupart des naturalistes, ainsi que les nouvelles dénominations
appliquées aux ordres. Depuis longtemps ces noms de Chéloniens, de Sauriens, d’Ophidiens,
de Batraciens, publiés pour la première fois il y a àujourd’hui un demi-siècle, sont tellement
entrés, non-seulement dans la science, mais même dans le langage vulgaire, que maintenant en les
prononçant on les croirait volontiers plus anciens que la science elle-même. Aussi ne sait-on guère
pourquoi deux d’entre eux seulement se trouvent inscrits par l’Académie française au nombre des
mots de notre langue.
Une fois tous les Batraciens groupés dans un même o rdre, on en vint à s’apercevoir de plus en plus
que ces animaux appartenaient à un« type très-différent des autres Reptiles. Dès 1807, M. C. Duméril
l’indique en quelque sorte en insistant sur la différence la plus essentielle qu’on remarque dans l’appareil
circulatoire de ces Vertébrés, la présence de deux oreillettes au coeur chez les u n s , l’existence
d’une seule chez les autres ; en insistant aussi sur l’absence de copulation chez les Batraciens et sur
leurs métamorphoses après la sortie d e l’oeuf (1 ).
En 1811, un naturaliste bavarois, Oppel (2), publie une nouvelle distribution méthodique, dans
laquelle cette classe ne se trouve divisée qu’en trois ordres : les Testudinata, correspondant aux Chéloniens
de Brongniart; les Squammata, comprenant les Sauriens et les Ophidiens, et les Nuda, correspondant
aux Batraciens. C’est là un arrangement qui mérite l’attention. En étudiant les Reptiles, le
zoologiste est frappé, en effet, de voir combien les Chéloniens constituent un groupe isolé, et combien
, au contraire, se lient étroitement les Sauriens et les Ophidiens, que les auteurs du siècle dernier
regardaient toujours comme fort différents.
On avait toujours regardé la classe des Reptiles comme parfaitement naturelle dans les limites tracées,
depuis Gmelin, par tous les erpétologistes. Cependant en 1816 un naturaliste peu connu, de Bar-
bançois (3), dans le but de conserver à chaque grande division son homogénéité, proposa, le premier
selon toute apparence, de séparer complètement des autres Reptiles ceux dont la peau est visqueuse,
c’est-à-dire les Batraciens.
A la même époque, de Blainville considérait aussi les Reptiles comme devant constituer deux classes
distinctes : l’une comprenant les Chéloniens, les Sauriens et les Ophidiens, l’autre les Batraciens.
Appliquant à tous les groupes son système de nomenclature, de Blainville prit le nom de Squammi-
fères pour les premiers, et celui de Nudipellifères pour les seconds, montrant le premier type comme
lié aux Oiseaux, et le second aux Poissons.
A cela il faut ajouter que de Blainville n’adopta pas les divisions ordinales telles qu’elles étaient
(4) Mémoire sur la div ision des Reptiles Batraciens en deux familles naturelles.
(2) Die Ordnungen, Familien und Gattungen der Reptilien, a ls Prodrom einer Naturgeschichte derselben, von Michael Oppel;
Munich (4844).
(3) Observations pour se rvir à une classification des Animaux. — Journal de phy s., de chimie e t d'hist. n a t., t. LXXXUI, p. 67.