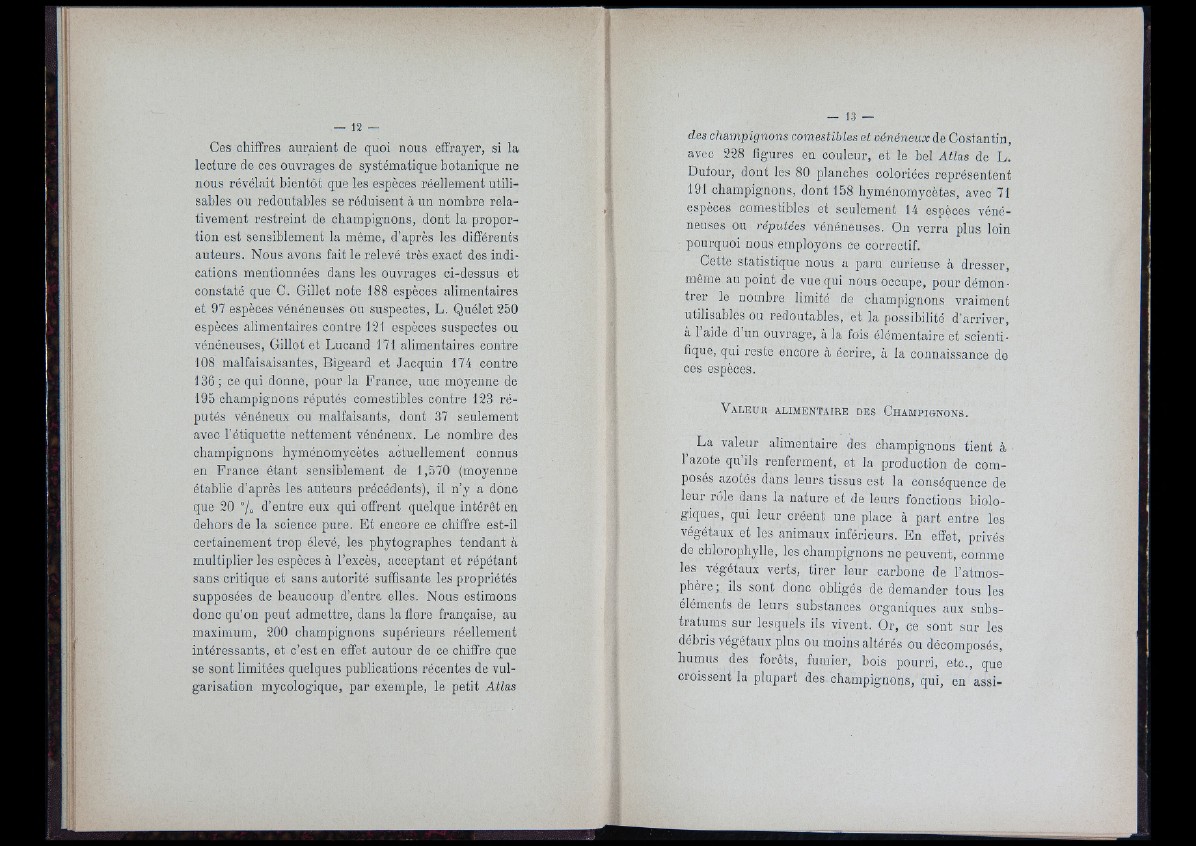
Ces chiffres auraient de quoi nous effrayer, si la
lecture de ces ouvrages de systématique botanique ne
nous révélait bientôt que les espèces réellement utilisables
ou redoutables se réduisent à un nombre relativement
restreint de champignons, dont la proportion
est sensiblement la même, d’après les différents
auteurs. Nous avons fait le relevé très exact des indications
mentionnées dans les ouvrages ci-dessus et
constaté que G. Gillet note 188 espèces alimentaires
et 97 espèces vénéneuses ou suspectes, L. Quélet 250
espèces alimentaires contre 121 espèces suspectes ou
vénéneuses, Gillot et Lucand 171 alimentaires contre
108 malfaisaisantes, Bigeard et Jacquin 174 contre
136; ce qui donne, pour la France, une moyenne de
195 champignons réputés comestibles contre 123 ré putés
vénéneux ou malfaisants, dont 37 seulement
avec l’étiquette nettement vénéneux. Le nombre des
champignons hyménomycètes actuellement connus
en France étant sensiblement de 1,570 (moyenne
établie d’après les auteurs précédents), il n’y a donc
que 20 % d’entre eux qui offrent quelque intérêt en
dehors de la science pure. E t encore ce chiffre est-il
certainement trop élevé, les phytographes tendant à
multiplier les espèces à l ’excès, acceptant et répétant
sans critique et sans autorité suffisante les propriétés
supposées de beaucoup d’entre elles. Nous estimons
donc qu’on peut admettre, dans la flore française, au
maximum, 200 champignons supérieurs réellement
intéressants, et c’est en effet autour de ce chiffre que
se sont limitées quelques publications récentes de vulgarisation
mycologique, par exemple, le petit Atlas
des champignons comestibles et vénéneux de Costantin,
avec 228 figures en couleur, et le bel Atlas de L.
Dufour, dont les 80 planches coloriées représentent
191 champignons, dont 158 hyménomycètes, avec 71
espèces comestibles et seulement 14 espèces vénéneuses
ou réputées vénéneuses. On verra plus loin
pourquoi nous employons ce correctif.
Cette statistique nous a paru curieuse à dresser,
même au point de vue qui nous occupe, pour démontre
r le nombre limité de champignons vraiment
utilisables ou redoutables, et la possibilité d’arriver,
à l’aide d’un ouvrage, à la fois élémentaire et scientifique,
qui reste encore à écrire, à la connaissance de
ces espèces.
V a l e u r a l im e n t a ir e des C h a m p ig n o n s .
La valeur alimentaire des champignons tient à
1 azote qu ils renferment, et la production de composés
azotés dans leurs tissus est la conséquence de
leur rôle dans la nature et de leurs fonctions biologiques,
qui leur créent une place à pa rt entre les
végétaux et les animaux inférieurs. En effet, privés
de chlorophylle, les champignons ne peuvent, comme
les végétaux verts, tire r leur carbone de l’atmosp
hère; ils sont donc obligés de demander tous les
éléments de leurs substances organiques aux subs-
tratums sur lesquels ils vivent. Or, ce sont sur les
débris végétaux plus ou moins altérés ou décomposés,
humus des forêts, fumier, bois pourri, etc., que
croissent la plupart des champignons, qui, en assi