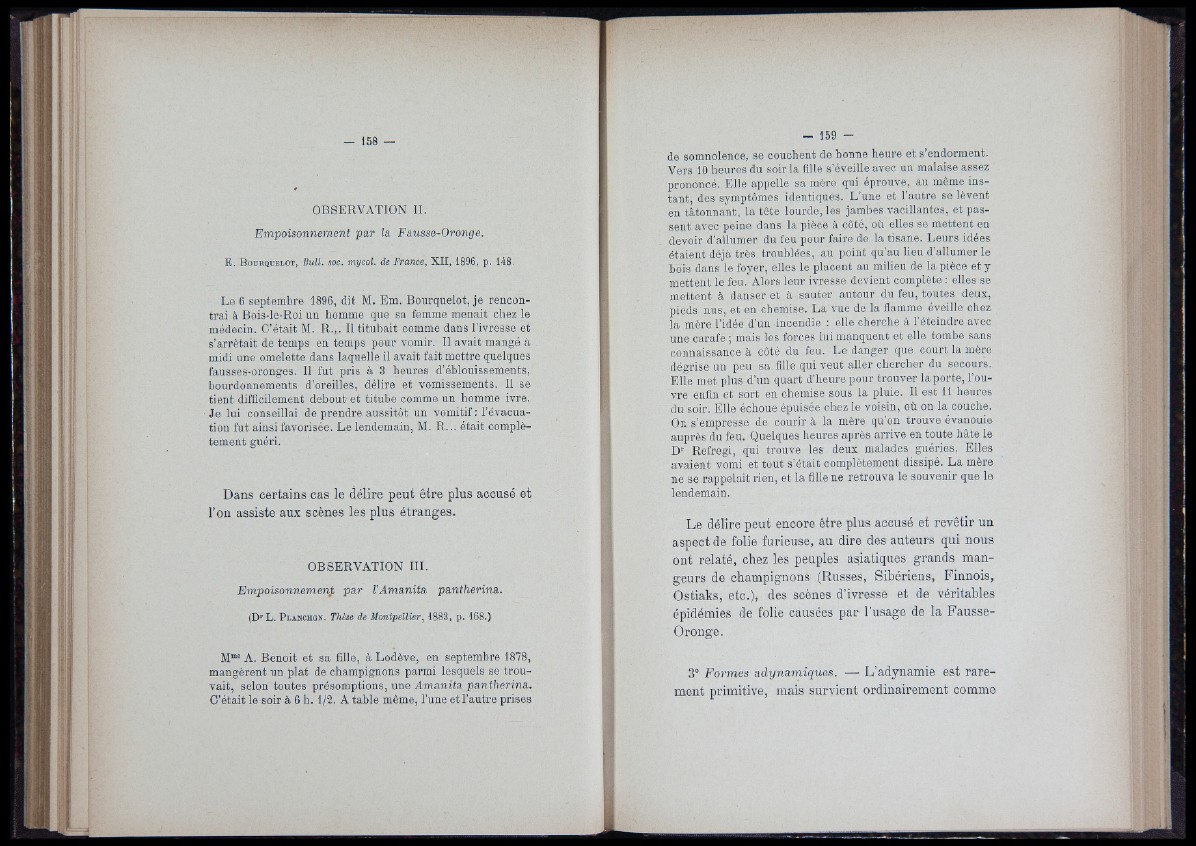
OBSERV A T IO N II.
Empoisonnement par la Fausse-Oronge.
B . B o u r q u e l o t , Bull. soc. mycol. de France, XII, 1896, p . 148-
L e 6 septem bre 1896, dit M. Em. Bourquelot, je ren co n tra
i à Bois-le-Roi un homme que sa femme m enait chez le
médecin. C’é ta it M. R .,. Il titu b a it comme dans l’iv resse et
s’a r rê ta it de temps en temps pour vomir. Il av ait mangé à
midi une omelette dans laquelle il a v a it fait m e ttre quelques
fau sses-oronges. Il fu t p ris à 3 heu res d ’éblouissements,
b ou rd o n n emen ts d ’oreilles, délire et vomissements. Il se
tie n t difficilement debout e t titu b e comme un homme ivre.
J e lui conseillai de p ren d re au ssitô t un vomitif : l’év acu a tion
fu t ainsi favorisée. L e lendemain, M. R ... é ta it complètem
e n t guéri.
Dans certains cas le délire peut être plus accusé et
l’on assiste aux scènes les plus étranges.
OBSERV A T IO N III.
Empoisonnement par l'Amanita pantherina.
(D®L. P l a n c h o n . Thèse de Montpellier, 1883, p. 168.)
M™' A. B en o it e t sa fille, à Lodève, en septem bre 1878,
m an g è ren t un p la t de champignons parmi lesquels se tro u v
a it, selon to u te s p ré som p tio n s, une Amanita pantherina.
C’é ta it le soir à 6 h. 1/2. A tab le même, l’une et l ’a u tre p rise s
de somnolence, se couchent de bonne heu re e t s’endorment.
Vers 10 h eu re s du soir la fille s ’éveille avec un malaise assez
prononcé. E lle appelle sa mère qui éprouve, au même in s ta
n t, des symptômes identiques. L ’une e t l’a u tre se lèvent
en tâ to n n a n t, la tê te lourde, les jambes v a cillan te s, e t p a ssen
t avec peine dans la pièce à côté, où elles se m e tten t en
devoir d ’a llum er du feu pour faire de la tis an e . L e u rs idées
é ta ien t déjà trè s tro u b lé es, au p o in t qu ’au lieu d’a llum er le
bois dans le foyer, elles le p lac en t au milieu de la pièce e t y
m e tte n t le feu. Alors leu r iv resse devient complète : elles se
m e tte n t à d an se r e t à s a u te r a u to u r du feu, to u te s deux,
pieds n u s, e t en chemise. L a vue de la flamme éveille chez
la mère l’idée d’un incendie : elle cherche à l’é te in d re avec
une c arafe ; mais les forces lui m an q u en t et elle tombe sans
co n n aissan c e à côté du feu. L e d an g er que co u rt la mère
dég rise u n peu sa fille qui v e u t a lle r ch erch er du secours.
E lle m et plus d’un q u a rt d’h eu re pour tro u v e r la p o rte, l’ouv
re enfin e t so rt en chemise sous la pluie. Il e st 11 heu res
du soir. E lle échoue épuisée chez le voisin, où on la couche.
On s’empresse de co urir à la mère qu’on tro u v e évanouie
au p rès du feu. Quelques h eu res ap rès a rriv e en to u te h â te le
D® Refregi, qui tro u v e les deux malades g u éries. Elles
av aien t vomi e t to u t s ’é ta it complètement dissipé. L a mère
ne se rap p e la it rien, e t la fille ne re tro u v a le so uvenir que le
lendemain.
Le délire peut encore être plus accusé et revêtir un
aspect de folie furieuse, au dire des auteurs qui nous
ont relaté, chez les peuples asiatiques grands mangeurs
de champignons (Russes, Sibériens, Finnois,
Ostiaks, etc.), des scènes d’ivresse et de véritables
épidémies de folie causées par l’usage de la Fausse-
Oroiige.
3“ Formes adynamiques. — L’adynamie est rarement
primitive, mais survient ordinairement comme