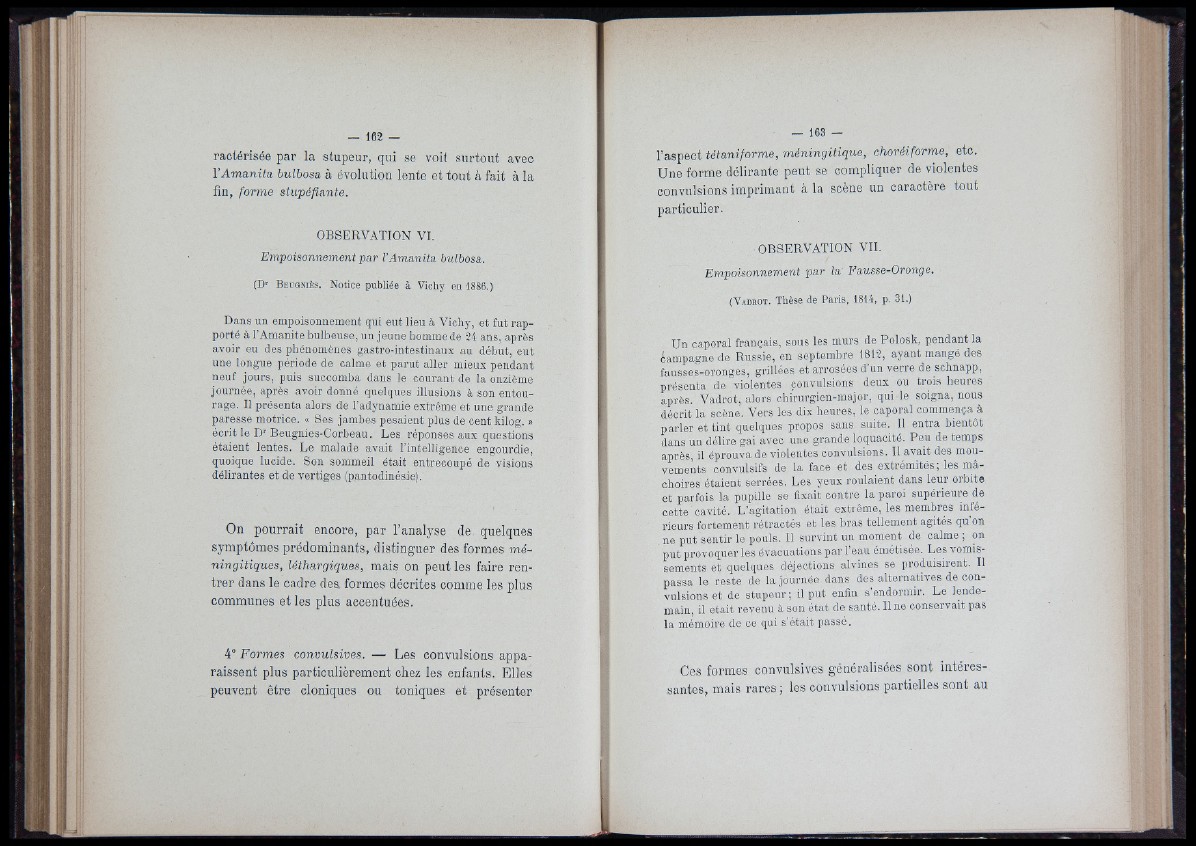
f e L'Il
raclérisée par la stupeur, qui se voit surtout avec
YAmanita bulbosa à évolution lente et tout à fait à la
fin, forme stupéfiante.
OBSERV AT ION VI.
Empoisonnement par l’Amanita bulbosa.
(D® B e u g k i è s . Notice publiée à Vichy en 1886.)
Dans un empoisonnement qui eu t lieu à Vichy, et fut ra p p
o rté à l’Amanite bulbeuse, un jeu n e homme de 24 ans, après
av o ir eu des phénomènes g a stro -in tes tin au x au début, eu t
une longue période de calme e t p a ru t a lle r mieux p en d an t
n eu f jo u rs, puis succomba dans le co u ran t de la onzième
jo u rn é e , ap rès avoir donné quelques illusions à son en to u rage.
Il p ré s en ta alors de l’adynamie extrême et une g rande
p a re ss e motrice. « Ses jambes p e sa ien t plus de cent kilog. »
é c rit le D® Beugnies-Corbeau. L es réponses aux questions
é ta ie n t lente s. Le malade av ait l'in te llig en c e engourdie,
quoique lucide. Son sommeil é ta it entre co u p é de visions
d é liran te s e t de v e rtig es (pantodinésie).
On pourrait encore, par l’analyse de quelques
symptômes prédominants, distinguer des formes méningitiques,
léthargiques, mais on peut les faire rentre
r dans le cadre des formes décrites comme les plus
communes et les plus accentuées.
4° Formes convulsives. — Les convulsions apparaissent
plus particulièrement chez les enfants. Elles
peuvent être cloniques ou toniques et présenter
— 163 —
l’aspect tétaniforme, méningitique, choréiforme, etc.
Une forme délirante peut se compliquer de violentes
convulsions imprimant à la scène un caractère tout
particulier.
O BSERV AT ION VII.
E m p o iso n n em e n t p a r la Fausse-Oronge.
(Vadrot. Thèse de Paris, 1814, p. 31.)
Un caporal français, sous les murs de Polosk, p en d an t la
è ampagne de Ru ssie , en sep tem b re 1812, a y an t mangé des
fau sse s-o ro n g e s, grillées e t a rro sée s d’un v e rre de schnapp,
p ré s en ta de violentes convulsions deux ou tro is heures
après. Vad ro t, alors chiru rg ien -m a jo r, qui le soigna, nous
d é crit la scène. Vers les dix h eu res, le caporal commença à
p a rle r et tin t quelques propos sans suite. Il e n tra b ien tô t
dans un délire gai avec une g rande loquacité. P e u de temps
ap rès, il éprouva de violentes convulsions. Il av ait des mouvemen
ts convulsifs de la face e t des e x trém ité s ; les m â choires
é ta ien t se rrée s. L es yeu x ro u la ien t dans leu r o rb ite
e t parfois la pupille se fixait co n tre la paroi supé rieu re de
c e tte cavité. L ’ag ita tio n é ta it extrême, les membres inférieu
rs fo rtem en t ré tra c té s et les b ra s te llem en t ag ité s qu ’on
ne p u t s e n tir le pouls. Il su rv in t un moment de calme ; on
p u t provoquer les év acu atio n s p a r l’eau émétisée. L e s vomissements
et quelques déjections alvines se p ro d u isiren t. Il
p a ssa le re s te de la jo u rn ée dans des a lte rn a tiv e s de convulsions
et de s tu p e u r; il p u t enfin s’endormir. Le len d e main,
il é ta it rev en u à son é ta t de san té. Il ne c o n se rv a it pas
la mémoire de ce qui s’é ta it p a ssé .
Ces formes convulsives généralisées sont intéressantes,
mais rares ; les convulsions partielles sont au