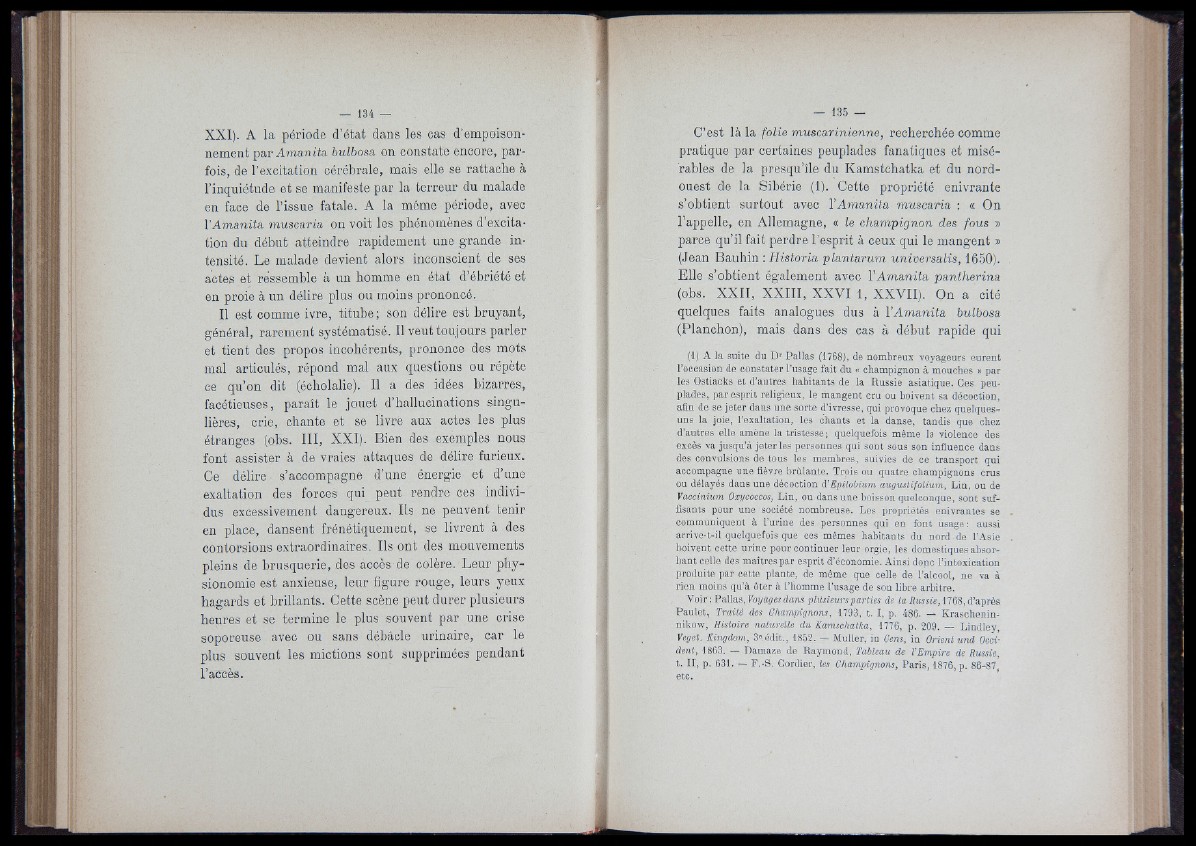
XXI). A la période d’état dans les cas d’empoisonnement
par Amanita bulbosa on constate encore, p a rfois,
de l’excitation cérébrale, mais elle se rattache à
l’inquiétude et se manifeste par la terreur du malade
en face de l’issue fatale. A la môme période, avec
VAmanita muscaria on voit les phénomènes d’excitation
du début atteindre rapidement une grande in tensité.
Le malade devient alors inconscient de ses
actes et ressemble à un homme en état d’ëbriété et
en proie à un délire plus ou moins prononcé.
Il est comme ivre, titube; son délire est bruyant,
général, rarement systématisé. Il veut toujours parler
et tient des propos incohérents, prononce des mots
mal articulés, répond mal aux questions ou répète
ce qu’on dit (écholalie). Il a des idées bizarres,
facétieuses, paraît le jouet d’hallucinations singulières,
crie, chante et se livre aux actes les plus
étranges (obs. III, XXI). Bien des exemples nous
font assister à de vraies attaques de délire furieux.
Ce délire s’accompagne d’une énergie et d’une
exaltation des forces qui peut rendre ces individus
excessivement dangereux. Ils ne peuvent tenir
en place, dansent frénétiquement, se livrent à des
contorsions extraordinaires. Ils ont des mouvements
pleins de brusquerie, des accès de colère. Leur physionomie
est anxieuse, leur figure rouge, leurs yeux
hagards et brillants. Cette scène peut durer plusieurs
heures et se termine le plus souvent par une crise
soporeuse avec ou sans débâcle urinaire, car le
plus souvent les mictions sont supprimées pendant
l ’accès.
C’est là la folie muscarinienne, recherchée comme
pratique par certaines peuplades fanatiques et misérables
de la presqu’île du Kamstchatka et du nord-
ouest de la Sibérie (1). Cette propriété enivrante
s’obtient surtout avec Y Amanita muscaria : « Cn
l ’appelle, en Allemagne, oe le champignon des fous n
parce qu’il fait perdre l ’esprit à ceux qui le mangent »
(Jean Bauhin : Historia plantarum universalis, 1650).
Elle s’obtient également avec Y Amanita pantherina
(obs. XXII, X X III, XXVI 1, XXVII). Cn a cité
quelques faits analogues dus à l’Amaniia bulbosa
(Planchón), mais dans des cas à début rapide qui
(1) A la suite du D® Pallas (1768), de nombreux voyageurs eurent
l’occasion de constater l’usage fait du « champignon à mouches » par
les Ostiacks et d’autres habitants de la Russie asiatique. Ces peuplades,
par esprit religieux, le mangent cru ou boivent sa décoction,
afin de se jeter dans une sorte d’ivresse, qui provoque chez quelques-
uns la joie, l'exaltation, les chants et la danse, tandis que chez
d’autres elle amène la tristesse ; quelquefois même la violence des
excès va jusqu’à jeter les personnes qui sont sous son influence dans
des convulsions de tous les membres, suivies de ce transport qui
accompagne une fièvre brûlante. Trois ou quatre champignons crus
ou délayés dans une décoction A'Epilobium augustifoUum, Lin, ou de
Vaccinium Oxj/coccos, Lin, ou dans une boisson quelconque, sont suffisants
pour une société nombreuse. Les propriétés enivrantes se
communiquent à l'urine des personnes qui en font usage: aussi
arrive-t-il quelquefois que ces mêmes habitants du nord de l’Asie
boivent cette urine pour continuer leur orgie, les domestiques absorbant
celle des maîtres par esprit d’économie. Ainsi donc l’intoxication
produite par cette plante, de même que celle de Talcool, ne va à
rien moins qu'à ôter à l’homme l’usage de son libre arbitre.
Voir: Pallas, Voi/agej dans plusieurs parties de la flussie, 1768, d’après
Paulet, Traité des Champignons, 1793, t. I, p. 486. — Kraschenin-
nikow, Histoire naturelle du Kamschalka, 1776, p. 209. — Lindley,
Veget. Kingdom, 3® édit., 1852. — Muller, in Cens, in Orient und Occident,
1863. — Damaze de .Raymond. Tableau de l’Empire de Russie,
t. II, p. 631, — F.-S. Cordier, les Champignons, Paris, 1876, p. 86-87,
etc.