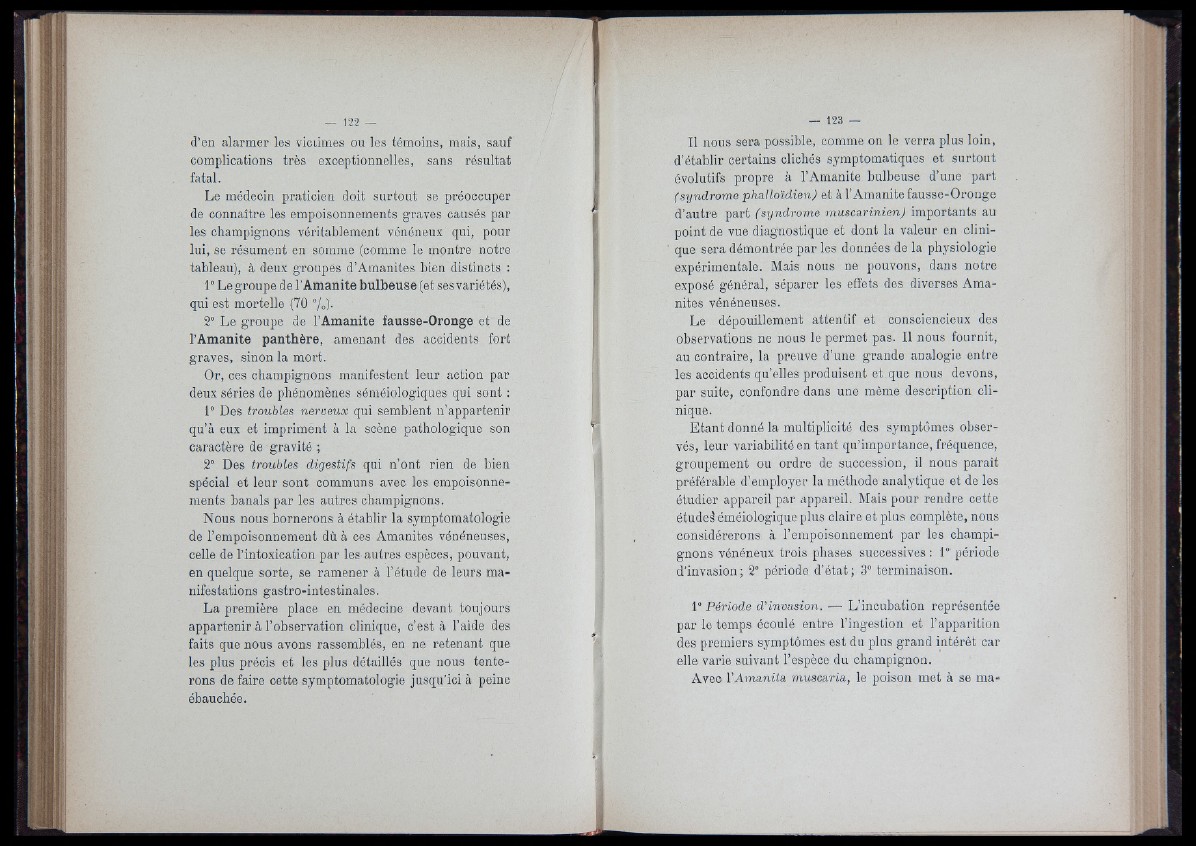
d’en alarmer les viciimes ou les témoins, mais, sauf
complications très exceptionnelles, sans résultat
fatal.
Le médecin praticien doit surtout se préoccuper
de connaître les empoisonnements graves causés par
les champignons véritablement vénéneux qui, pour
lui, se résument en somme (comme le montre notre
tableau), à deux groupes d’Amanites bien distincts :
1” Le groupe de lAmanite bulbeuse (et ses variétés),
qui est mortelle (70 %)•
2° Le groupe de l’Amanite fausse-Oronge et de
l’Amanite panthère, amenant des accidents fort
graves, sinon la mort.
Or, ces champignons manifestent leur action par
deux séries de phénomènes séméiologiques qui sont :
1° Des troubles nerveux qui semblent n ’appartenir
qu’à eux et impriment à la scène pathologique son
caractère de gravité ;
2° Des troubles digestifs qui u’ont rien de bien
spécial et leur sont communs avec les empoisonnements
banals par les autres champignons.
Nous nous bornerons à établir la Symptomatologie
de l’empoisonnement dû à ces Amanites vénéneuses,
celle de l’intoxication par les autres espèces, pouvant,
en quelque sorte, se ramener à l’étude de leurs manifestations
gastro-intestinales.
La première place en médecine devant toujours
appartenir à l’observation clinique, c’est à l’aide des
faits que nous avons rassemblés, en ne retenant que
les plus précis et les plus détaillés que nous tenterons
de faire cette Symptomatologie jusqu’ici à peine
ébauchée.
Il nous sera possible, comme on le verra plus loin,
d’établir certains clichés symptomatiques et surtout
évolutifs propre à l’Amanite bulbeuse d’une part
(syndrome phalloïdien) et k l’xAmanite fausse-Oronge
d’autre part (syndrome muscarinien) importants au
point de vue diagnostique et dont la valeur en clinique
sera démontrée par les données de la physiologie
expérimentale. Mais nous ne pouvons, dans notre
exposé général, séparer les effets des diverses Amanites
vénéneuses.
Le dépouillement attentif et consciencieux des
observations ne nous le permet pas. Il nous fournit,
au contraire, la preuve d’une grande analogie entre
les accidents qu’elles produisent et que nous devons,
par suite, confondre dans une même description clinique.
Ltan t donné la multiplicité des symptômes observés,
leur variabilité en tant qu’importance, fréquence,
groupement ou ordre de succession, il nous paraît
préférable d’employer la méthode analytique et de les
étudier appareil par appareil. Mais pour rendre cette
étudeâ éméiologique plus claire et plus complète, nous
considérerons à l’empoisonnement par les champignons
vénéneux trois phases successives : 1° période
d’invasion; 2° période d’é ta t; 3° terminaison.
1° Période d ’invasion. — L’incubation représentée
par le temps écoulé entre l’ingestion et l’apparition
des premiers symptômes est du plus grand intérêt car
elle varie suivant l’espèce du champignon.
Avec VAmanita muscaria, le poison met à se ma-
' - Y) I
a !
'i l'I
i