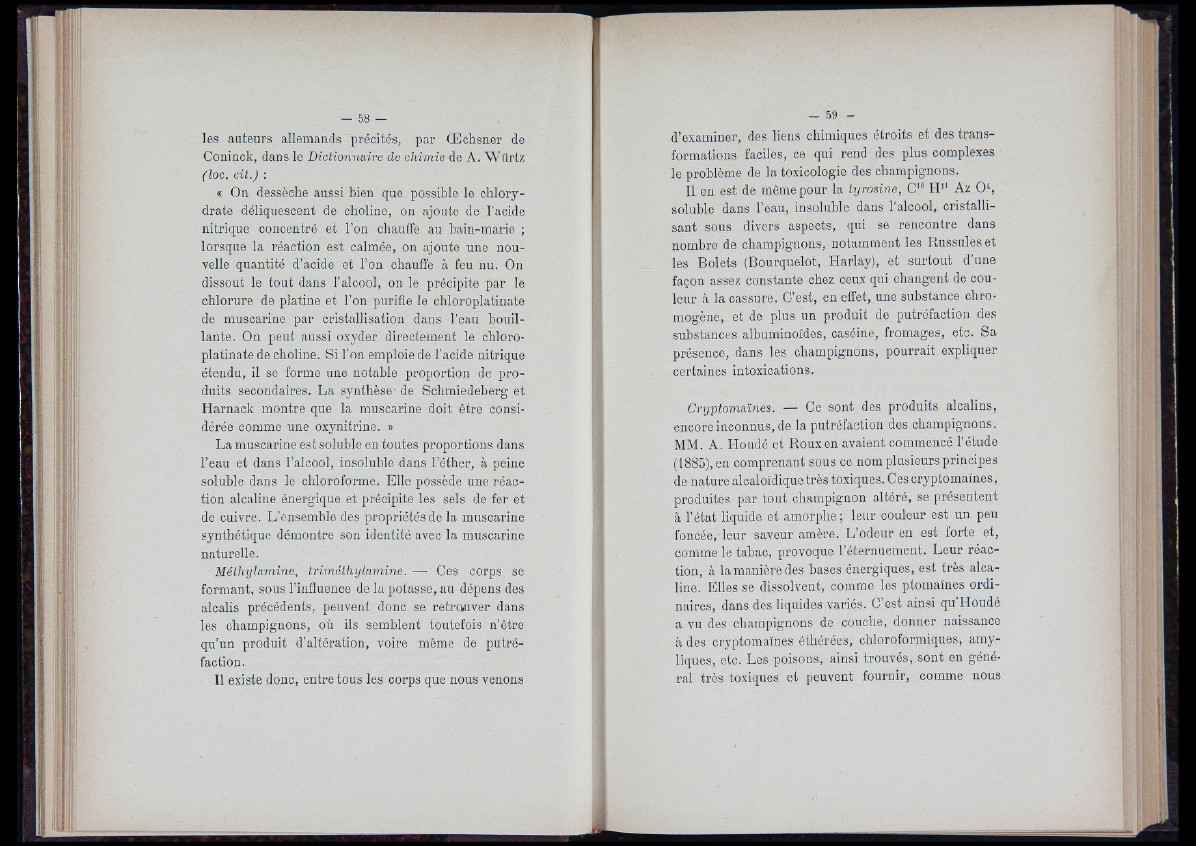
' f
les auteurs allemands précités, par OEchsner de
Coninck, dans le Dictionnaire de chimie de A. W ürtz
(loc. cit.) :
« On dessèche aussi bien que possible le chlory-
drate déliquescent de choline, on ajoute de l ’acide
nitrique concentré et l ’on chauffe au bain-marie ;
lorsque la réaction est calmée, on ajoute une nouvelle
quantité d’acide et l’on chauffe à feu nu. On
dissout le tout dans l’alcool, on le précipite par le
chlorure de platine et l ’on purifie le chloroplatinate
de muscarine par cristallisation dans l ’eau bouillante.
On peut aussi oxyder directement le chloroplatinate
de choline. Si l’on emploie de l’acide nitrique
étendu, il se forme une notable proportion de produits
secondaires. La synthèse’ de Schmiedeberg et
Harnack montre que la muscarine doit être considérée
comme une oxynitrine. »
La muscarine est soluble en toutes proportions dans
l'eau et dans l ’alcool, insoluble dans l ’éther, à peine
soluble dans le chloroforme. Elle possède une réaction
alcaline énergique et précipite les sels de fer et
de cuivre. L ’ensemble des propriétés de la muscarine
synthétique démontre son identité avec la muscarine
naturelle.
Méthylamîne, triméthylamine. — Ces corps se
formant, sous l’influence de la potasse, au dépens des
alcalis précédents, peuvent donc se retrauver dans
les champignons, où ils semblent toutefois n’être
qu’un produit d’altération, voire même de putréfaction.
Il existe donc, entre tous les corps que nous venons
d’examiner, des liens chimiques étroits et des tran sformations
faciles, ce qui rend des plus complexes
le problème de la toxicologie des champignons.
Il en est de même pour la tyrosine, C’® H “ Az OS
soluble dans l’eau, insoluble dans l’alcool, cristallisant
sous divers aspects, qui se rencontre dans
nombre de champignons, notamment les Russules et
les Bolets (Bourquelot, Harlay), et surtout d’une
façon assez constante chez ceux qui changent de couleur
à la cassure. C’est, en effet, une substance chromogène,
et de plus un produit de putréfaction des
substances albuminoîdes, caséine, fromages, etc. Sa
présence, dans les champignons, pourrait expliquer
certaines intoxications.
Cryptomaïnes. — Ce sont des produits alcalins,
encore inconnus, de la putréfaction des champignons.
MM. A. Houdé et Roux en avaient commencé l’étude
(1885), en comprenant sous ce nom plusieurs principes
de nature alcaloïdique très toxiques. Ces cryptomaïnes,
produites par tout champignon altéré, se présentent
à l’état liquide et amorphe ; leur couleur est un peu
foncée,'leur saveur amère. L ’odeur en est forte et,
comme le tabac, provoque l’éternuement. Leur réaction,
à la manière des bases énergiques, est très alcaline.
Elles se dissolvent, comme les ptomaïnes ordinaires,
dans des liquides variés. C’est ainsi qu’Houdé
a vu des champignons de couche, donner naissance
à des cryptomaïnes éthérées, chloroformiques, amy-
liques, etc. Les poisons, ainsi trouvés, sont en général
très toxiques et peuvent fournir, comme nous
.