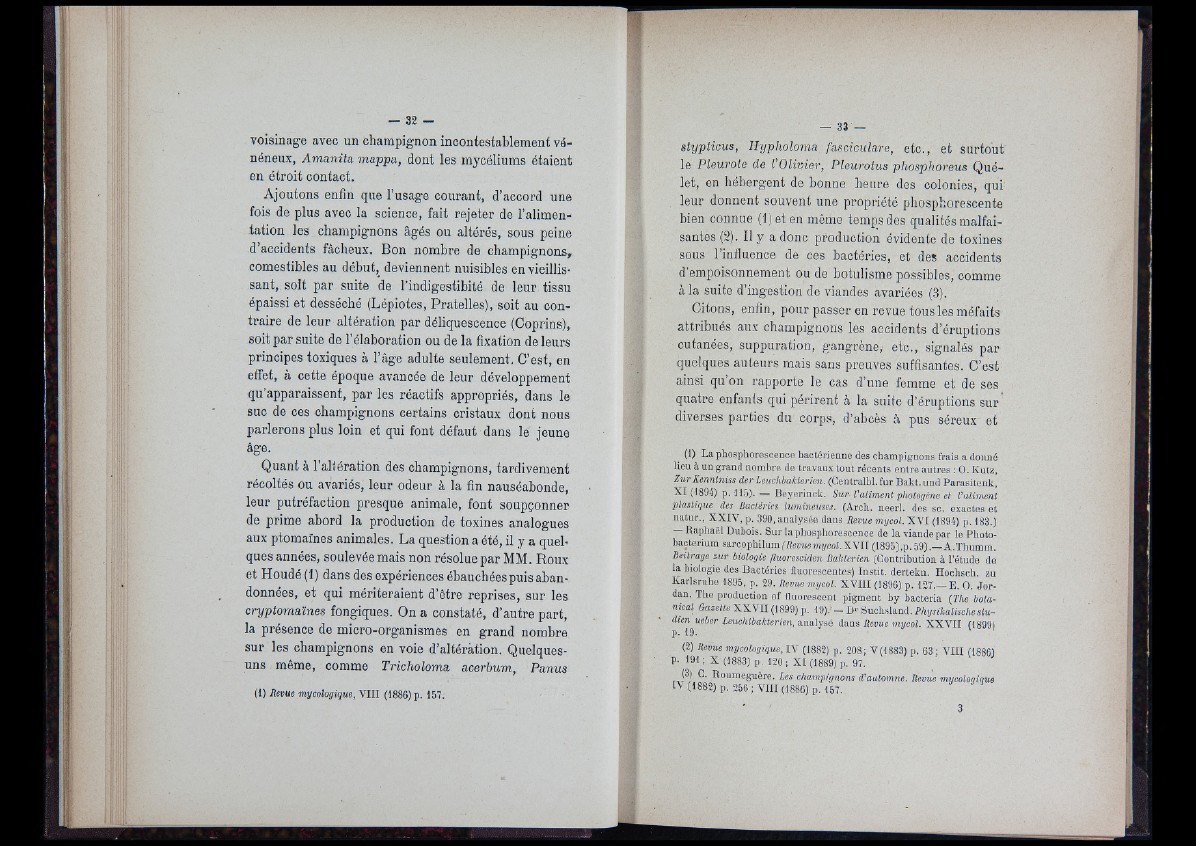
voisinage avec un champignon incontestablement vénéneux,
Amanita mappa, dont les mycéliums étaient
en étroit contact.
Ajoutons enfin que l’usage courant, d’accord une
fois de plus avec la science, fait rejeter de l’alimentation
les champignons âgés ou altérés, sous peine
d’accidents fâcheux. Bon nombre de champignons-,
comestibles au début, deviennent nuisibles en vieillissant,,
soit par suite de l’indigestibité de leur tissu
épaissi et desséché (Lépiotes, Pratelles), soit au contraire
de leur altération par déliquescence (Coprins),
soit par suite de l’élaboration ou de la fixation de leurs
principes toxiques à l’âge adulte seulement. C’est, en
effet, à cette époque avancée de leur développement
qu’apparaissent, p a r les réactifs appropriés, dans le
suc de ces champignons certains cristaux dont nous
parlerons plus loin et qui font défaut dans le jeune
âge.
Quant à l ’aliération des champignons, tardivement
récoltés ou avariés, leur odeur à la fin nauséabonde,
leur putréfaction presque animale, font soupçonner
de prime abord la production de toxines analogues
aux ptomaines animales. La question a été, il y a quelques
années, soulevée mais non résolue par MM. Roux
et Houdé (1) dans des expériences ébauchées puis abandonnées,
et qui mériteraient d’être reprises, sur les
cryptomaïnes fongiques. On a constaté, d’autre part,
la présence de micro-organismes en grand nombre
sur les champignons en voie d’altération. Quelques-
uns même, comme Tricholoma acerbum, Panus
(1) Revue mycologique, VIII (1886) p. 157.
stypticus, Hypholoma fasciculate, etc., et surtout
le Pleurote de l’Olivier, Pleurotus phosphoreus Quélet,
en hébergent de bonne heure des colonies, qui
leur donnent souvent une propriété phosphorescente
bien connue ( l )eten même temps des qualités malfaisantes
(2). Il y a donc production évidente de toxines
sous l ’influence de ces bactéries, et des accidents
d’empoisonnement ou de botulisme possibles, comme
à la suite d’ingestion de viandes avariées (3).
Citons, enfin, pour passer en revue tous les méfaits
attribués aux champignons les accidents d’éruptions
cutanées, suppuration, gangrène, etc., signalés par
quelques auteurs mais sans preuves suffisantes. C’est
ainsi qu’on rapporte le cas d’une femme et de ses
quatre enfants qui périrent à la suite d’éruptions su r'
diverses parties du corps, d’abcès à pus séreux et
(1) La phosphorescence bactérienne des champignons frais a donné
lieu à un grand nombre de travaux tout récents entre autres : 0 . Kutz,
ZurKenniniss der Leuchbakterien. (Gentralbl. fur Bakt.und Parasitenk,
X I (1894) p. 115). — Beyerinck. Sur Valiment photogène et l'aliment
plastique des Bactéries lumineuses. (Arch, neerl. des sc. exactes et
natur., XXIV, p. 390,analysée dans Revue mycol. XVI (1894) p. 183.)
— Raphaël Dubois. Sur la phosphorescence de la viande par le Photo-
baçterium sarcophilum (Revuemycol.XYU (1895),p. 59),—A.Thumm.
Beitrage sur biologie fluoresciden Baliterien (Contribution à l’étude de
la biologie des Bactéries fluorescentes) Instit. dertekn. Hochsch. zu
Karlsruhe 1895, p. 29. Revue mycol. XVIII (1896) p. 127.— E. 0 . Jo rdan.
The production of fluorescent pigment by bacteria (The botanical
Gazette X X V II (1899) p. 19). - D® Suchsland. Physikalischeslu-
dienueber Leuchtbakterien, analysé dans Revue mycol. X X V II (1899)
(2) Revue mycologique, IV (1882) p. 208; V(1883) p. 63; VIII (1886)
p. 191 ; X (1883) p , 120 ; XI (1889) p. 97.
(3) G. Roumeguère. Les champignons d'automne. Revue mycologique
IV(1882)p. 2 5 6 ;V III(I8 8 6 )p . 157.