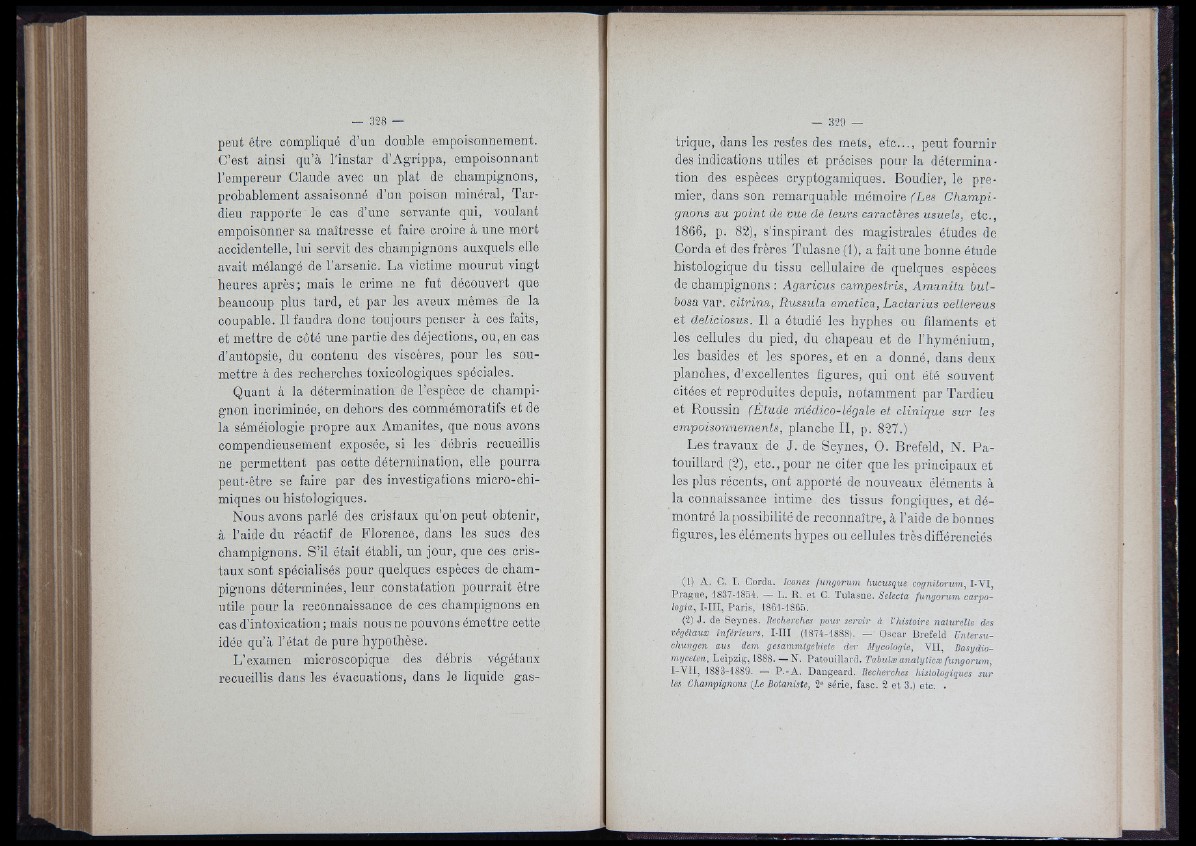
peut être compliqué d’un double empoisonnement.
C’est ainsi qu’à l’instar d’Agrippa, empoisonnant
l ’empereur Claude avec un plat de cbampignons,
probablement assaisonné d’un poison minéral, T a rdieu
rapporte le cas d’une servante qui, voulant
empoisonner sa maîtresse et faire croire à une mort
accidentelle, lui servit des champignons auxquels elle
avait mélangé de l’arsenic. La victime mourut vingt
heures après; mais le crime ne fut découvert que
beaucoup plus tard, et par les aveux mêmes de la
coupable. Il faudra donc toujours penser à ces faits,
et mettre de côté une partie des déjections, ou, en cas
d’autopsie, du contenu des viscères, pour les soumettre
à des recherches toxicologiques spéciales.
Quant à la détermination de l’espèce de champignon
incriminée, en dehors des commémoratifs et de
la séméiologie propre aux Amanites, que nous avons
compendieusement exposée, si les débris recueillis
ne permettent pas cette détermination, elle pourra
peut-être se faire par des investigations micro-chimiques
ou histologiques.
Nous avons parlé des cristaux qu’on peut obtenir,
à l’aide du réactif de Florence, dans les sucs des
champignons. S ’il était établi, un jour, que ces cristaux
sont spécialisés pour quelques espèces de champignons
déterminées, leur constatation pourrait être
utile pour la reconnaissance de ces champignons en
cas d’intoxication ; mais nous ne pouvons émettre cette
idée qu’à l’état de pure hypothèse.
L ’examen microscopique des débris végétaux
recueillis dans les évacuations, dans le liquide gas-
— 329 —
trique, dans les restes des mets, e tc ..., peut fournir
des indications utiles et précises pour la détermination
des espèces cryptogamiques. Boudier, le p re mier,
dans son remarquable mémoire (Les Champignons
au point de vue de leurs caractères usuels, etc.,
1866, p. 82), s’inspirant des magistrales études de
Corda et des frères Tulasne (1), a fait une bonne étude
histologique du tissu cellulaire de quelques espèces
de champignons : Agaricus campestris, Amanita bulbosa
var. citrina, Russula emetica, Lactarius vellereus
et deliciosus. Il a étudié les hyphes ou filaments et
les cellules du pied, du chapeau et de l’byménium,
les basides et les spores, et en a donné, dans deux
planches, d’excellentes figures, qui ont été souvent
citées et reproduites depuis, notamment par Tardieu
et Roussin (Étude médico-légale et clinique sur les
empoisonnements, planche II, p. 827.)
Les travaux de J. de Seynes, 0 . Brefeld, N. P a touillard
(2), etc., pour ne citer que les principaux et
les plus récents, ont apporté de nouveaux éléments à
la connaissance intime des tissus fongiques, et démontré
la possibilité de reconnaître, à l’aide de bonnes
figures, les éléments bypes ou cellules très différenciés
(1) A. G. I. Corda. Icônes fungorum hucusque cognitorum, I-VI,
Praguo, 1837-1854. — L. R, et C. Tulasne. Selecta fungorum carpologia,
I-III, Paris, 1861-1865.
(2) J . de Seynes. Recherches pour servir à l'histoire naturelle des
végétaux inférieurs, I-III (1874-1888). — Oscar Brefeld Untersuchungen
aus dem gesammtgebiete der Mycologie, VH, Basydio-
myceten, Leipzig, 1888. — N. Patouillard. Tabulæ analyticæ fungorum,
I -V ll, 1883-1889. — P.-A . Daugeard. Recherches histologiques sur
les Champignons (Le Botaniste, 2« série, fase. 2 et 3.) etc. .