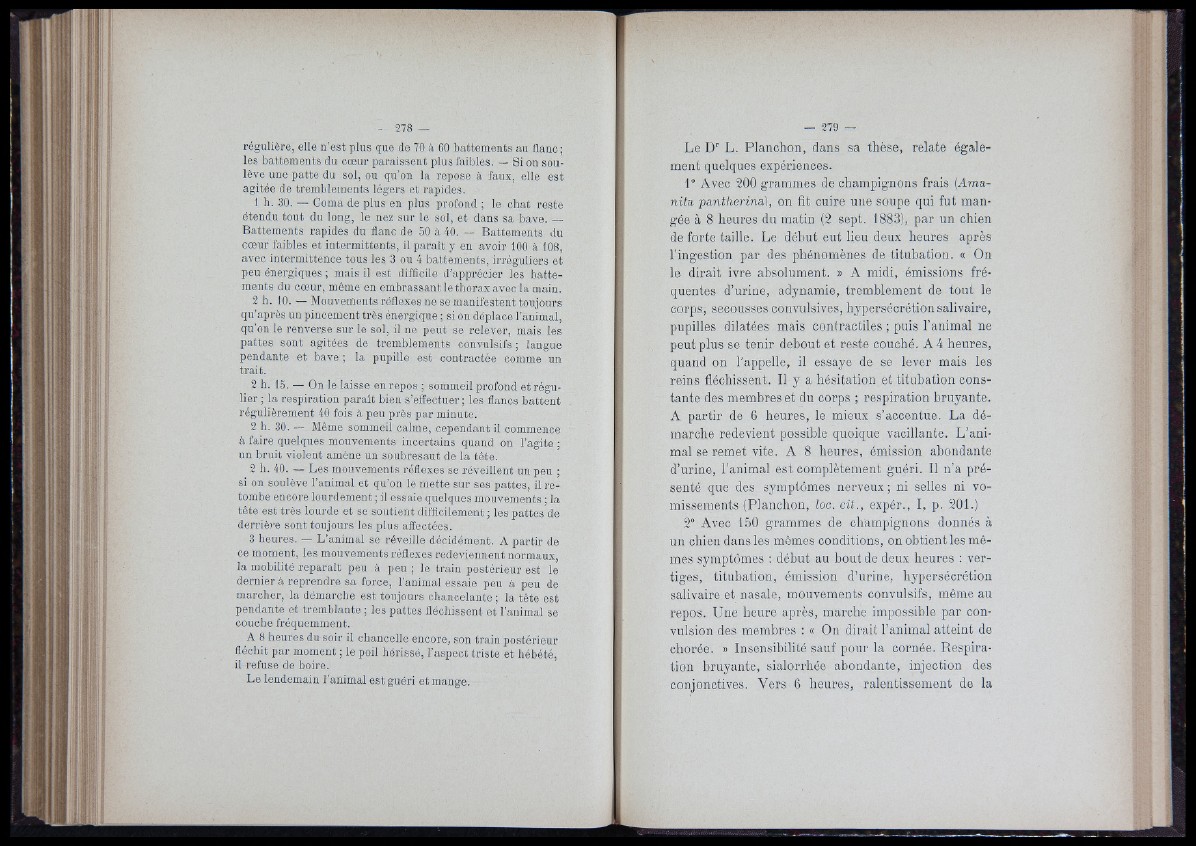
rég u lière , elle n ’e s t plus que de 70 à 60 b a ttem en ts au flanc;
les b a ttem en ts du coeu r p a ra is s en t plus faibles. — Si on soulève
une p a tte du sol, ou qu’on la repose à faux, elle e st
ag itée de trem b lem en ts légers e t rapides.
1 h. 30. — Coma de plus en plus profond ; le ch at re ste
étendu to u t du long, le nez su r le sol, et dans sa bave. —
B a ttem en ts rapides du flanc de 50 à 40. — B a ttem en ts du
coeur faibles e t in te rm itten ts , il p a ra ît y en avoir 100 à 108,
avec in te rm itten c e to u s les 3 ou 4 b a ttem e n ts , irrég u liers et
peu énergiques ; mais il e s t difficile d’ap p réc ie r les b a tte m
en ts du coeur, même en em b ra ss an t le th o rax avec la main.
2 h. 10. — Mouvements réflexes ne se m an ifesten t toujours
q u ’ap rès un p incement très énergique ; si on déplace l’animal,
qu ’on le ren v erse su r le sol, il ne p e u t se re lev e r, mais les
p a tte s so n t ag itées de trem b lem en ts convulsifs ; langue
p en d an te et bave ; la pupille e s t co n tra c té e comme un
tra it.
2 h. 15. — On le laisse en repos ; sommeil profond e t ré g u lie
r ; la re sp iratio n p a ra ît bien s ’effectuer ; les flancs b a tte n t
rég u lièrem en t 40 fois à peu p rè s p a r minute.
2 h. 30. — Même sommeil calme, cep en d an t il commence
à faire quelques mouvements in c e rta in s quand on l’ag ite ;
un b ru it violent amène un so u b re sau t de la tête.
2 h. 40. — L es mouvements réflexes se rév eillen t un peu ;
si on soulève l’animal et qu ’on le mette su r ses p a tte s , il re tombe
encore lo urdem ent ; il essaie quelques mouvements ; la
tê te e st trè s lourde e t se so u tien t difficilement ; les p a tte s de
derrièi'e sont toujours les plus affectées.
3 heu res. — L ’animal se réveille décidément. A p a rtir de
ce moment, les mouvements réflexes red ev ien n en t normaux,
la mobilité re p a ra ît peu à peu ; le tra in p o sté rie u r e st le
d e rn ie r à re p re n d re sa force, l ’animal essaie peu à peu de
m a rch e r, la démarche e st toujours c h a n c e la n te ; la tê te e st
p en d an te et trem b lan te ; les p a tte s fléchissent et l’animal se
couche fréquemment.
A 8 heu res du soir il ch ancelle encore, son tra in p o sté rieu r
fléchit p a r moment ; le poil h é ris sé , l’a sp e c t tris te e t héb été,
il refuse de boire.
L e lendemain l’animal e s t g uéri e t m ange.
Le D“ L. Planchon, dans sa thèse, relate également
quelques expériences.
1° Avec 200 grammes de champignons frais {Amanita
pantherina), on fit cuire une soupe qui fut mangée
à 8 heures du matin (2 sept. 1883), par un chien
de forte taille. Le début eut lieu deux heures après
l’ingestion par des phénomènes de titubation. « On
le dirait ivre absolument. » A midi, émissions fréquentes
d’urine, adynamie, tremblement de tout le
corps, secousses convulsives, hypersécrétion salivaire,
pupilles dilatées mais contractiles ; puis l’animal ne
peut plus se tenir debout et reste couché. A4 heures,
quand on l’appelle, il essaye de se lever mais les
reins fléchissent. H y a hésitation et titubation constante
des membres et du corps ; respiration bruyante.
A partir de 6 heures, le mieux s’accentue. La démarche
redevient possible quoique vacillante. L ’animal
se remet vite. A 8 heures, émission abondante
d’urine, l’animal est complètement guéri. Il n’a présenté
que des symptômes nerveux ; ni selles ni vomissements
(Planchon, loc. cit., expér., I, p. 201.)
2° Avec 150 grammes de champignons donnés à
un chien dans les mêmes conditions, on obtient les mêmes
symptômes : début au bout de deux heures : vertiges,
titubation, émission d’urine, hypersécrétion
salivaire et nasale, mouvements convulsifs, même au
repos. Une heure après, marche impossible par convulsion
des membres : « On dirait l’animal atteint de
chorée. » Insensibilité sauf pour la cornée. Respiration
bruyante, sialorrhée abondante, injection des
conjonctives. Vers 6 heures, ralentissement de la
ü fi.