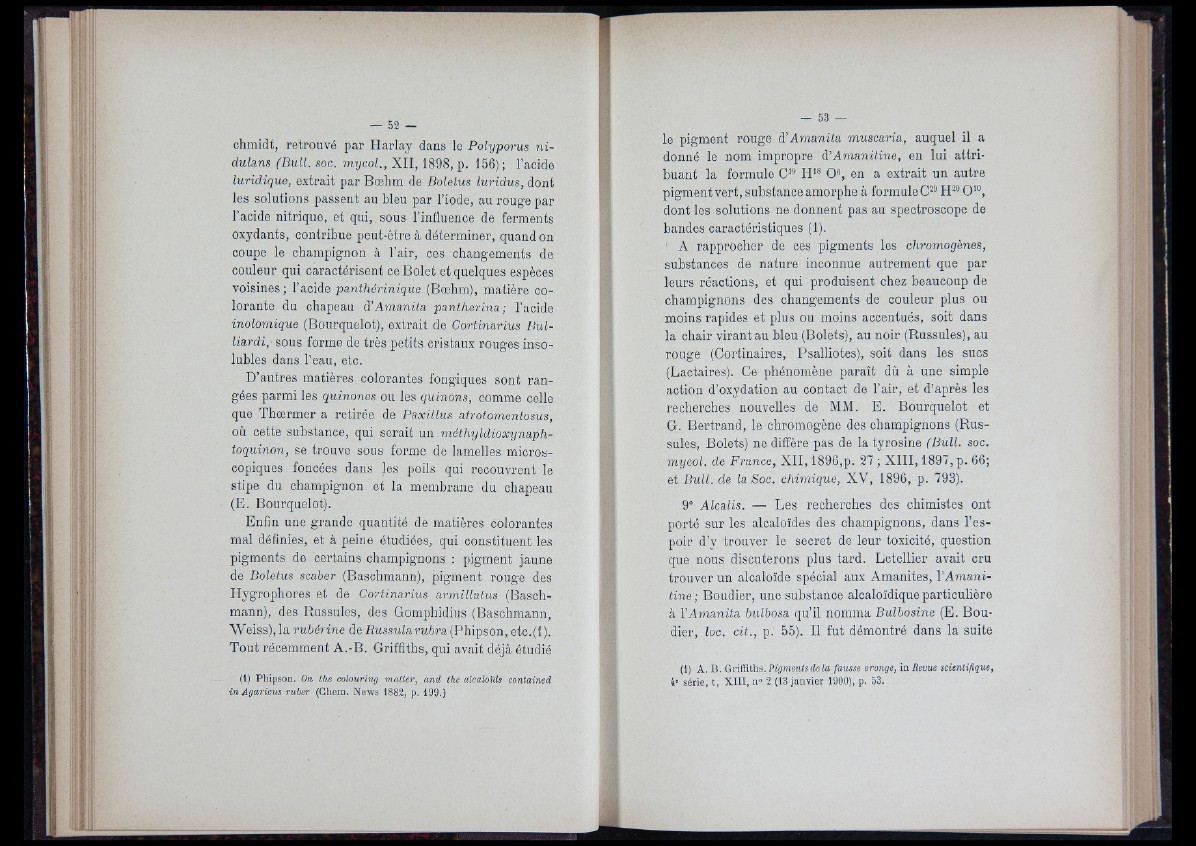
¡h I il ;
chmidt, retrouvé par Harlay dans le Polyporus ni-
dulans (Bull. soc. mycol., XII, 1898, p. 156); l’acide
luridique, extrait par Boehm de Boletus luridus, dont
les solutions passent au bleu par l’iode, au rouge par
l’acide nitrique, et qui, sous l’influence de ferments
oxydants, contribue peut-être à déterminer, quand on
coupe le champignon à l’air, ces changements de
couleur qui caractérisent ce Bolet et quelques espèces
voisines; l’acide panthérinique (Boehm), matière colorante
du chapeau d’Amanita pantherina; l’acide
inolomique (Bourquelot), extrait de Cortinarius Biil-
liardi, sous forme de très petits cristaux rouges insolubles
d;ms l’eau, etc.
D’autres matières colorantes fongiques sont ran gées
parmi les quiñones ou les quinons, comme celle
que Thoermer a retirée de Paxillus atrotomentosus,
où cette substance, qui serait un méthyldioxynaph-
toquinon, se trouve sous forme de lamelles microscopiques
foncées dans les poils qui recouvrent le
stipe du champignon et la membrane du chapeau
(E. Bourquelot).
Enfin une grande quantité de matières colorantes
mal définies, et à peine étudiées, qui constituent les
pigments de certains champignons : pigment jaune
de Boletus scaber (Baschmann), pigment rouge des
Hygrophores et de Cortinarius armillatus (Baschmann),
des Russules, des Gomphidius (Baschmann,
Weiss), la rubérine de RussularubrafPliipson, etc.(l).
Tout récemment A.-B. Griffiths, qui avait déjà étudié
(1) Phipson. On the colouring matter, and the alcaloïds contained
in Agaricus ruber (Ghem. News 1882, p. 199.)
le pigment rouge d’Amanita muscaria, auquel il a
donné le nom impropre d'Amanitine, en lui a ttribuant
la formule C*® H*® O®, en a extrait un autre
pigment vert, substance amorphe à formule H^® 0'®,
dont les solutions ne donnent pas au spectroscope de
bandes caractéristiques (1).
A rapprocher de ces pigments les chromogènes,
substances de nature inconnue autrement que par
leurs réactions, et qui produisent chez beaucoup de
champignons des changements de couleur plus ou
moins rapides et plus ou moins accentués, soit dans
la chair virant au bleu (Bolets), au noir (Russules), au
rouge (Cortinaires, Psalliotes), soit dans les sucs
(Lactaires). Ce phénomène paraît dû à une simple
action d’oxydation au contact de l’air, et d’après les
recherches nouvelles de MM. E. Bourquelot et
G. Bertrand, le chromogène des champignons (Russules,
Bolets) ne diffère pas de la tyrosine (Bull. soc.
mycol. de France, X II, 1896,p. 27 ; X III, 1897, p. 66;
et Bull, de la Soc. chimique, XV, 1896, p. 793).
9° Alcalis. — Les recherches des chimistes ont
porté sur les alcaloïdes des champignons, dans l’espoir
d’y trouver le secret de leur toxicité, question
que nous discuterons plus tard. Letellier avait cru
trouver un alcaloïde spécial aux Amanites, VAmanitine;
Boudier, une substance alcaloïdique particulière
à Y Amanita bulbosa qu’il nomma Bulbosine (E. Boudier,
loc. cit., p. 5,5). Il fut démontré dans la suite
(1) A. B. Griffiths. Pigments de la fausse oronge, in Reme scientifique,
4' série, t, XIII, n» 2 (13 janvier 1900), p. 53.