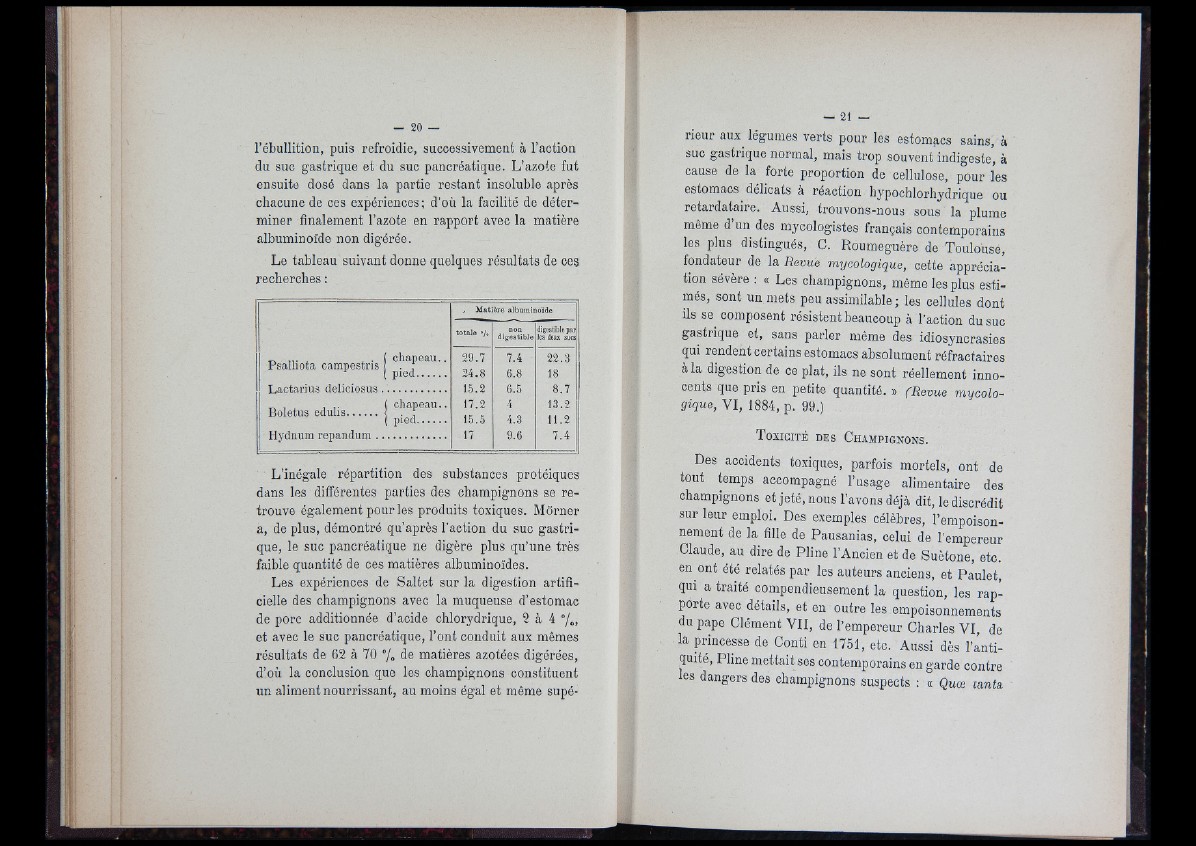
l’ébullition, puis refroidie, successivement à l’action
du suc gastrique et du suc pancréatique. L ’azote fut
ensuite dosé dans la partie restant insoluble après
chacune de ces expériences; d’où la facilité de déterminer
finalement l’azote en rapport avec la matière
albuminoïde non digérée.
Le tableau suivant donne quelques résultats de ces
recherches ;
, Matière albuminoïde
totale o/o non
digestible
digestible par
les deux sucs
P s a llio ta c ampestris
c h a p e a u ..
p ie d ...........
29.7
24.8
7.4
6.8
22.3
18
L a c ta riu s deliciosus . ............... 15.2 6.5 8.7
B o letu s ed u lis ...........
c h a p e a u ..
p ied ...........
17.2
15.5
4
4.3
13.2
11.2
Hydnum rep an d um .. 17 9.6 7.4
L ’inégale répartition des substances protéiques
dans les différentes parties des champignons se retrouve
également pour les produits toxiques. Môrner
a, de plus, démontré qu’après l ’action du suc gastrique,
le suc pancréatique ne digère plus qu’une très
faible quantité de ces matières albuminoîdes.
Les expériences de Saltet sur la digestion artificielle
des champignons avec la muqueuse d’estomac
de porc additionnée d’acide chlorydrique, 2 à 4 7».
et avec le suc pancréatique, l’ont conduit aux mêmes
résultats de 62 à 70 7» de matières azotées digérées,
d’où la conclusion que les champignons constituent
un aliment nourrissant, au moins égal et même supérieur
aux^ légumes verts pour les estomacs sains, à
suc gastrique normal, mais trop souvent indigeste, à
cause de la forte proportion de cellulose, pour les
estomacs délicats à réaction hypochlorhydrique ou
retardataire. Aussi, trouvons-nous sous la plume
même d un des mycologistes français contemporains
les plus distingués, G. Roumeguère de Toulouse,
fondateur de la Revue mycologique, cette appréciation
sévère : « Les champignons, même les plus estimés,
sont un mets peu assimilable ; les cellules dont
ils se composent résistent beaucoup à l’action du suc
gastrique et, sans parler même des idiosyncrasies
qui rendent certains estomacs absolument réfractaires
à la digestion de ce plat, ils ne sont réellement innocents
que pris en petite quantité. » (Revue mycologique,
VI, 1884, p. 99.)
T oxicité d e s C h am p ig n o n s .
Des accidents toxiques, parfois mortels, ont de
tout temps accompagné l’usage alimentaire des
champignons et jeté, nous l’avons déjà dit, lediscrédit
sur leur emploi. Des exemples célèbres, l’empoisonnement
de la fille de Pausanias, celui de l ’empereur
Claude, au dire de Pline l ’Ancien et de Suétone, etc.
en ont été relatés par les auteurs anciens, et Paulet,
qui a traité compendieusement la question, les rap porte
avec détails, et en outre les empoisonnements
du pape Clément VII, de l’empereur Charles VI, de
la princesse de Conti en 1751, etc. Aussi dès l’antiquité,
Pline mettait ses contemporains en garde contre
les dangers des champignons suspects : « Quoe lanta