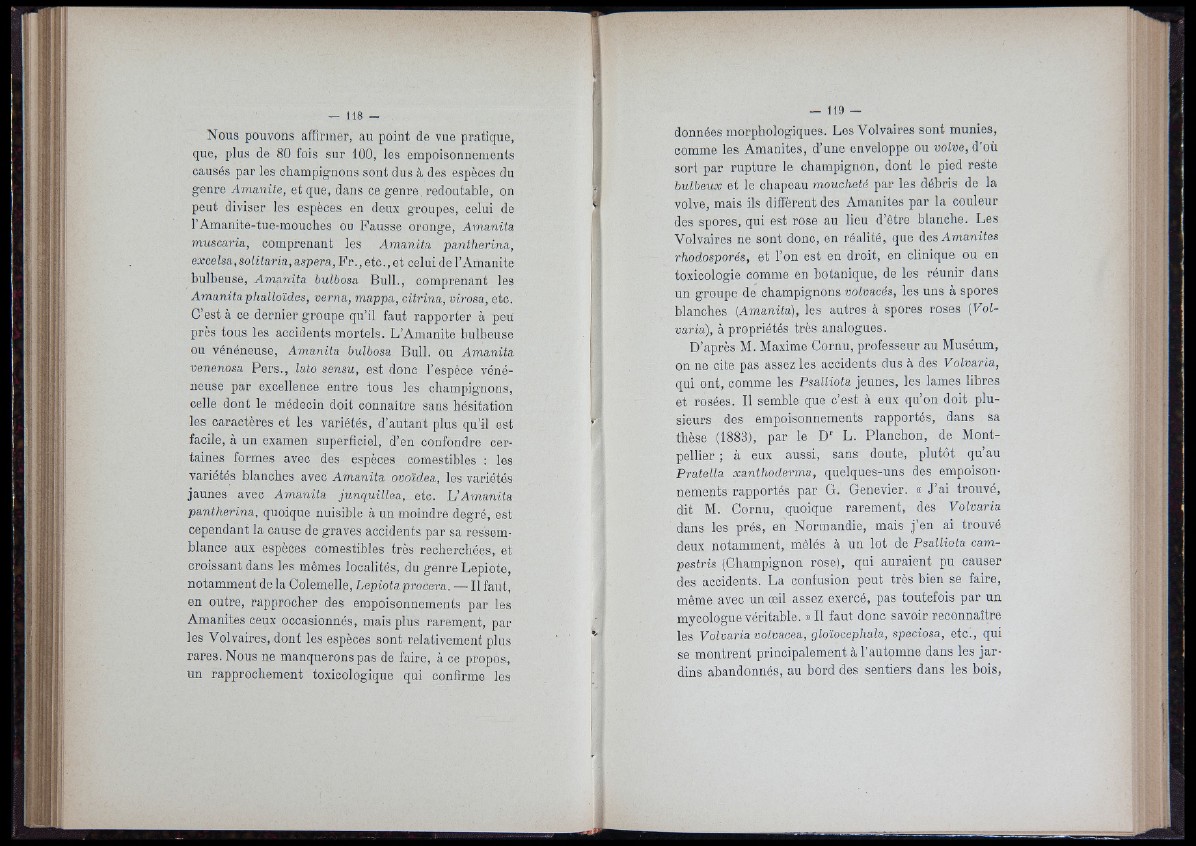
Nous pouvons affirmer, au point de vue pratique,
que, plus de 80 fois sur 100, les empoisonnements
causés par les champignons sont dus à des espèces du
genre Amanite, et que, dans ce genre redoutable, on
peut diviser les espèces en deux groupes, celui de
l’Amanite-tue-mouches ou Fausse oronge, Amanita
muscaria, comprenant les Amanita pantherina,
excelsa,solitaria,aspera,Fr.,etc.,et celui de l’Amanite
bulbeuse, Amanita bulbosa Bull., comprenant les
Amanita phalloïdes, verna, mappa, citrina, virosa, etc.
C’est à ce dernier groupe qu’il faut rapporter à peu
près tous les accidents mortels. L ’Amanite bulbeuse
ou vénéneuse, Amanita bulbosa Bull, ou Amanita
venenosa P e rs., lato sensu, est donc l’espèce vénéneuse
par excellence entre tous les champignons,
celle dont le médecin doit connaître sans hésitation
les caractères et les variétés, d’autant plus qu’il est
facile, à un examen superficiel, d’en confondre certaines
formes avec des espèces comestibles : les
variétés blanches avec Amanita ovoidea, les variétés
jaunes avec Amanita junquillea, etc. L ’Amanita
pantherina, quoique nuisible à un moindre degré, est
cependant la cause de graves accidents par sa ressemblance
aux espèces comestibles très recherchées, et
croissant dans les mêmes localités, du genre Lepiote,
notamment de la Colemelle, Lepiota procera. — Il faut,
en outre, rapprocher des empoisonnements par les
Amanites ceux occasionnés, mais plus rarement, par
les Volvaires, dont les espèces sont relativement plus
rares. Nous ne manquerons pas de faire, à ce propos,
un rapprochement toxicologique qui confirme les
données morphologiques. Les Volvaires sont munies,
comme les Amanites, d’une enveloppe ou volve, d’où
sort par rupture le champignon, dont le pied reste
bulbeux et le chapeau moucheté par les débris de la
volve, mais ils diffèrent des Amanites par la couleur
des spores, qui est rose au lieu d’être blanche. Les
Volvaires ne sont donc, en réalité, que des Amaniies
rhodosporés, et l’on est en droit, en clinique ou en
toxicologie comme en botanique, de les réunir dans
un groupe de champignons volvacés, les uns à spores
blanches (Amanita), les autres à spores roses {Volvaria),
à propriétés très analogues.
D’après M. Maxime Cornu, professeur au Muséum,
on ne cite pas assez les accidents dus à des Volvaria,
qui ont, comme les Psalliota jeunes, les lames libres
et rosées. Il semble que c’est à eux qu’on doit plusieurs
des empoisonnements rapportés, dans sa
thèse (1883), par le D® L. Planchón, de Montpellier
; à eux aussi, sans doute, plutôt qu’au
Pratella xanthoderma, quelques-uns des empoisonnements
rapportés par G. Genevier. « J ’ai trouvé,
dit M. Cornu, quoique rarement, des Volvaria
dans les prés, en Normandie, mais j ’en ai trouvé
deux notamment, mêlés à un lot de Psalliota campestris
(Champignon rose), qui auraient pu causer
des accidents. La confusion peut très bien se faire,
même avec un oeil assez exercé, pas toutefois par un
mycologue véritable, » Il faut donc savoir reconnaître
les Volvaria volvacea, gloïocephala, speciosa, etc., qui
se montrent principalement à l ’automne dans les j a r dins
abandonnés, au bord des sentiers dans les bois.