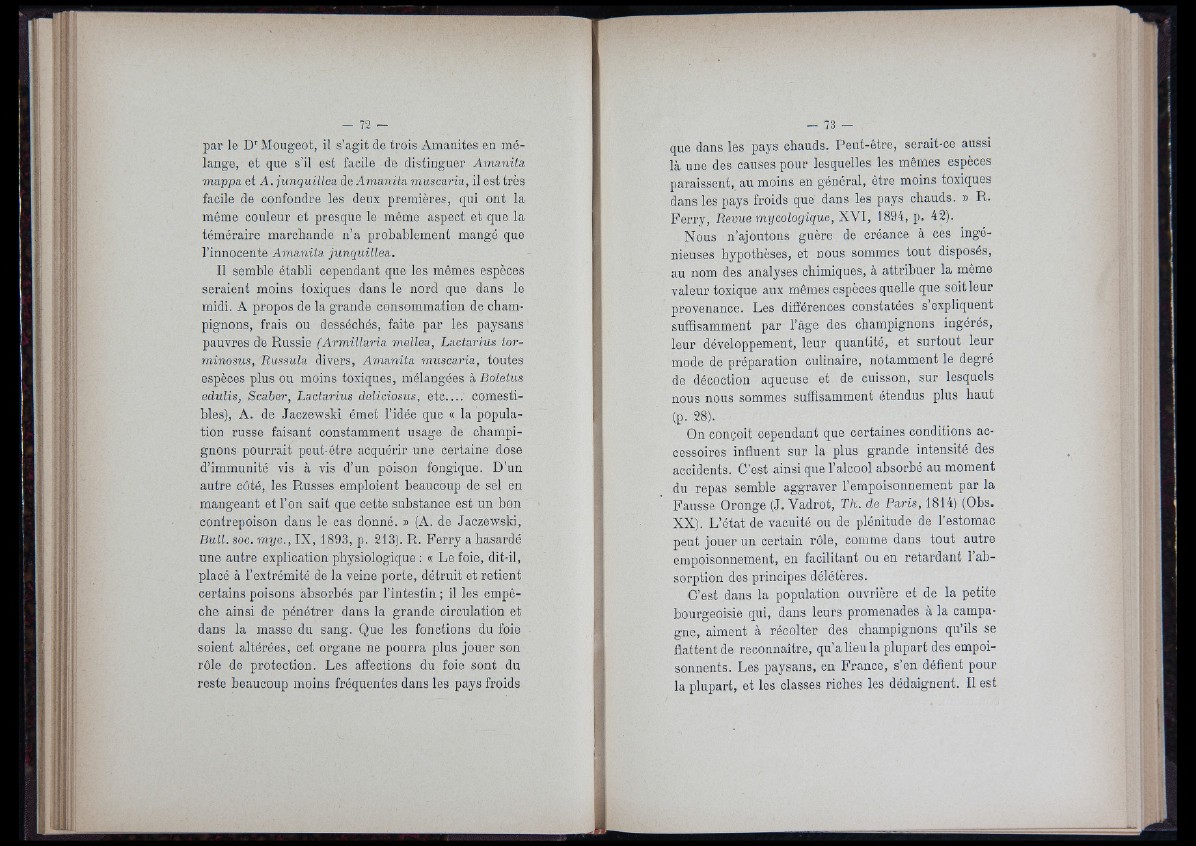
par le D'' Mougeot, il s’agit de trois Amanites en mélange,
et que s’il est facile de distinguer Amanita
mappa et A. junquillea do Amanita muscaria, il est très
facile de confondre les deux premières, qui ont la
même couleur et presque le même aspect et que la
téméraire marchande n’a probablement mangé que
l’innocente Amanita junquillea.
Il semble établi cependant que les mêmes espèces
seraient moins toxiques dans le nord que dans le
midi. A propos de la grande consommation de champignons,
frais ou desséchés, faite par les paysans
pauvres de Russie (ArmiUaria mellea, Lactarius tor-
minosus. Russula divers, Amanita muscaria, toutes
espèces plus ou moins toxiques, mélangées à Boletus
edulis, Scaber, Lactarius deliciosus, etc comestibles),
A. de Jaczewski émet l’idée que « la population
russe faisant constamment usage de champignons
pourrait peut-être acquérir une certaine dose
d’immunité vis à vis d’un poison fongique. D’un
autre côté, les Russes emploient beaucoup de sel en
mangeant et l’on sait que cette substance est un bon
contrepoison dans le cas donné. » (A. de Jaczewski,
Bull. soc. myc., IX, 1893, p. 213). R. Ferry a hasardé
une autre explication physiologique : « Le foie, dit-il,
placé à l’extrémité de la veine porte, détruit et retient
certains poisons absorbés par l’intestin ; il les empêche
ainsi de pénétrer dans la grande circulation et
dans la masse du sang. Que les fonctions du foie
soient altérées, cet organe ne pourra plus jouer son
rôle de protection. Les affections du foie sont du
reste beaucoup moins fréquentes dans les pays froids
- v a que
dans les pays chauds. Peut-être, serait-ce aussi
là une des causes pour lesquelles les mêmes espèces
paraissent, au moins en général, être moins toxiques
dans les pays froids que dans les pays chauds. » R.
Ferry, R e v u e mycologique, XVI, 1894, p. 42).
Nous n ’ajoutons guère de créance à ces ingénieuses
hypothèses, et nous sommes tout disposés,
au nom des analyses chimiques, à attribuer la même
valeur toxique aux mêmes espèces quelle que soit leur
provenance. Les différences constatées s’expliquent
suffisamment par l’âge des champignons ingérés,
leur développement, leur quantité, et surtout leur
mode de préparation culinaire, notamment le degré
de décoction aqueuse et de cuisson, sur lesquels
nous nous sommes suffisamment étendus plus haut
(p. 28).
On conçoit cependant que certaines conditions accessoires
influent sur la plus grande intensité des
accidents. C’est ainsi que l’alcool absorbé au moment
du repas semble aggraver l’empoisonnement par la
Fausse Oronge (J. Vadrot, Th. de Paris, 1814) (Obs.
XX). L ’état de vacuité ou de plénitude de l’estomac
peut jouer un certain rôle, comme dans to u t autre
empoisonnement, en facilitant ou en retardant l’absorption
des principes délétères.
C’est dans la population ouvrière et de la petite
bourgeoisie qui, dans leurs promenades à la campagne,
aiment à récolter des champignons qu’ils se
flattent de reconnaître, qu’a lieu la plupart des empoi-
sonnents. Les paysans, en France, s’en défient pour
la plupart, et les classes riches les dédaignent. Il est
Í