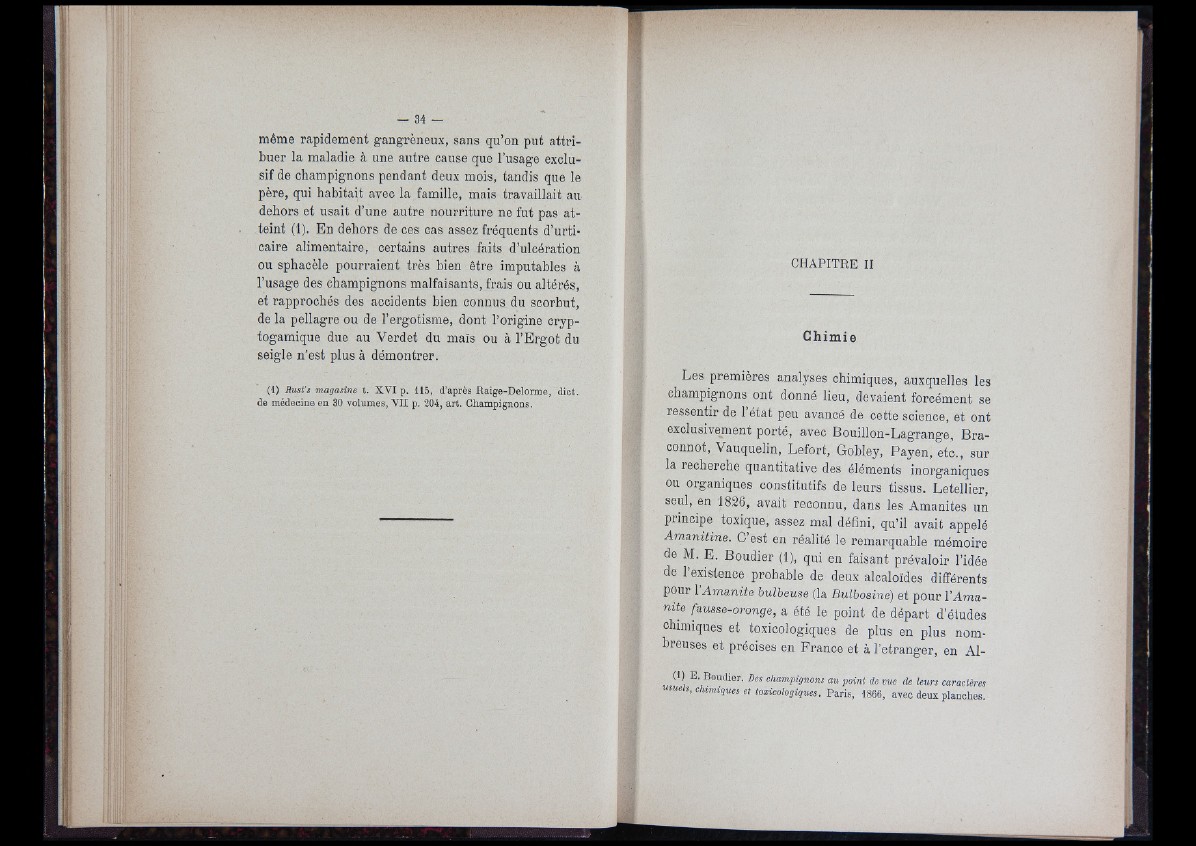
T
même rapidement gangrèneux, sans qu’on put a ttribuer
la maladie à une autre cause que l’usage exclusif
de champignons pendant deux mois, tandis que le
père, qui habitait avec la famille, mais travaillait au
dehors et usait d’une autre nourriture ne fut pas a tteint
(1). En dehors de ces cas assez fréquents d’u rticaire
alimentaire, certains autres faits d’ulcération
ou sphacèle pourraient très bien être imputables à
l’usage des champignons malfaisants, frais ou altérés,
et rapprochés des accidents bien connus du scorbut,
de la pellagre ou de l’ergotisme, dont l’origine cryp-
togamique due au Verdet du maïs ou à l’Ergot du
seigle n ’est plus à démontrer.
(1) Rust’s magasine t. XVI p. H5, d’après Raige-Delorme, diet,
de médecine en 30 volumes, VII p. 204, art. Champignons.
CH A P IT R E II
Chimie
Les premières analyses chimiques, auxquelles les
champignons ont donné lieu, devaient forcément se
ressentir de 1 état peu avancé de cette science, et ont
exclusivement porté, avec Bouillon-Lagrange, Bra-
connot, Vauquelin, Lefort, Gobley, Payen, etc., sur
la recherche quantitative des éléments inorganiques
ou organiques constitutifs de leurs tissus. Letellier,
seul, en 1826, avait reconnu, dans les Amanites un
principe toxique, assez mal défini, qu’il avait appelé
Amanitine. C’est en réalité le remarquable mémoire
de M. E. Boudier (1), qui en faisant prévaloir l’idée
de l’existence probable de deux alcaloïdes différents
pour l ’Amanite bulbeuse (la Bulbosine) et pour l'Am a nite
fausse-oronge, a été le point de départ d’études
chimiques et toxicologiques de plus en plus nombreuses
et précises en France et à l'etrange r, en Al-
(1) E. Boudier. Des champignons au point de vue de leurs caractères
chimiques et toxicologiques. Paris, 1866, avec deux planches.