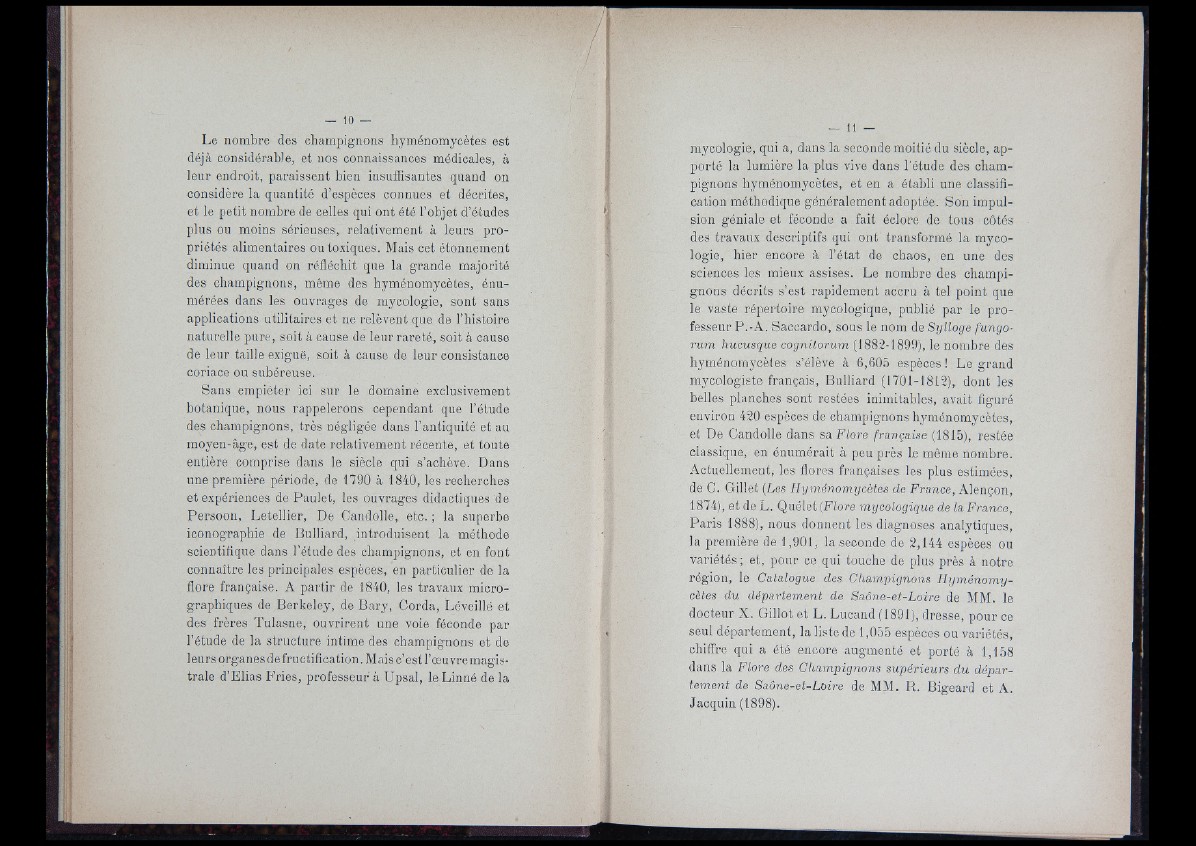
Le nombre des champignons hyménomycètes est
déjà considérable, et nos connaissances médicales, à
leur endroit, paraissent bien insuffisantes quand on
considère la quantité d’espèces connues et décrites,
et le petit nombre de celles qui ont été l’objet d’études
plus ou moins sérieuses, relativement à leurs propriétés
alimentaires ou toxiques. Mais cet étonnement
diminue quand on réfléchit que la grande majorité
des champignons, même des hyménomycètes, énumérées
dans les ouvrages de mycologie, sont sans
applications utilitaires et ne relèvent que de l’histoire
naturelle pure, soit à cause de leur rareté, soit à cause
de leur taille exiguë, soit à cause de leur consistance
coriace ou subéreuse.
Sans empiéter ici sur le domaine exclusivement
botanique, nous rappelerons cependant que l’étude
des champignons, très négligée dans l’antiquité et au
moyen-âge, est de date relativement récente, et toute
entière comprise dans le siècle qui s’achève. Dans
une première période, de 1790 à 1840, les recherches
et expériences de Paulet, les ouvrages didactiques de
Persoon, Letellier, De Candolle, etc. ; la superbe
iconographie de Bulliard, introduisent la méthode
scientilique dans l’étude des champignons, et en font
connaître les principales espèces, en particulier de la
flore française. A partir de 1840, les travaux micrographiques
de Berkeley, de Bary, Corda, Léveillé et
des frères Tulasne, ouvrirent une voie féconde par
l’étude de la structure intime des champignons et de
leurs organes de fructification .Mais c’est l’oeuvre magistrale
d’Elias Fries, professeur à Upsal, le Linné de la
mycologie, qui a, dans la seconde moitié du siècle, apporté
la lumière la plus vive dans l ’étude des champignons
hyménomycètes, et en a établi une classification
méthodique généralement adoptée. Son impulsion
géniale et féconde a fait éclore de tous côtés
des travaux descriptifs qui ont transformé la mycologie,
hier encore à l’état de chaos, en une des
sciences les mieux assises. Le nombre des champignons
décrits s’est rapidement accru à tel point que
le vaste répertoire mycologique, publié par le professeur
P.-A. Saccardo, sous le nom de Sylloge fungo-
rum hucusque oegnilorum (1882-1899), le nombre des
hyménomycètes s’élève à 6,605 espèces ! Le grand
mycologiste français, Bulliard (1701-1812), dont les
belles planches sont restées inimitables, avait figuré
environ 420 espèces de champignons hyménomycètes,
et De Candolle dans sa Flore française (1815), restée
classique, en énumérait à peu près le même nombre.
Actuellement, les flores françaises les plus estimées,
de G. Gillet {Les Hyménomycètes de France, Alençon,
1874), et de L. Quélet {Flore mycologique de la France,
Paris 1888), nous donnent les diagnoses analytiques,
la première de 1,901, la seconde de 2,144 espèces ou
variétés ; et, pour ce qui touche de plus près à notre
région, le Catalogue des Champignons Hyménomycètes
du département de Saône-et-Loire de MM. le
docteur X. Gillot et L. Lucand (1891), dresse, pour ce
seul département, la liste de 1,055 espèces ou variétés,
chiffre qui a été encore augmenté et porté à 1,158
dans la Flore des Champignons supérieurs du département
de Saône-et-Loire de MM. R. Bigeard et A.
Jacquin (1898).