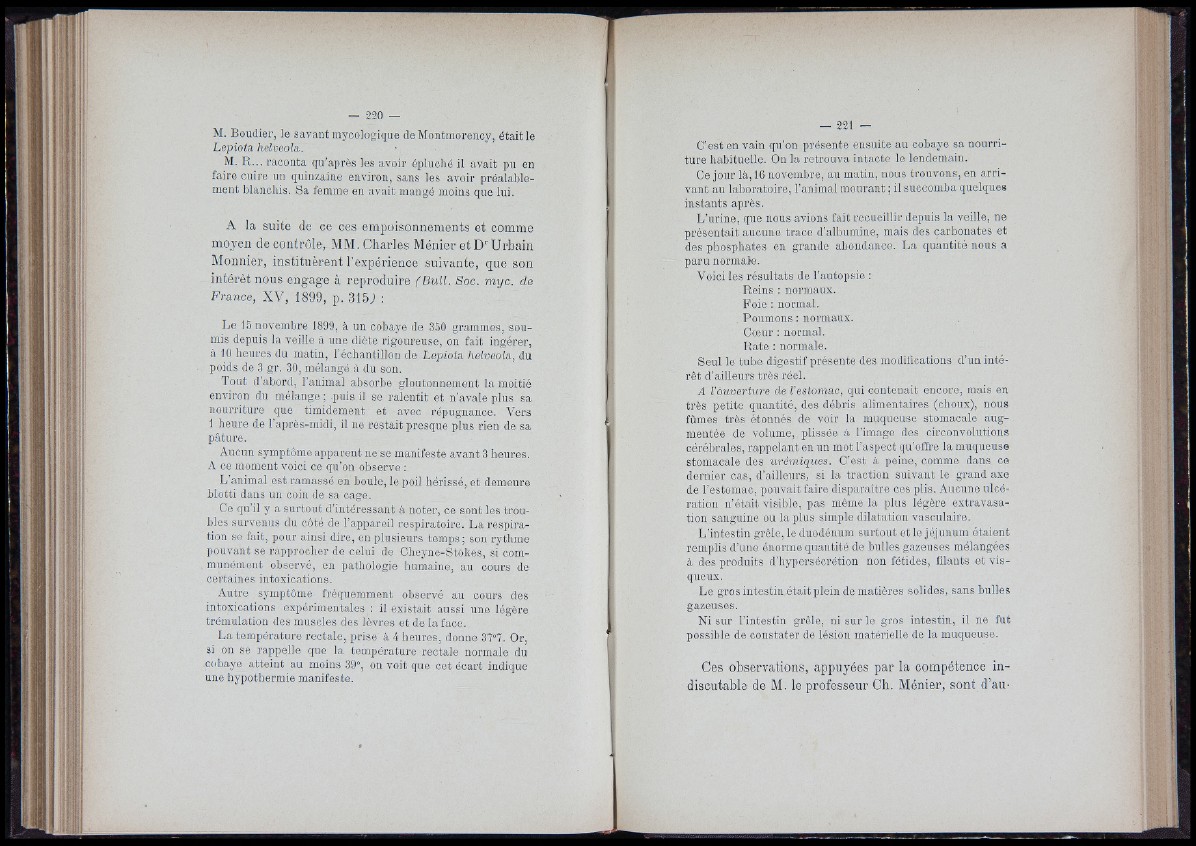
M. Boudier, le s a v a n t m ycologique de Montmorency, é ta it le
Lepiota helveola.
M. R ... ra co n ta q u 'ap rès les av o ir épluché il av a it pu en
fa ire cuire un quinzaine environ, sans les av o ir p ré a lab le m
en t blanchis. Sa femme en av a it mangé moins que lui.
A la suite de ce ces empoisonnements et comme
moyen de contrôle, MM. Charles Ménier et D'’ U rbain
Monnier, instituèrent l'expérience suivante, que son
intérêt nous engage à reproduire (Bull. Soc. mxjc. de
France, XV, 1899, p. 315; :
L e 15 novembre 1899, à un cobaye de 350 grammes, soumis
depuis la veille à une diète rigo u reu se, on fait in gérer,
à 10 h eu res du matin , l’é ch an tillo n de Lepiota helveola, du
poids de 3 gr, 30, mélangé à du son.
To u t d ’abord, l’animal absorbe glo u to n n em en t la moitié
environ du mélange ; puis il se ra le n tit e t n ’avale plus sa
n o u rritu re que timidement et avec rép u gnance. Vers
1 h eu re de l’après-m id i, il ne re s ta it p re sq u e p lu s rien de sa
p â tu re .
Aucun symptôme a p p a re n t ne se manifeste a v an t 3 heu res.
A ce moment voici ce qu ’on o bserve :
L ’animal e st ram a ss é en boule, le poil h é rissé, et demeure
b lo tti dans un coin de sa cage.
Ce qu ’il y a su rto u t d’in té re s s a n t à n o ter, ce sont les tro u bles
surv en u s du côté de l’ap p are il re sp ira to ire . L a re sp ira tion
se fait, p o u r ainsi dire, en p lu sieu rs tem p s; son ry thme
p o u v a n t se rap p ro ch e r de celui de C h ey n e-S to k e s, si communément
observé, en pathologie humaine, au cours de
c e rta in e s in to x ications.
A u tre symptôme fréquemment observé au cours des
into x ic atio n s ex p érimen tale s ; il e x is ta it au ssi une légère
trém u latio n des muscles des lèvres e t de la face.
L a tem p é ra tu re re c ta le , p rise à 4 h eu re s, donne 37"7. Or,
si on se rap p elle que la tem p é ra tu re re c ta le normale du
cobaye a tte in t au moins 39°, on voit que c et é c a rt indique
une hyp o th erm ie manifeste.
C’e st en vain qu ’on p ré sen te en su ite au cobaye sa n o u rritu
re h ab ituelle. On la re tro u v a in ta c te le lendemain.
Ce jo u r là, 16 novembre, au matin, nous tro u v o n s, en a r r iv
a n t au lab o ra to ire , l’animal m o u ran t ; il succomba quelques
in s ta n ts ap rès.
L ’u rin e, que nous avions fait re cu e illir depuis la veille, ne
p ré s e n ta it aucune tra c e d ’albumine, mais des c arb o n a te s et
des p h o sp h a tes en g rande abondance. L a q u an tité nous a
p a ru normale.
Voici les ré su lta ts de l’auto p sie :
Reins ; normaux.
Foie : normal.
Poumons : normaux.
Coeur : normal.
R a te : normale.
Seul le tu b e d ig estif p ré sen te des modifications d ’un in té r
ê t d’ailleu rs trè s réel.
A l’ouverture de l’estomac, qui co n ten a it encore, mais en
trè s p e tite q u a n tité , des débris a lim en taire s (choux), nous
fûmes trè s éto n n é s de voir la muqueuse stomacale a u g m
en té e de volume, plissée à l’image des circonvolutions
céréb rales, ra p p e lan t en un mot l ’a sp e c t qu’offre la m uqueuse
stom ac ale des urémiques. C’e s t à peine, comme dans ce
de rn ie r cas, d ’ailleurs, si la tra c tio n su iv an t le grand axe
de l’e stomac, pou v a it faire d isp a ra ître ces plis. Aucune u lc é ra
tio n n ’é ta it visible, pas même la plus lég è re e x tra v a s a tio
n sanguine ou la plus simple d ila tatio n v a scu la ire .
L ’in te stin grêle, le duodénum su rto u t e t le jéju n um é ta ien t
remplis d’une énorme q u an tité de bulles gazeuses mélangées
à des pro d u its d ’h y p e rséc ré tio n non fétides, filants et v is queux.
L e gros in te s tin é ta it plein de m atières solides, sans bulles
gazeuses.
Ni su r l’in te stin grêle, ni su r le gros in te s tin , il ne fut
possible de c o n s ta te r de lésion m até rie lle de la muqueuse.
Ces observations, appuyées par la compétence indiscutable
de M. le professeur Cb. Ménier, sont d’au ï'i
II
■m-
I
'’ii ■
V ’
Ili
i;
[;S
i - .