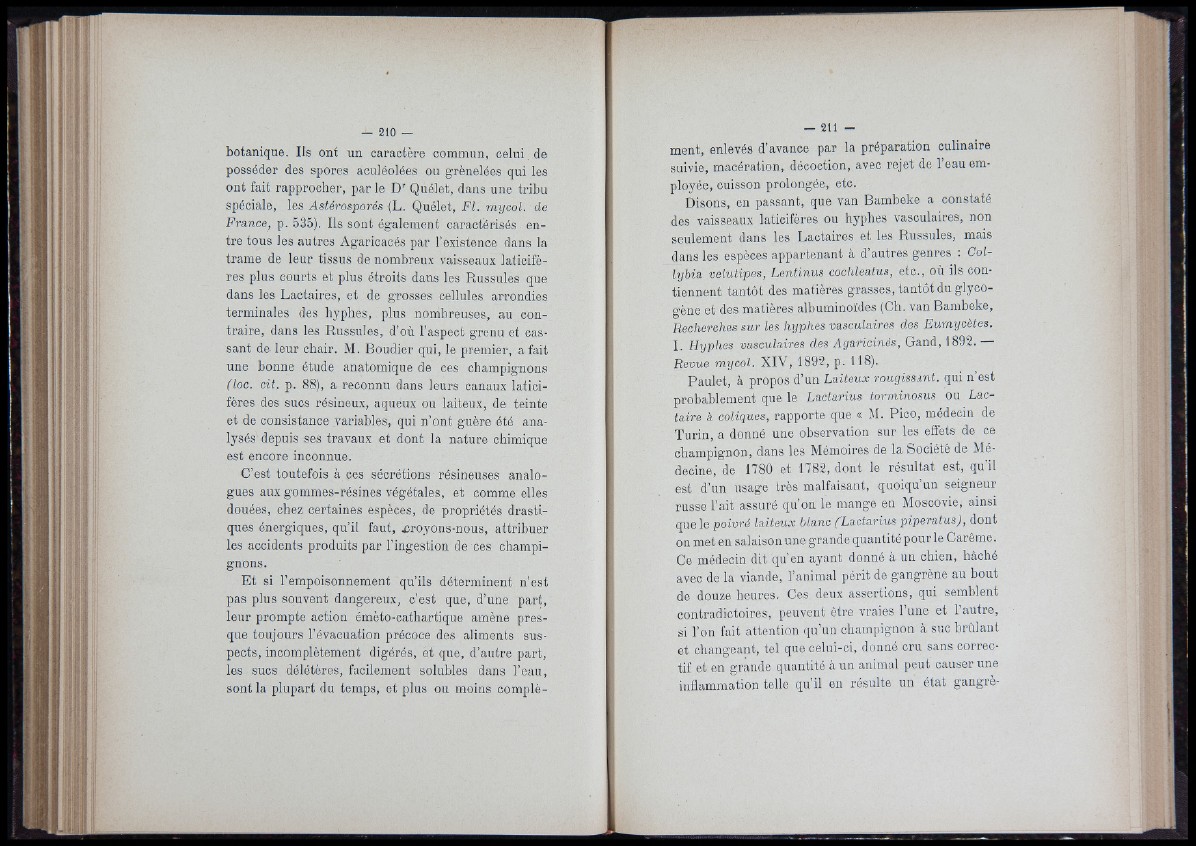
botanique. Ils ont un caractère commun, celui, de
posséder des spores aciiléolées ou grènelées qui les
ont fait rapprocher, par le D'' Quélet, dans une tribu
spéciale, les Astérosporés (L. Quélet, Fl. mxjcol. de
France, p. 535). Ils sont également caractérisés entre
tous les autres Agaricacés par l’existence dans la
trame de leur tissus de nombreux vaisseaux laticifè-
res plus courts et plus étroits dans les Russules que
dans les Lactaires, et de grosses cellules arrondies
terminales des hj^phes, plus nombreuses, au contraire,
dans les Russules, d’où l’aspect grenu et cassant
de leur chair. M. Boudier qui, le premier, a fait
une bonne étude anatomique de ces champignons
(loc. cit. p. 88), a reconnu dans leurs canaux latici-
fères des sucs résineux, aqueux ou laiteux, de teinte
et de consistance variables, qui n ’ont guère été analysés
depuis ses travaux et dont la nature chimique
est encore inconnue.
C’est toutefois à ces sécrétions résineuses analogues
aux gommes-résines végétales, et comme elles
douées, chez certaines espèces, de propriétés drastiques
énergiques, qu’il faut, oeroyons-nous, attribuer
les accidents produits par l’ingestion de ces champignons.
E t si l’empoisonnement qu’ils déterminent n’est
pas plus souvent dangereux, c’est que, d’une part,
leur prompte action émèto-cathartique amène presque
toujours l’évacuation précoce des aliments suspects,
incomplètement digérés, et que, d’autre part,
les sucs délétères, facilement solubles dans l’eau,
sont la plupart du temps, et plus ou moins complèment,
enlevés d’avance par la préparation culinaire
suivie, macération, décoction, avec rejet de l’eau employée,
cuisson prolongée, etc.
Disons, en passant, que van Bambeke a constaté
des vaisseaux laticifères ou hyphes vasculaires, non
seulement dans les Lactaires et les Russules, mais
dans les espèces appartenant à d’autres genres : Collybia.
velutipes, Lentinus cochleatus, etc., où ils contiennent
tantôt des matières grasses, tantôt du glycogène
et des matières albuminoîdes (Ch. van Bambeke,
Recherches sur les hyphes vasculaires des Fumycètes.
I. Hyphes vasculaires des Agaricinès, Gand, 1892. —
Revue mycol. XIV, 1892, p. 118).
Paulet, à propos d’un Laiteux rougissant, qui n ’est
probablement que le Lactarius torminosus ou Lactaire
à coliques, rapporte que « M. Pico, médecin de
Turin, a donné une observation sur les effets de ce
champignon, dans les Mémoires de la bociété de Médecine,
de 1780 et 1782, dont le résultat est, qu’il
est d’un usage très malfaisant, quoiqu’un seigneur
russe l’ait assuré qu’on le mange en Moscovie, ainsi
que le poivré laiteux blanc ('Lactarius piperatus), dont
on met en salaison une grande quantité pour le Carême.
Ce médecin dit qu’en ayant donné à un chien, bâché
avec de la viande, l’animal périt de gangrène au bout
de douze heures. Ces deux assertions, qui semblent
contradictoires, peuvent être vraies l’une et l’autre,
si l’on fait attention qu’un champignon à suc brûlant
et changeant, tel que celui-ci, donné cru sans correctif
et en grande quantité à un animal peut causer une
iaiiammation telle qu’il en résulte un état gangrè